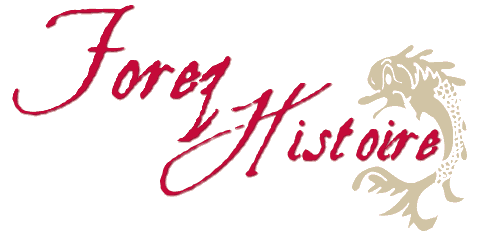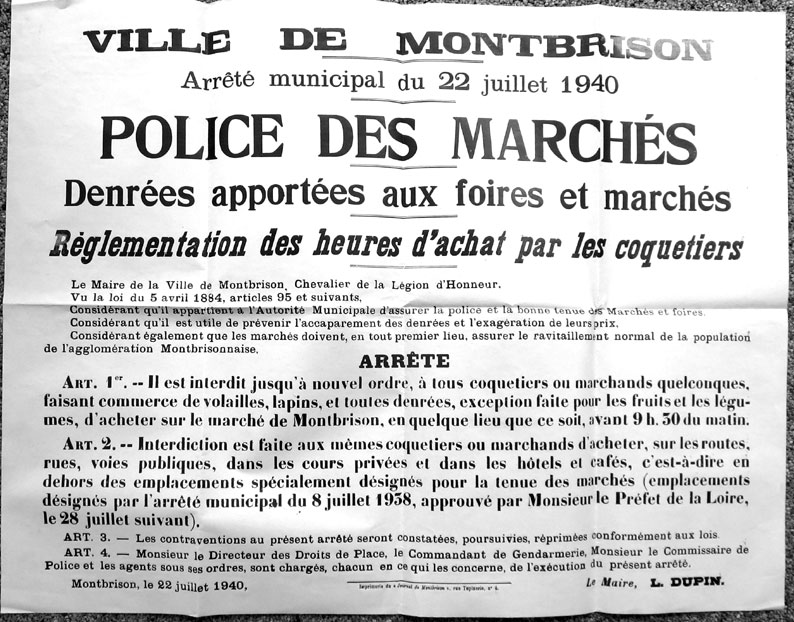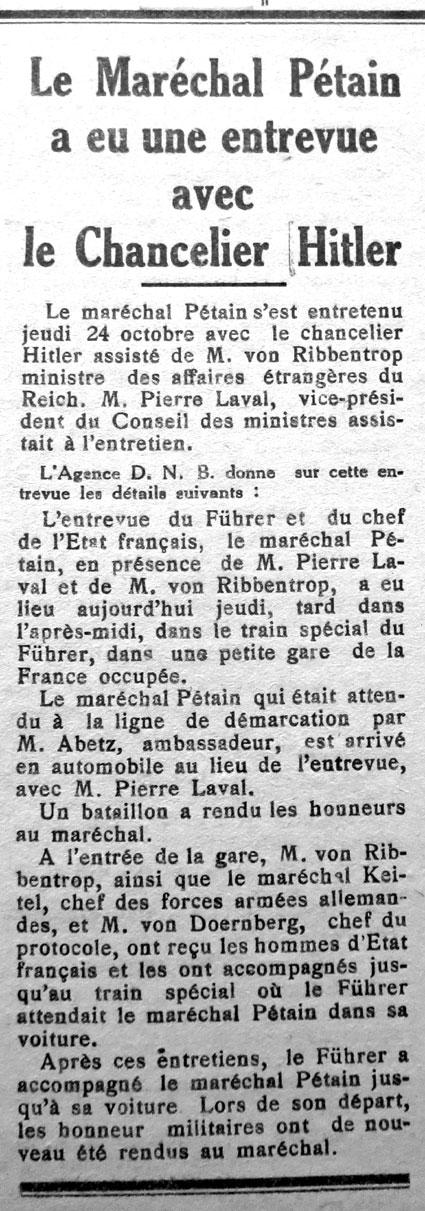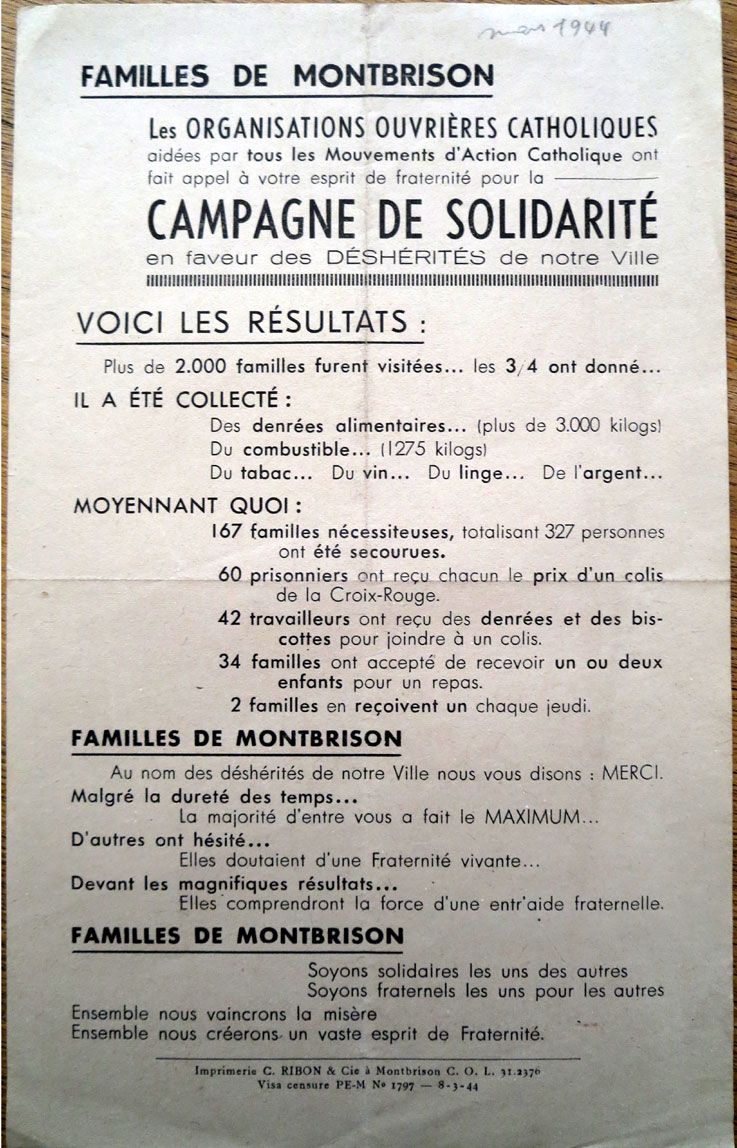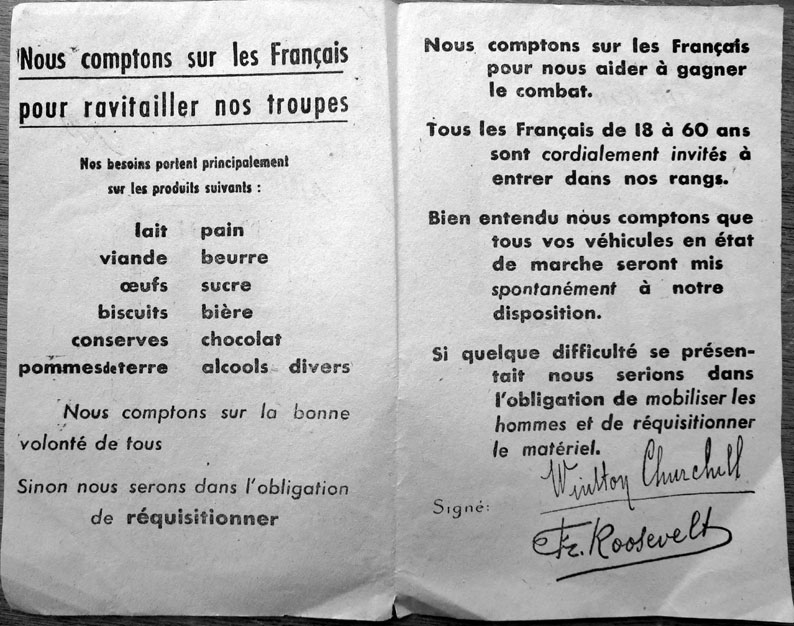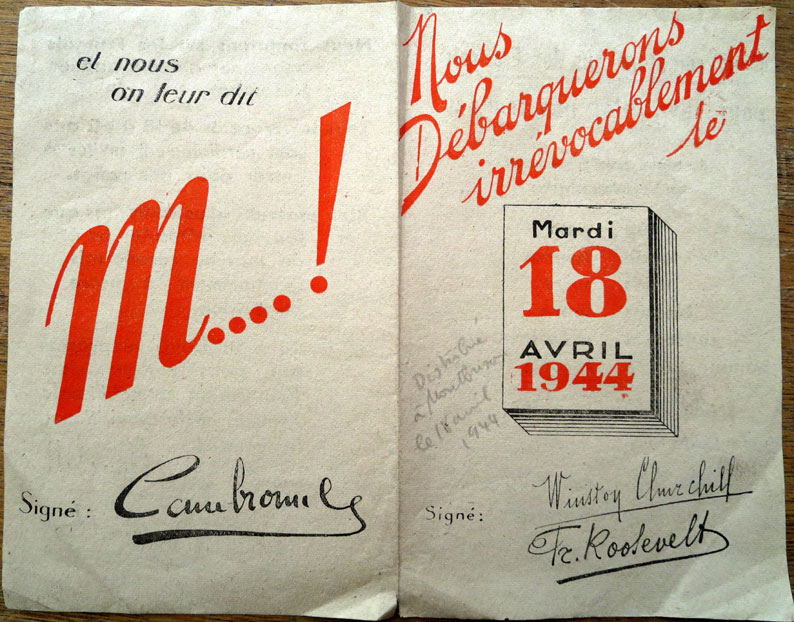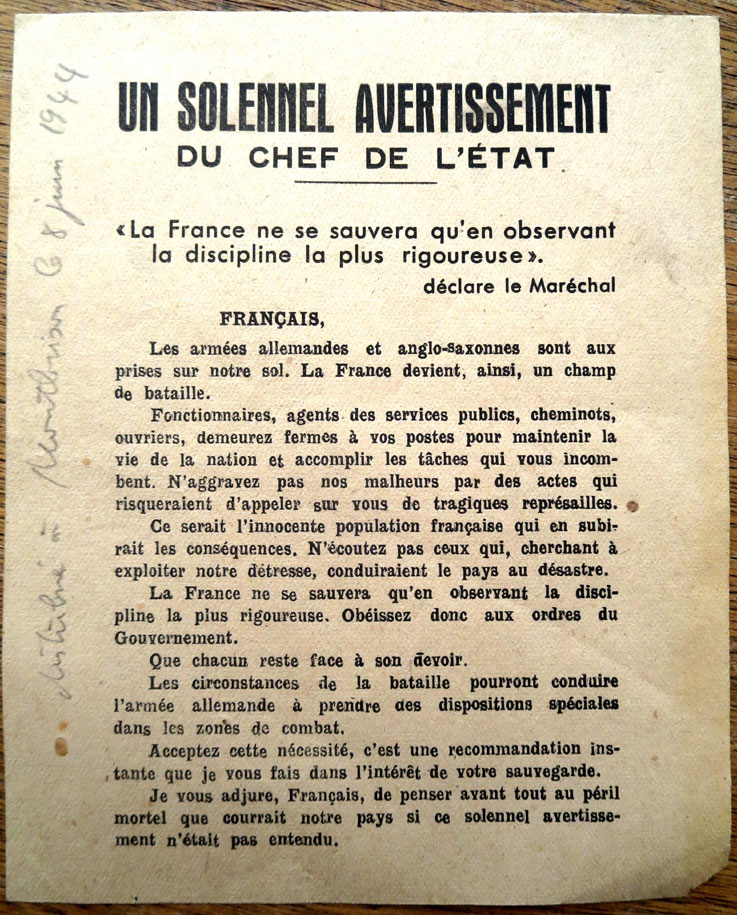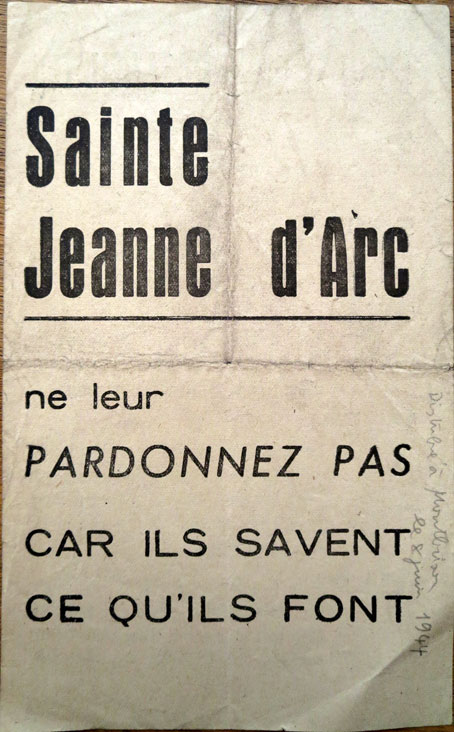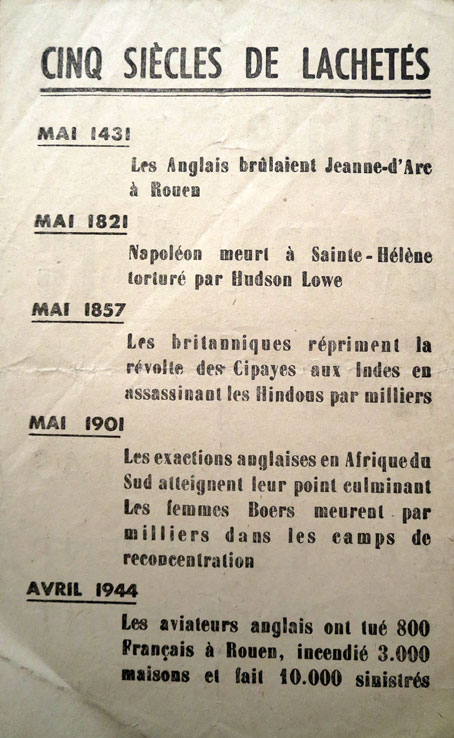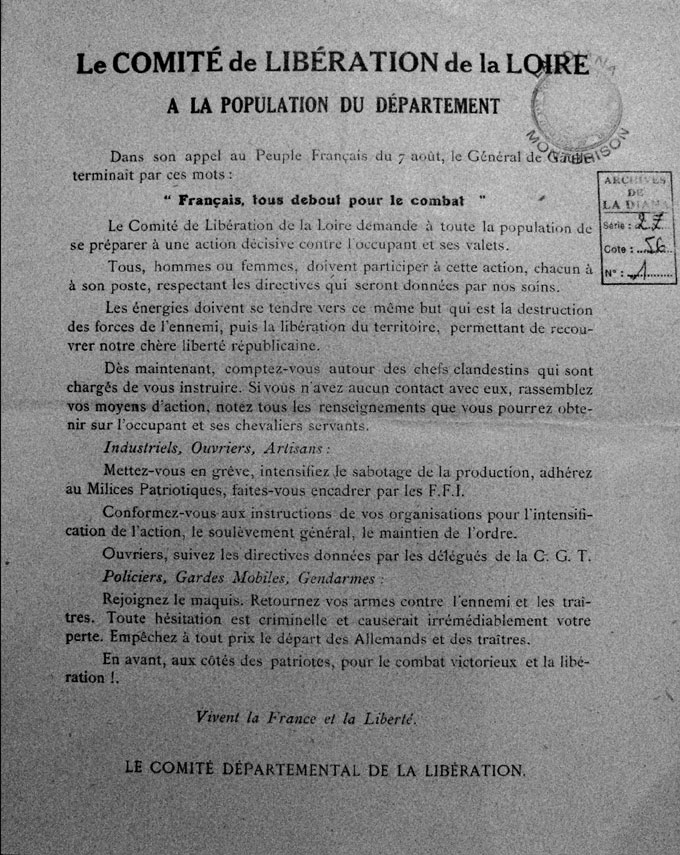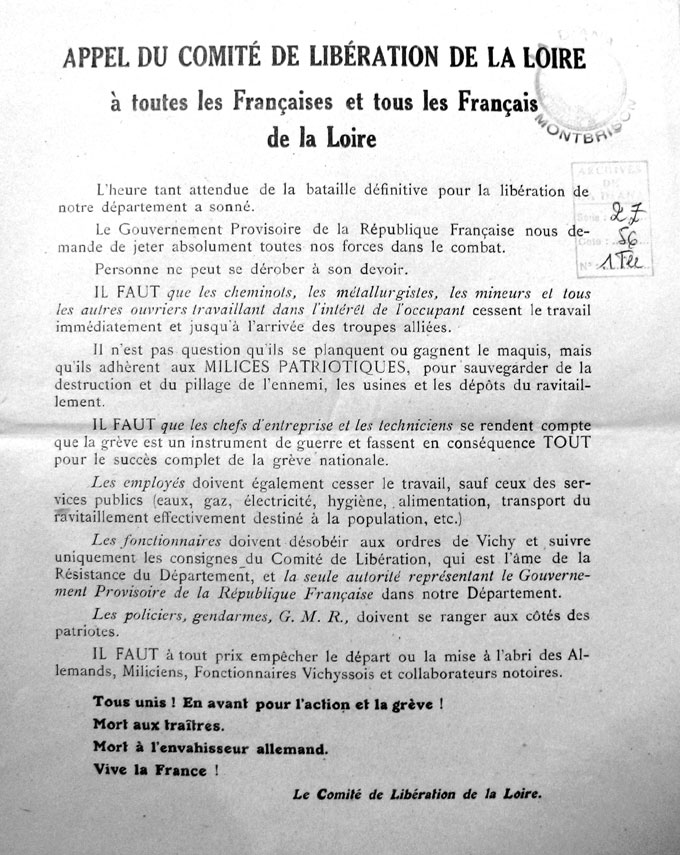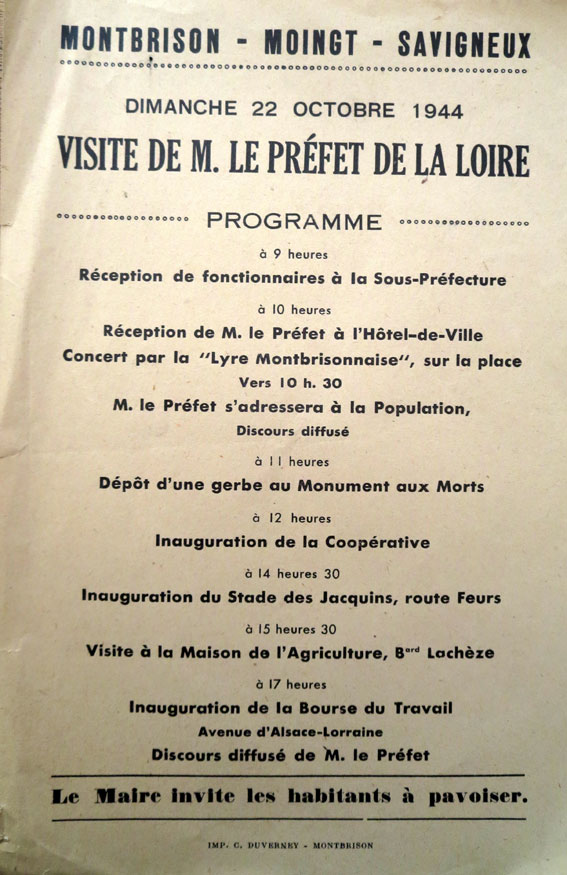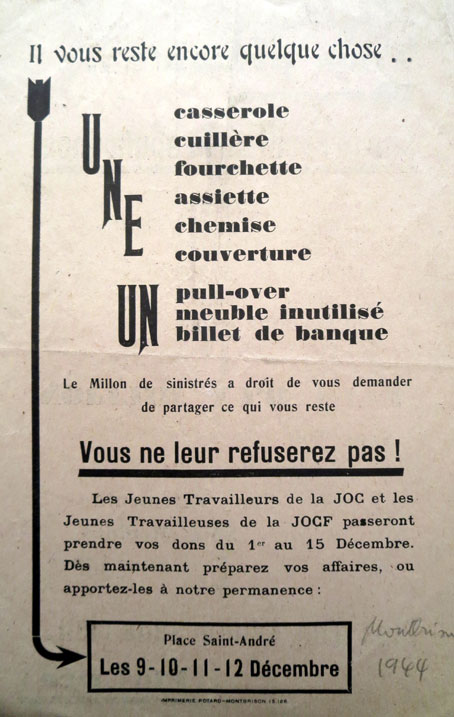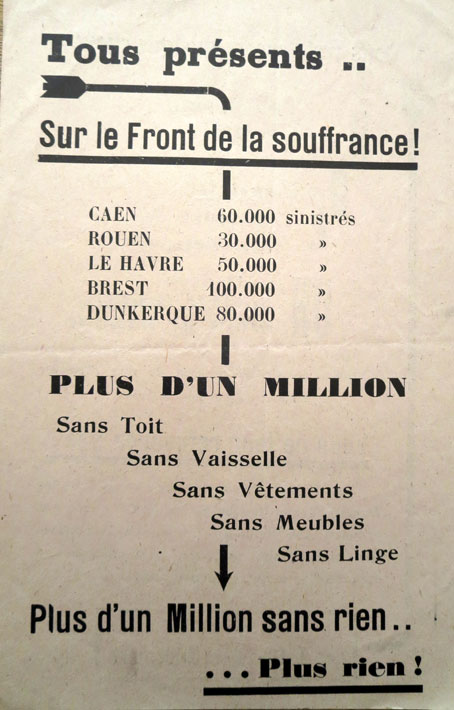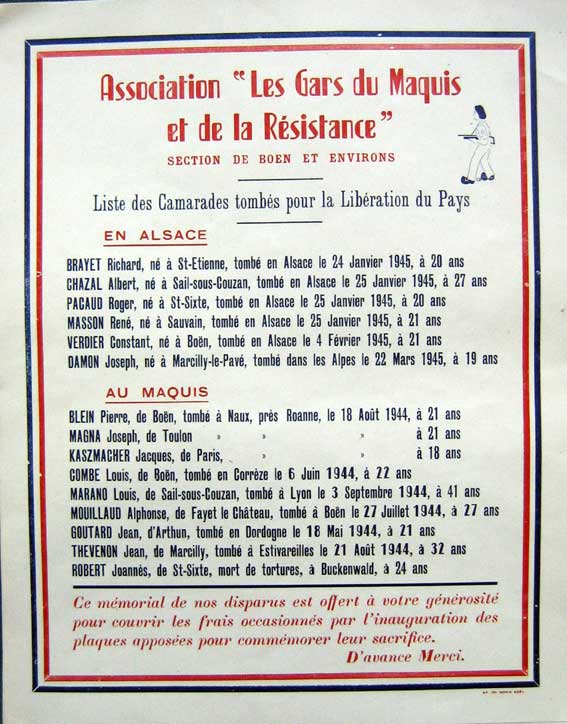| |
Seconde guerre
mondiale
dans le Forez
*
* *
La
Résistance
dans le département de la Loire
sa
place en région lyonnaise
Colonel
René Gentgen
(Exposé
du colonel Gentgen, correspondant de la commission d'histoire
de la Deuxième Guerre mondiale de l'Institut d'histoire
des conflits contemporains, présenté à
Roanne le 22 janvier 1988.)
Lorsqu'il m'a été proposé
de vous entretenir de la Résistance dans le département
de la Loire, il m'est apparu que le sujet, compte tenu de son
ampleur et de sa diversité, ne pouvait être traité
dans sa plénitude dans les limites de temps généralement
accordées à un conférencier.
Par ailleurs, au fil de mes lectures, j'ai toujours été
frappé par la place réduite faite à la
Résistance dans le département dans les ouvrages
qui font autorité en la matière. Henri
Noguères, dans son Histoire
de la Résistance, s'attache surtout aux services
secrets. Il cite quelques personnalités éminentes.
Alban-Vistel, dans La
Nuit sans Ombre, ne fait qu'effleurer les formations
politiques au niveau du département. Il omet les FTP
et le SOE dans sa relation des
combats.
Bien que la Loire ne puisse se prévaloir, sur le plan
militaire, d'exploits d'un retentissement national, il m'a semblé
qu'en toute équité, il convenait de la situer
à sa véritable place, au moins dans le cadre régional.
La limite de temps m'imposait d'opérer un choix dans
une matière substantielle et variée. Après
m'être beaucoup interrogé, j'ai finalement opté
pour un exposé d'ensemble portant sur les principaux
aspects de la Résistance départementale.
On peut, en effet, admettre que la Résistance, au plan
national et dans ses diverses manifestations à la base,
est devenue familière aux Français. Les médias
l'évoquent en toute circonstance. Le procès Barbie
en est un exemple récent. Les événements
locaux, quant à eux, sont rappelés annuellement
au cours de cérémonies commémoratives.
La ville de Roanne s'y applique avec beaucoup d'attention. Deux
ouvrages, œuvres de MM. Maloire
et Cabotse, en donnent une image
fidèle pour le Forez et le Roannais. Ces importants apports
me dispensent d'entrer dans le détail.
Ces observations liminaires étant faites, je vais retracer
pour vous les principales phases de la Résistance dans
la Loire dans les domaines politique et militaire. Je soulignerai
au passage la part du département au sein de la région
lyonnaise.
Sur le plan politique, depuis sa naissance jusqu'à son
dénouement, il faut distinguer trois phases.
Une première période,
assez longue, correspond à la prise de conscience du
caractère réel de l'État français
et de l'aboutissement fatal de sa politique de collaboration.
La seconde période portera
sur le fonctionnement routinier des mouvements et formations
à la recherche de structures unifiées aux échelons
départemental et local.
L'épisode ultime - il s'est
déroulé en 24 heures - correspond à la
mise en oeuvre du processus insurrectionnel et à la restauration
de la République.
Sur le plan militaire, il y eut une période de gestation,
inégale selon les formations et selon les secteurs géographiques.
La phase opérationnelle lui succédera tout naturellement.
Sa mission principale consistera en priorité à
perturber les communications et l'économie au service
de l'occupant. Elle sera finalement ponctuée par des
engagements militaires d'ampleur variable mais aux résultats
non négligeables.
Un bref examen de ces résultats et de quelques points
particuliers clôturera le récit des événements.
Plus brièvement encore, j'évoquerai l'apport du
département à la Résistance tout entière
par l'action de quelques-uns de ses fils à l'extérieur
de la Loire.
Je ne surprendrai personne en affirmant qu'il est difficile
de parler du département de la Loire sans qu'apparaisse
la dualité de ses centres vitaux et des particularismes
qui s'exercent de part et d'autre du seuil de Neulise.
À l'origine de la clandestinité, Saint-Étienne
et Roanne ne marchent pas la main
dans la main. Chacune des deux villes se lie directement à
Lyon. Au sein des mouvements, il n'y a pas de liens entre
les acteurs des deux villes.
Si, à mesure que les structures départementales
prennent leurs assises, tout finira par rentrer dans l'ordre,
les distorsions ne manqueront pas. En décembre 1943,
au moment où l'AS du Roannais entre dans le giron du
département, des circonstances locales plaçaient
encore un groupe de combattants authentiquement roannais dans
la mouvance de l'Allier.
Pendant la phase du réveil des consciences, en 1940 et
1941, c'est Saint-Étienne
qui donnera le départ des activités de résistance.
Le journaliste Jean Nocher en sera
la figure de proue. Avec lui, une femme et quelques hommes sauront
se reconnaître dans le refus du défaitisme. Ils
jetteront les bases départementales et locales de la
Résistance dans la Loire. Ils en assumeront la totalité
des tâches de propagande. Ils se feront les agents actifs
du redressement national.
La propagande exige des moyens. Dans le climat particulier du
moment, la force de persuasion de la radio de Londres ou les
propos de bouche à oreille n'ont que des effets limités.
Les papillons ou les graffiti qui parsèment les bâtiments
publics disparaissent très vite. Seul l'imprimé,
tract ou journal, permet au talent des rédacteurs de
produire un effet durable. Il passe par l'imprimerie. Mais un
contrôle rigoureux de la production de papier et le délit
d'opinion font obstacle à l'emploi légal de l'imprimé
par les résistants. Pour publier, il faut surmonter la
pénurie et braver les interdits. Les Stéphanois
y parviendront avec un plein succès.
La volonté de combattre le régime de Vichy et,
à travers lui, l'ennemi et son idéologie, n'est
pas née d'un coup de baguette magique. Rares ont été
les auditeurs de l'appel du "18 juin". Rares ont été,
parmi eux, celles ou ceux qui, comme Mme
Neuwirth, en ont aussitôt ressenti le déclic.
L'éveil a été le fruit d'un long cheminement.
Les Français touchés par la grâce furent
peu nombreux. Leurs motivations, ferveur patriotique ou opinion
philosophique, furent variées. Il fallut du temps pour
qu'ils puissent se reconnaître tous et pour coordonner
leurs actions. Sur Saint-Étienne, le processus est bien
connu. Le mouvement partira des intellectuels et des milieux
chrétiens démocrates.
Jean Nocher, rédacteur en
chef au journal La Tribune,
sera le chef de file des premiers. Il s'adjoindra René
Seyrou et Henri Perrin.
Une jeune fille de vingt ans, Violette
Maurice, étudiante à Lyon, ralliera des
adeptes dans les universités. Lucien
Neuwirth, 16 ans, regroupera des lycéens stéphanois.
Début 1941, nous les retrouverons tous unis autour de
Jean Nocher pour constituer le
groupe "Espoir".
Entre-temps, Jean Nocher a rejoint
Jean-Pierre Lévy, chef national
de "Franc-Tireur".
Il sera le premier responsable départemental, en janvier
1941, de ce mouvement. Violette Maurice,
tout en restant en liaison avec "Espoir",
formera le groupe "93".
Elle préservera son indépendance à l'égard
des grands mouvements nationaux.
Chez les chrétiens, ce sont Fernand
Bonis de la CFTC (1) et
Jean Perrin du PDP
(2) qui prendront l'initiative. Ils se regrouperont en octobre
1940. En 1941, ils se partageront les responsabilités
départementales, l'un à "Libération",
l'autre à "Combat".
Ils agissent tous deux dans les milieux catholiques favorables
à la Résistance.
C'est de ces précurseurs que sortiront les structures
départementales des "Mouvements
Unis de la Résistance". S'ils
incitent à quelques manifestations populaires - 1er mai,
14 juillet - c'est par la production et la diffusion sous le
manteau de tracts et de journaux que s'exerce l'essentiel de
leur activité. Ils créent deux journaux locaux
à fort tirage : L'Espoir
et 93, d'une haute tenue
patriotique et morale. Ils sont l'émanation des équipes
de même nom. Ils distribuent tout ce qui leur parvient
comme imprimés clandestins. En ces temps héroïques,
l'esprit de concurrence est banni chez les résistants.
Dans l'action, ils se refusent à distinguer entre l'une
ou l'autre des différentes organisations. Ils luttent
pour une cause commune.Dès
fin 1940, ils répandent La Voix
du Vatican, Vérité
et les Petites Ailes.
Fin 1941, Témoignage Chrétien,
Franc-Tireur, Combat,
l'Espoir et quelques autres
ont complété l'éventail. 93
s'y ajoutera en 1942.
Si Jean Nocher s'affirme très
vite comme la tête pensante et agissante de la résistance
stéphanoise, il le doit à sa stature intellectuelle,
à sa verve subtile mais aussi au fait qu'il dispose d'un
support de presse de fort tirage : La
Tribune. Cet organe est toutefois soumis à
la censure, ce qui en réduit la portée. L'effort
intense d'information né trouvera son plein rendement
que dans la presse clandestine. Pour distribuer, il faut d'abord
créer. Les bonnes plumes ne manquent pas. Pour transmettre
le message il faut un support matériel. Le problème
se pose pour la Loire. Il est d'une grande acuité pour
toute la zone non occupée. Les solutions viendront par
l'entremise de Jean Perrin et de
Paul Pascalini.
La fourniture de papier sera l'œuvre, pour l'essentiel,
des papeteries de Valfuret.
Paul Pascalini, membre de 93,
en est le directeur. Les Presses et
Messageries y contribueront. Après quelques
tâtonnements, les chutes de papier de La
Tribune feront le bonheur de l'Espoir.
Jean Perrin pourra s'attacher les
services de l'Imprimerie française,
4, rue Balaÿ, et ceux de l'Imprimerie Bornier
de Mans, place Badouillère.
La plupart des grands titres de la Résistance sortiront
de leurs ateliers. Les 30 premiers numéros de Combat,
les 20 premiers de Libération,
les numéros 2 et 3 de Témoignage
Chrétien, à 28 000 exemplaires y seront
tirés. Le premier tract et le numéro 1 de l'Espoir
en sortiront avant d'être imprimés chez
Guichard. Six numéros
de 93 porteront à leur tour,
à 25 000 exemplaires, la bonne parole.
Il y a là un effort considérable qui fait de Saint-Étienne
le second indispensable de la capitale de la Résistance.
Jean Perrin était prêt à dépanner
Franc-Tireur en cas de besoin.
Toute cette production était acheminée vers les
grands centres : Marseille, Montpellier
et Toulouse, par chemin de fer
avec la complicité des cheminots.
C'est par cet effort tout à fait exceptionnel que le
rayonnement de la Résistance stéphanoise s'est
affirmé très au-delà des limites du département.
Ce magnifique élan sera brisé de mars
1942 à juin 1943.
La police de Vichy aura entamé
le dispositif. Les agents allemands accentueront les dommages.
Fort heureusement, si l'Espoir
et 93 en meurent, les grands
mouvements de la zone sud se seront pourvus de relais.
Jean Perrin et Fernand
Bonis sont arrêtés le 5
mars 1942. Jean Nocher l'est
le 29 septembre. Violette
Maurice et Paul Pascalini tiendront
jusqu'en octobre 1943. La délation
d'un employé de l'Imprimerie française
en septembre et le départ pour Londres, en octobre, de
Bornier, mettront fin aux activités
résistantes de ces entreprises.
Ces arrestations, si elles perturbent la vie des organisations,
ne freinent pas le développement de la Résistance
dans la Loire. La production d'imprimés clandestins,
stoppée ici, est reprise ailleurs. Leur diffusion se
poursuit. Dès 1942, la Résistance tout entière
s'est renforcée par l'apparition de formations nouvelles.
Avec celles-ci, et parallèlement à l'effort militaire,
elle va s'orienter vers des tâches plus exaltantes pour
restaurer la République.
Alors que les précurseurs de la Résistance dans
la Loire rongent leur frein dans les prisons, le grain qu'ils
ont semé a levé. Les événements
mondiaux ont amené le PCF (3)
à engager toutes ses forces dans la lutte. Il prend l'initiative
de créer le FN (4). Les
syndicats, condamnés par la charte du travail, se réorganisent
en secret.
De toutes parts ont surgi des hommes nouveaux. Ils exercent
leur activité de résistance à partir des
centres administratifs industriels ou ruraux.
Au-delà de la propagande et du recrutement qui s'intensifient,
leur action s'étend à des domaines variés.
Ils s'opposent aux mesures iniques édictées par
l'occupant à travers l'état de fait. Ils sont
à l'origine des formations militaires et de quelques
réseaux de renseignement. Ils sauront adapter leurs organisations
aux nécessités diverses de la politique et de
la guerre.
Malgré les conflits internes, résurgences des
préjugés politiques d'avant-guerre, ils réussiront
à mettre sur pied un ensemble de mesures propres à
assurer, le moment venu, la continuité de la République
en France.
Ils bâtissent un dispositif complexe mais efficace pour
la mise à l'abri des personnes menacées : résistants,
juifs ou réfractaires au STO. Ils organisent un service
de fausses cartes d'identité et des filières d'évasion.
Pour subvenir aux besoins courants de leurs membres et pour
porter secours aux familles privées de ressources, ils
s'approvisionnent en cartes de rationnement par les moyens les
plus variés. Le noyautage des administrations publiques
répond en partie à ces préoccupations.
Je me borne, ici, à les rappeler.
Malgré les risques aggravés à partir de
1943, la dynamique des grands mouvements a suscité
des vocations de plus en plus nombreuses. À Saint-Étienne,
la succession de Jean Perrin a
été assurée, au gré des arrestations,
par César Garnier, Robert
Kahn et Charles Gouroux.
Celle de Jean Nocher le sera par
Henri Perrin et Gabriel
Calamand.
À Roanne, Elie Vieux et le capitaine Bernheim ont fait
leur choix dès 1940. C'est avec l'apparition, en juillet
1942, de Joseph Montiarret, agent de liaison entre Londres et
Franc-Tireur, que la résistance locale prendra forme.
Ils trouveront auprès de Thévenet, pour Combat,
et Boisserolle pour Libération, des successeurs discutés
ou malheureux.
Le capitaine Bernheim est un lointain
parent de Jean-Pierre Lévy dont
la sœur habite Roanne. C'est un agent du S R. Nommé
responsable d'arrondissement, il forme une équipe solide
autour de la personne de Marcel Gallet,
ouvrier à l'Arsenal. Gérard
Hennebert et Serge Giry,
membres de l'aviation civile repliée caserne
Werlé, partent à la recherche de terrains
d'atterrissage et de parachutage. Lorsque Montiarret
arrive à Roanne, il trouve sur place des hommes organisés
et résolus.
Montiarret étendra ses contacts.
Il rencontrera Jean Boyer à
Lyon. Il lui confiera des missions de parachutage et
d'émissions radio. Jean Boyer a
constitué un groupe très cohérent à
Saint-Germain-Laval.
À Feurs, c'est par l'intermédiaire
d'Yvon Morandat, émissaire
du général de Gaulle
en France, que la Résistance prend corps. En juillet
1942, Morandat voit le comte
de Neubourg et Marguerite Gonon.
Ils jettent, ensemble, les bases locales de "Combat".
Ils réceptionnent un parachutage de matériel d'imprimerie
destiné à Lyon. Marguerite
Gonon, par le canal de Mme Cailliau,
sœur du général de
Gaulle, membre de la Conférence de Saint-Vincent-de-Paul,
réussira à faire évader le commandant Hettier
de Boislambert, futur grand chancelier de l'ordre de
la Libération, des prisons de Vichy. Elle sera la première
responsable de l'AS (5) de Feurs.
À Chazelles-sur-Lyon et
à Montbrison, c'est à
partir de syndicalistes chrétiens que la Résistance
prend son élan. Fernand Mirabel
en est l'animateur. Militant du PDP et de la CFTC, poète
à ses heures, il prend position dans l'un de ses sonnets
dès le 18 juin 1940. Il
rédige des tracts qu'il adresse à ses amis sous
pli postal. En collaboration avec l'abbé Labrosse,
il forme des équipes locales à Chazelles-sur-Lyon.
Il est à "Combat"
et à "Libération".
Il sera épaulé par Augustin
Pèze, au titre de "Franc-Tireur".
Mirabel intervient à Montbrison
où il entraîne Jean Rolle
et sa suite. Militant CFTC, celui-ci s'adjoindra l'abbé
Varigas, curé de Pralong.
Profondément croyant, il aura quelques démêlés
avec des membres du "Coq enchaîné"
dont la foi laïque n'a d'égale que sa foi religieuse.
À Rive-de-Gier, ce sont
les sœurs Escoffier, enseignantes,
qui inspirent le groupe local. Georges
Bidault est hébergé chez Paponnaud.
En janvier 1943, tous ces résistants
se rassemblent au sein des Mouvements
unis de la Résistance (MUR). Ils érigent
un directoire départemental. Aucun Roannais n'y siège.
Le premier président en est Robert
Kahn de Libération. Chacun de ses membres recevra
une attribution spécifique. Les actes politiques y seront
coordonnés mais l'initiative des secteurs reste entière
dans l'exécution. Les MUR viennent
de marquer leur cohésion aux côtés de nouveaux
arrivants. Le PCF s'est reconstitué.
Il sera la seule formation politique à s'affirmer dans
la clandestinité sous sa dénomination d'avant-guerre.
Il créera son hypostase, le Front
national, qui jouera un rôle de premier plan dans
tous les domaines de l'action résistante.
Après son démantèlement au cours des années
1939-1940, le PCF s'est appliqué
à rassembler ses militants dans ses cellules de base.
Accusé de tous les crimes pour des motifs idéologiques,
il paiera un lourd tribut à la Résistance. Son
agressivité ne fera que croître au fil de ses pertes.
Il jouera un rôle déterminant en s'appuyant sur
son émanation directe, le FN.
À Saint-Étienne et
à Roanne, ce sont Buart
et Faulle qui en ont la
responsabilité.
Le FN fait son apparition dans
la Loire à la fin de 1941.
Sa naissance est annoncée par un tract du
PC en septembre 1942. Ses
structures originelles reposent entièrement sur des membres
du parti. Il recrutera de nombreux sympathisants en 1943,
surtout parmi les intellectuels.
Il est difficile d'en suivre l'évolution interne. En
1946, l'un de ses représentants
interrogé sur ses activités pour le compte du
comité d'histoire pour la 2e guerre mondiale a fait cette
réponse : "Au FN, la modestie
est de rigueur, aucune vedette, aucun nom. Certains documents
sont tenus secrets. Ils ne seront pas communiqués."
Ce représentant ira au bout de sa logique, il ne nous
est connu que sous le pseudonyme de Rémy.
On connaît tout de même sa première secrétaire
départementale, Mme Meier,
enseignante au lycée de Saint-Étienne et son responsable
en 1944, Cavassilas.
Le FN subira des coupes sombres. 27 arrestations à Saint-Étienne
en juin 1942, dont Joseph
Sanguedolce, et d'autres le 6 mai
1943. À Roanne, la
rafle a lieu le 6 mai 1944. Antoine
Pâtissier, créateur du secours populaire
local, est arrêté. Frappé durement, le FN
se reforme dès le lendemain. À peine prend-il
le soin de se faire oublier pour un temps. Ses actions sont
celles de tous les mouvements. Son oeuvre principale sera la
mise sur pied des FTPF (6).
Il aura des antennes à Roanne,
Montbrison, Firminy
et Rive-de-Gier. À Roanne,
ce sont Rémy, Henri Diot
et Antoine Pâtissier qui
conduisent son destin avec persévérance.
Les organisations syndicales se sont mises à l'unisson
des différentes organisations. Ils sont en liaison avec
l'une ou l'autre d'entre elles selon leurs affinités.
Elles se feront les pourvoyeurs des maquis.
En plus des organisations au rayonnement national, je n'aurai
garde d'omettre les "Équipes
chrétiennes" et le "Coq
enchaîné". Si leurs supports philosophiques
sont fort éloignés, ils n'en contribuent pas moins,
dans la Loire, à la lutte commune de la Résistance.
Les Équipes Chrétiennes
se sont organisées autour de la diffusion de Témoignage
Chrétien. Elles regroupent des membres du
clergé, des militants d'action catholique et des jeunes
des mouvements spécialisés (JOC,
JEC) (7). Michalon en a la charge à Saint-Étienne,
pour le département.
À Saint-Étienne ville,
c'est l'abbé Ploton qui
en est la figure dominante. À Montbrison,
le chanoine Duperray, supérieur
du séminaire, a pris position publiquement, dans ses
sermons, dès 1940. Les abbés
Paul Clément, aumônier
de la JOC, et Pleynet,
animent les éléments roannais. Aux côtés
des membres du clergé, Antoine
Chaperon de Roanne, Marguerite
Gonon, Ferdinand Mirabel
et Jean Rolle agissent en plus
d'activités déjà exigeantes par ailleurs.
Quatre membres de la JOC roannaise
figurent parmi les cinq maquisards tués dans le Roannais.
Le mouvement lyonnais du "Coq
enchaîné" compte Louis
Pradel parmi ses membres fondateurs. Il étend
l'une de ses ramifications dans la Loire. Il publie un journal
: Le Coq Enchaîné.
Pointu, de Saint-Étienne,
en est le responsable départemental. Le mouvement est
d'inspiration radicale-socialiste et franc-maçonne. Joseph
Bourges le représente à
Rive-de-Gier, Louis Fouilleron
à Montbrison. Ce dernier
fera des apparitions à Roanne. Le mouvement servira de
rampe de lancement aux réseaux Buckmaster
en Lyonnais.
À l'exception de ce dernier, et après un long
et patient labeur émaillé de discussions serrées
mais courtoises, tous ces mouvements finiront par se réunir,
courant 1944, au sein d'organismes collectifs. Ceux-ci s'efforceront
de faire face aux problèmes de la Libération,
notamment, prise de possession des administrations publiques
et épuration. Ils créeront des commissions diverses
à cet effet. Les débats y seront souvent âpres,
mais les décisions y seront prises à l'unanimité.
Cette manifestation d'unité prendra la forme des CDL
et CLL (8). Le premier siège au chef-lieu, les autres
dans les centres administratifs du département. Assez
curieusement, Saint-Étienne n'aura pas de CLL.
Le CDL a été constitué le
15 avril 1944. Il a pour première mission de préparer
la succession de Vichy et d'assurer
l'intérim préfectoral. Il se substituera au conseil
général après la mise en place du préfet
de la Résistance. Le préfet initialement prévu
était un avocat roannais, maître Fauconnet.
En août 1944, il est emprisonné à Toulouse.
La présidence du CDL revient à Gabriel
Calamend. Il appartient aux MUR devenus MLN (9). C'est
un Franc-comtois. Le secrétariat est assumé par
Cavassilas du FN Michalon
pour les Équipes chrétiennes,
Joseph Piot pour le PC et Louis
Duchêne pour la CGT y siègent en qualité
de membres, le capitaine Ferrières,
en tant que représentant militaire.
La désignation du syndicaliste fut controversée.
Il y avait rivalité entre les tendances ex-confédérés
et ex-unionistes. Le litige fut réglé en faveur
de ce dernier. À la suite de propos malencontreux du
départemental FFI, un conflit surgit autour de sa personne.
Il fut finalement résolu par un acte d'autorité
de la région.
Si l'énumération des CLL n'a qu'un intérêt
secondaire, un auditoire roannais ne peut se désintéresser
du sien. Après des oppositions parfois violentes entre
les formations, le CLL du Roannais est constitué le 10
mai 1944. Elie Vieux, résistant
de la première heure en est le président. Il émane
du MLN.
Il est entouré de Dourdein pour le PS, de Rémy
pour le FN de Bonnefille pour le
PC et de Boiteux pour la CGT, Chenard,
des EC les rejoindra par la suite.
Le CLL formera trois commissions. Elles se consacrent à
la "Politique et à l'Épuration",
au "Ravitaillement et aux Transports"
et à "l'Insurrection".
Elles sont présidées respectivement par
Fournier, Cheylard et René
Paillard.
Les 20 et 21 août 1944, toutes les unités de la
Wehrmacht quittent le département. Des incidents sont
à redouter. La prise de possession des établissements
publics peut tenter, ici ou là, quelques écervelés,
surtout dans les centres. Montpellier,
Toulouse et Limoges
ont connu des situations confuses. À Lyon
le responsable régional FFI en a écarté
le danger. Dans la Loire, tout
se passera dans une complète harmonie. C'est tout juste
si l'on signale quelques symptômes, vite réprimés,
à Rive-de-Gier. À
Firminy, un désaccord est
tranché par appel à un arbitre, lequel, phénomène
assez rare, fut l'officier représentant militaire au
CDL.
Comment est-on parvenu à ce résultat à
Saint-Étienne et à
Roanne ? Au chef-lieu, ce fut par
l'action non concertée de journalistes et du capitaine
Ferrières.
Dans le cadre du CDL, des commissions de la presse et de l'insurrection
avaient été formées. Ledot,
journaliste à La Tribune,
présidait la première. La seconde avait demandé
au capitaine Ferrières de
conduire la phase insurrectionnelle sur la ville.
Les derniers soldats allemands quittent Saint-Étienne
au matin du 20 août. Les membres du CDL, surpris, sont
dispersés. Ils ne peuvent siéger. Une vingtaine
de FTP, aux ordres du capitaine Arthur, membre de la commission
insurrectionnelle, se présentent à 16 heures place
Jean-Jaurès.
Sous leur protection, et sous l'impulsion de Ledot,
faisant office de rédacteur en chef, les journalistes
confectionnent un journal qui prend le titre de La
République. Son éditorial insiste sur
la nécessité du maintien de l'ordre. Il publie
une mise en garde contre les excès. Il est diffusé
au matin du 21. Ces appels à la raison porteront leurs
fruits.
Le capitaine Ferrières est
alerté fortuitement, tôt, le 21. Il est seul et
sans troupes. Il décide d'agir seul et immédiatement.
Il se rend à la préfecture où il procède
à l'arrestation du sous-préfet Faller
qui fait fonction de préfet. Il confie ce poste à
Pierre Nautin, chef de la 2e division
et agent du NAP (10). Il se rend ensuite à l'hôtel
de ville où il fait incarcérer le CC (11) Weber,
collaborateur notoire. Il le remplace par le commissaire Fleuret,
résistant.
Le CDL s'est réuni entre-temps. Ferrières
s'en va lui rendre compte de ses actes. Le CDL entérine
les mesures prises. Gabriel Calamand
sera préfet jusqu'à l'arrivée de Lucien
Montjauvis, le 25 août. Il y aura quelques écarts,
tant à l'AS que chez les FTP. Il y sera vite mis bon
ordre. La Loire vient de passer d'un régime à
un autre sans incident, sans que la population en ait ressenti
les moindres remous, à peine percevait-elle les événements
importants qu'elle vivait.
Ces actions rapides, quasi simultanées, visaient à
décourager toute velléité d'entreprise
marginale. La mise en place de Lucien
Montjauvis confortera cet acquis. Cet ancien député
communiste de Paris, par son sens politique et sa modération,
saura calmer les esprits quand ce sera nécessaire. Il
fera l'unanimité sur son nom.
À Roanne, l'événement se déroule
encore plus simplement. Le 21 août, à 16 heures,
le CLL est réuni chez Elie Vieux.
Le commandant Antoine, chef de
secteur de l'AS, s'y trouve. Il a alerté ses troupes.
On craint l'agitation de quelques irresponsables. Le CLL, vers
le soir, constatant que le calme règne dans la rue, se
rend au grand jour à l'hôtel de ville. À
20 heures, il prend possession des lieux et siège d'emblée.
Elie Vieux s'installera à
la sous-préfecture, Dourdein
à l'hôtel de ville. Ici, comme à Saint-Étienne,
tout s'est passé dans le calme. Quelques Roannais ont
fait monter leurs acclamations au passage des membres du CLL
portant brassards tricolores.
Ce n'est pas un mince mérite pour le département
que d'avoir réalisé ce transfert de pouvoir dans
une absolue tranquillité et sans effervescence. Il est
peu de départements français qui peuvent se prévaloir
d'un tel titre de gloire, d'un titre qui en vaut bien d'autres.
Si la gloire est aussi au rendez-vous des succès militaires
dans la Loire, elle n'atteint pas le lustre de ces faits d'armes
qui ont nom : les Glières,
le Vercors ou le mont
Mouchet. Cela tient à deux facteurs : une situation
géographique qui place le département en dehors
des grands axes de pénétration ou de retraite
de la Wehrmacht et une densité militaire ennemie et amie
limitée. Lorsque les forces allemandes du sud de la France
refluèrent, elles se dirigèrent sur Dijon, soit
par Clermont-Ferrand et Digoin,
soit par la rive gauche du Rhône. Ceux de ses éléments
qui empruntèrent la rive droite du fleuve, ne feront
qu'effleurer la Loire entre Saint-Pierre-de-Bœuf
et Condrieu. Seul un groupe du
SOE y livrera combat.
Bien que Saint-Étienne et Roanne constituent des nœuds
de communication importants, ils ne seront utilisés,
voie ferrée exceptée, que de façon épisodique
et par de faibles détachements allemands. Il en résulte
que la Loire ne connaîtra que des engagements militaires
d'ampleur réduite. Si celui d'Estivareilles
atteint le niveau du bataillon, c'est qu'il concerne
les 2/3 de la garnison allemande du Puy,
forte de 1 300 hommes et contrainte de prendre la route par
suite de la coupure de la voie ferrée entre Saint-Étienne
et Le Puy, au viaduc des neuf ponts
au Pertuiset.
Dans la Loire, les Allemands ne comptent que 600 hommes. 1/3
d'entre eux échappe à l'autorité de commandement
départemental. Ils seront à peine inquiétés
pendant leur retraite. Leur faible densité donne une
idée de l'importance stratégique que l'occupant
accorde au département.
Les Allemands font usage du potentiel industriel de la Loire
et de ses moyens de communication. Il importe de les priver
de cette production et de leur liberté de mouvement.
Ces missions incombent à des hommes spécialement
affectés à ces tâches. La France aura besoin
d'assurer la continuité de son effort militaire jusqu'à
la victoire. Il en naîtra des formations militaires adaptées
aux objectifs du moment et aptes à s'intégrer
en dernier ressort aux unités régulières
de l'année française.
Toutes les formations militaires de la Résistance nationale
furent présentes dans la Loire. Si, à la libération
du département, l'Armée secrète a connu
la notoriété, ce sont les FTP qui souffrent les
premiers et le plus durement des méfaits de la répression.
Le SOE (12) se met en évidence par ses actes de sabotage.
L'ORA (13) s'est incorporée à l'AS en octobre
1943. Elle fournira le chef départemental des FFI (14),
lesquelles rassemblent la totalité des formations.
Celles-ci agiront par deux types d'unité : des équipes
de résistance sédentaires opérant à
partir de leur domicile et des éléments militarisés
qui prendront le maquis. Les premières aideront au soutien
logistique des seconds, elles les alimentent en effectifs.
L'Armée secrète de la Loire a vécu deux
phases distinctes dans sa constitution. L'une se fonde sur la
création des Corps francs au sein des mouvements, l'autre
prendra son essor avec la nomination du capitaine Jean Marey
à la tête de l'organisation.
Les Corps francs apparaissent à la fin de 1941. À
Saint-Étienne, ils sont l'œuvre de Combat. À
Roanne, ils appartiennent à Franc-Tireur. Jean
Perrin est à l'origine de celui de Saint-Étienne,
dont Jean Séclé est
le chef. Il ne comprend que 8 exécutants. Il agit avec
des moyens de fortune. Jean Perrin
achètera 10 revolvers de 6,35 à des républicains
espagnols, à 700 F pièce.
Ils lui seront livrés sans cartouches. Le groupe s'attaque
aux kiosques à journaux et aux vitrines de la collaboration.
Après l'arrestation de Jean Perrin
il passe aux ordres de la région et perçoit ses
premiers explosifs.
À Roanne, le Corps franc se forme autour de Marcel
Gallet. Il est plus étoffé que celui du
chef-lieu. Roger Grivelli, Hennebert,
Giry père et fils et les
frères Flicker en sont les
figures marquantes. Il fournit les comités de réception
des parachutages d'armes et d'accueil d'agents des FFI. Son
effort porte sur les sabotages d'entreprises au service de l'ennemi.
Le plus probant est accompli le 28 décembre 1942 à
France-Rayonne. Conduit par Gilbert Mus,
saboteur FFL, le CF (15) immobilisera l'usine plusieurs mois
en sectionnant la conduite d'eau qui l'alimente. Marcel
Gallet, le 4 juin 1943, se met à l'abri en Savoie.
Après sa disparition le Corps franc s'est dispersé
par mesure de sécurité.
Ce même 4 juin, Roger Grivelli a
reçu la visite des agents allemands dès 5 heures.
Il se défend jusqu'à son avant-dernière
cartouche. Il abat un colonel et deux agents. Il se loge la
dernière balle dans la tempe. Il a 22 ans.
Le 11 novembre 1942, le général Delestraint
est nommé chef national de l'AS. Des structures
nouvelles, hiérarchisées, seront créées.
Il faut placer des chefs aux divers échelons. La Loire
se met à la recherche d'un responsable départemental
opérant à plein temps. Pierre
Desgranges, qui en assume la charge début 43,
ne peut s'y consacrer entièrement. On songe à
des officiers de l'armée d'armistice rendus disponibles
par la dissolution de celle-ci. Trois saint-cyriens du 5e RI
sont connus pour leurs sentiments gaullistes. Ils sont attirés
par ailleurs. C'est un Lyonnais qui est proposé par la
région ; le capitaine d'artillerie Gaëtan
Vidiani. Il est à Saint-Étienne en janvier.
Il doit être confirmé au cours d'une réunion
qui se tient chez Paret le 3 février.
Les agents allemands y seront, ils arrêtent les 9 participants.
Le capitaine Vidiani mourra au
Struthof. Tout est à refaire.
En mars 1943, Jean Bergeret, étudiant
en médecine et militant des Équipes
chrétiennes, a mis le capitaine Jean
Marey en présence du chef d'escadrons Descours,
chef régional de l'ORA. La rencontre a lieu dans un café
de la place Badouillère à Saint-Étienne.
Marey y est intronisé comme
départemental OPA. En octobre, lors de la fusion, au
plan régional, de l'AS et de l'ORA, Marey
entreprend de tisser des structures départementales nouvelles.
Il établit des liens avec toutes les équipes de
résistants qui se sont constituées au sein des
mouvements. En octobre 1943, il est rejoint par 5 officiers
d'activé qui formeront, auprès de lui, l'équipe
départementale de l'AS. Il conduira à son terme
l'action qui contribuera à la libération du département.
Le combat d'Estivareilles, où
il fait 830 prisonniers, sera son œuvre maîtresse.
Avec le rattachement, fin 1943, du Roannais à son commandement
et le ralliement du réseau "Jockey",
l'AS s'articulera en six secteurs et quelques sous-secteurs.
Ce découpage s'explique par l'intégration dans
l'AS de résistants dont le rayonnement s'est affirmé
dès 1942. Ils s'implantent :
- à Saint-Étienne, avec Henri
Jeanblanc, enseignant. Il sera mis en sommeil après
l'arrestation de son chef le 6 juillet 1944 ;
- dans la vallée du Gier avec le lieutenant Brodin,
saint-cyrien. Ce dernier est arrêté en février
1944 ; Marcel Arnaud, technicien,
lui succédera ;
- dans la vallée de l'Ondaine, où Chapelon, commerçant,
René Cusset, saint-cyrien
et Régis Perrin,
architecte, se relaieront ;
- à Montbrison, avec Jean Rolle,
employé ;
- à Chazelles-sur-Lyon avec Adrien
Monier, représentant en chapellerie ;
- à Roanne, avec Boisseroles,
agent de maîtrise SNCF, puis, après son arrestation,
en décembre 1943, avec le lieutenant Charlet,
officier du Génie, le lieutenant Barriquand,
saint-maixentais et le commandant Antoine,
polytechnicien, officier du Génie.
Roanne a un sous-secteur à Saint-Germain-Laval avec Jean
Boyer, radio-électricien. Chazelles-sur-Lyon en
a deux, l'un à Saint-Galmier avec Eugène
Guillot, cordonnier, l'autre à Feurs avec Marguerite
Gonon à laquelle succède Renard,
officier d'aviation. La qualification professionnelle de chacune
de ces personnes donne une idée de la diversité
de cet encadrement.
Jusqu'à la Libération, les secteurs sont chargés
des tâches d'exécution. Les sabotages leur incombent.
Chacun d'eux doit recruter et former des équipes de sédentaires.
Le moment venu, il aura à constituer des maquis d'où
sortiront les unités combattantes.
II existera des maquis directement subordonnés au département.
Ils stationnent, l'un en Haute-Loire, à Boussoulet, l'autre
à la Chambonie, à
la limite du Puy-de-Dôme. Ce dernier disparaîtra
en avril 1944. Le premier est le noyau originel d'une très
belle unité : le GMO (16) du "18 juin".
Un maquis a rayonné dans les monts de la Madeleine, à
la fin de 1943.
Confié au capitaine d'infanterie coloniale
Fradin, il est directement subordonné à
la région dans le cadre des MUR. À la suite de
dissensions internes, il éclatera à la fin de
décembre. Les éléments des MUR et le groupe
"Alice" s'intégreront à l'AS de l'Allier.
Avant le 6 juin 1944, la totalité des missions de sabotage
est l'œuvre des résistants sédentaires. Après
le débarquement allié sur les côtes normandes,
ceux-ci les poursuivront en parallèle avec les unités
organisées. C'est aux sédentaires de Rive-de-Gier
qu'il reviendra, le 23 juillet, à Augris,
de détruire les 2/3 des réserves d'essence de
la 19e armée allemande.
Les unités combattantes de l'AS prendront forme au début
de juillet 1944, dans les maquis. Le gros de l'effectif stationnera
dans les monts du Forez, entre Saint-Bonnet-le-Château
et Montbrison. Des éléments graviteront autour
des monts de la Madeleine.
Elles seront l'une des originalités de l'Armée
secrète de la Loire. Sous la dénomination de GMO,
Marey imaginera des entités
militaires à base d'armement d'infanterie, motorisées
et pourvues d'un élément d'éclairage et
de liaison motocycliste. Ses effectifs seront fonction du recrutement.
Ils se situaient entre 40 et 160 hommes.
Il se créera une patrouille motorisée, assimilable
à un peloton d'AM (17). Elle se compose de cinq coupés
Citroën à pare-brise rabattable, avec un équipage
de 4 hommes. Chaque voiture comporte un FM (18) ou une mitrailleuse
d'aviation montée sur pivot.
Quelques GMO seront regroupés sous un même chef.
Le groupement "François" est confié
au lieutenant Cusset, celui de "Strasbourg" au lieutenant
Millon, tous deux saint-cyriens.
Au 20 août 1944, l'AS comprendra comme éléments
opérationnels, 6 GMO aux effectifs de 100 à 160
combattants et une patrouille. Un 7e GMO est en formation. Ils
proviennent des maquis de Boussoulet et des secteurs de l'Ondaine,
de Montbrison et de Chazelles-sur-Lyon. À cette date,
le secteur de Roanne est en mesure d'engager 3 unités
fortes de 20 à 30 hommes.
Rive-de-Gier dispose de 40 combattants résolus. Après
la libération, des GMO surgiront de partout. Il ne sont
pas retenus dans cet exposé. Ils sont le fruit de nombreux
engagés volontaires qui ont rejoint les rangs de l'AS
après le 22 août.
Les FTPF font leur apparition dans la Loire au cours de l'été
de 1942. Un comité militaire est créé à
Saint-Étienne à l'initiative du FN. Le département,
dénommé "Région 3 de l'inter-région
A", aura 4 secteurs : Rive-de-Gier, Firminy, Montbrison
et Roanne. À la fin de 1942, le responsable départemental
en est Jean Sosso, élément dynamique et décidé.
En plus des missions habituelles des formations militaires de
la Résistance, les FTP mettent l'accent sur l'enrôlement
des réfractaires du STO et sur le soutien aux familles
des victimes de la répression. Au niveau de la décision,
ils adoptent un dispositif collégial : le triangle de
commandement. Trois officiers y prennent le titre de commissaire
: aux effectifs, aux opérations et technique. Le premier
exerce une autorité morale sur les deux autres. Jean
Sosso organise ses secteurs à partir de militants
ou de sympathisants communistes. Dès la fin de 1942,
l'effort portera sur la constitution de camps.
En prélevant, à l'origine sur leurs équipes
de sédentaires, les secteurs créeront le camp
Wodli pour Firminy, le camp Vaillant-Couturier pour Roanne,
le camp Lucien Sampaix pour Montbrison et le camp Champommier
pour Rive-de-Gier. Par "camp", il faut entendre "maquis".
Le camp Wodli en est le plus illustre. Il en fut le plus nombreux,
le plus ardent, le plus chargé de péripéties
cruelles ou glorieuses de la Résistance armée
dans la Loire. Pour sa sécurité, il sera contraint
de multiplier ses déplacements. De l'Ardèche au
Puy-de-Dôme, il couvrira une surface égale à
deux départements français.
Il naît en janvier 1943 en Haute-loire. Jean Ollier, secondé
par Henri Hutinet, un jeune saint-cyrien,
en assume la responsabilité initiale. Le 26 avril 1943,
Hutinet conduit l'opération qui aboutit à la libération
de la prison du Puy-en-Velay de 26 détenus résistants.
Wodli récidive à l'automne et en délivre
79 autres.
Ces exploits provoquent de violentes réactions de la
part de l'occupant. Wodli subit de fortes pertes. Ses pérégrinations
commencent. Elles le trouvent en juin 1944 centré sur
la Chaise-Dieu où il est maître d'un large espace.
Il y évolue à son gré. Vial-Massat
en est le chef. Il comptera jusqu'à 600 hommes.
Il s'engagera à fond dans les harcèlements préparatoires
à la reddition de la garnison allemande du Puy, à
Estivareilles. Il y perdra 21 tués.
Le camp Vaillant-Couturier est la branche maquis du bataillon
FTP du Roannais. Diot en jette les bases en juin 1943. Il ne
prend consistance qu'avec l'arrivée d'Emile
Genest. À la fin de 1943, il est intégré
au groupe Fradin et participe au
combat de Lavoine le 15 novembre. Il reprend son autonomie au
1er janvier 1944. Il fera face à des attaques au Brugeron
et à Neulise. Il s'isole pour un temps. Reconstitué
à Vivans, ses deux fractions se réuniront en mai
sous l'autorité de Combecave. Il sera avec Lade
et 110 hommes, le 1er septembre, au combat de Saint-Yan.
Rassemblé à la mi-juillet 1944 à Lérigneux,
avec Romeyer, le camp Lucien Sampaix
est attaqué le 7 août par les GMR. Il est dégagé
par des unités de l'AS et du SOE réunis. Il a
2 tués.
Le camp Champommier se compose de partisans de la vallée
du Gier. Ses effectifs atteindront 120 hommes. Il est aux ordres
de Victor Leclerq. On ne lui connaît
aucun fait d'armes.
Avec le SOE, il entre dans la multiplicité des créations
du réseau Buckmaster, branche "action" des
services secrets anglais. La Loire a connu 4 de ses sous-réseaux.
Leur champ d'action s'étend sur plusieurs départements.
On ne retiendra, ici, que leurs antennes "Loire".
Dès 1942, le sous-réseau "Spruce" s'implante
à Saint-Étienne. Dissous au début de 1943,
"New-agents" lui succède en octobre.
Le sous-réseau "Acolyte", créé
en 1943, a fait de Roanne son centre principal de rayonnement.
Le sous-réseau "Jockey" se forme autour d'Adrien
Monier. Celui-ci a rencontré Francis
Cammaerts, responsable du secteur méditerranéen
du SOE, dans la Drôme. Il entre en action en 1943 avec
un Corps franc mais passe à l'AS en janvier 1944 avec
l'accord de Cammaerts. Ces quatre
sous-réseaux contribueront à alimenter la Loire
en armement.
"Spruce" et "New-agents"
recrutent leurs membres parmi les mineurs stéphanois
et dans les rangs du "Coq enchaîné".
Spruce s'identifie en la personne d'un agent anglais Allan
Jickell. Antoine Boirayon
en est la cheville ouvrière dans la Loire. Ces sous-réseaux
réceptionnent plusieurs parachutages. L'un de ceux-ci,
le 24 septembre 1942, à Mornand-la-Jarlette,
tourne à la catastrophe. Le comité de réception
est arrêté. 27 membres de l'organisation le suivront
en prison. Jickell regagne l'Angleterre
par l'Espagne. Tout est à recommencer.
Antoine Boirayon a échappé à la rafle.
Aux côtés de Joseph Marchand,
industriel lyonnais, il reprend le flambeau, à la fin
de 1943, sous la double appellation de "New-agents"
et de groupe "Ange".
Ils entreprennent une série impressionnante de sabotages
dont l'un au moins mérite d'être cité. Il
s'agit de l'arrêt total de la production, en mai 1944,
de l'usine Duralumin de Rive-de-Gier, par la mise hors d'usage
de l'arbre moteur des laminoirs les plus modernes d'Europe.
Au 1er juin 1944, "Ange"
constitue un maquis dont l'effectif atteindra 150 hommes. Le
7 août, il dégagera au prix d'un tué, les
FTP de Lérigneux. Le 31 août, il combat à
Saint-Michel-du-Rhône. Il
y perd 9 des siens.
À Roanne, sous l'autorité de Robert
Lyon, "Acolyte" aura des activités semblables.
Il opère en liaison avec l'AS qui lui est d'un précieux
appoint. Il crée un maquis à Fragny.
Fort de 28 hommes, placé sous les ordres d'un officier
américain recueilli à la suite d'un atterrissage
forcé, il est attaqué le 28 juillet et dispersé.
Il se reforme aux Noës, vers le 15 août, avec André
Cambouher. Présent à Saint-Yan avec 80
hommes, il négligera sa mission pour s'en aller cueillir
des lauriers plus faciles ailleurs.
Dans la Loire, l'ORA ne compte que deux officiers saint-maixentais
au moment où elle fusionne avec l'AS. Celle-ci comprendra
un contingent assez nombreux d'officiers et de sous-officiers
d'activé qui ont servi dans l'esprit de l'ORA.
Les opérations militaires à mettre à l'actif
de ces forces sont connues. Quelques-unes ont été
évoquées au passage. Je me bornerai, ici, à
un bilan. Un inventaire détaillé des actes de
sabotage reste à établir. Dans un document dressé
en 1972 par M. Peycelon, ils s'élèvent
à 404 opérations sur les usines ou les voies de
communication. On y compte 212 attentats contre les personnes
dont 36 sur Roanne. Si le premier nombre est proche de la réalité,
le second paraît excessif.
Les sabotages se répartissent en 32 interventions sur
le potentiel industriel, 294 sur les voies ferrées et
78 sur les lignes électriques ou téléphoniques.
La période d'après le 6 juin en totalise 158.
La part de Roanne est de 65 dont les trois quarts après
le 6 juin.
Non compris les accrochages mineurs, 30 combats ont opposé
les forces de la Résistance à celles de l'ennemi.
L'AS en a livré 17, les FTP 10 et le SOE 2. Les trois
formations participent au combat de Lérigneux. Au cours
de ces engagements, la Résistance aura 90 tués.
Elle laisse 61 prisonniers aux mains de l'ennemi. Le camp Wodli
subit les pertes les plus sévères. À lui
seul, il compte 40 tués et 46 prisonniers. Les blessés
et les victimes civiles dus aux combats ne sont pas compris
dans ces nombres.
Les pertes adverses n'ont été que rarement dénombrées.
Les chiffres les plus fantaisistes ont été avancés
par les combattants. On peut estimer comme proches de la vérité
: 170 tués et 858 prisonniers dont 35 miliciens. Dans
ces totaux, Vaugris est retenu
pour 76 tués et Estivareilles pour 830 prisonniers. Ce
résultat, auquel s'ajoute celui des sabotages dont l'ampleur
n'est pas mesurable, est important.
La mise sur pied de ces unités et leur emploi ont rencontré
des difficultés de tous ordres. L'action clandestine
est parsemée d'obstacles. On examinera, ici, brièvement,
ceux qui relèvent du commandement, de l'équipement
et de l'encadrement.
Les FFI ont été créées en février
1944 par décision du CNR (19). Le 4 avril, le général
Kœnig en prend le commandement. Elles comportent
un échelon départemental. Début avril,
la région y place le capitaine Jean
Marey. Jusqu'à la Libération, celui-ci
n'usera jamais des prérogatives attachées à
ce poste.Immédiatement après sa nomination, et
à la suite d'un écart de langage de sa part survenu
à point nommé, le FN en conteste le bien-fondé
et revendique cette responsabilité pour l'un des siens.
Le colonel Provisor, chef régional
pour la rive droite du Rhône, y est favorable. Un obstacle
préalable est à lever, l'éloignement de
Marey. Le suppléant de celui-ci, sollicité,
s'y oppose. Provisor doit se résoudre
à confirmer Marey dans sa fonction. Il le fait dans une
lettre au FN, datée du 27 juillet. Le climat qui s'est
instauré entre-temps et le comportement délibéré
du principal intéressé, empêchèrent
sa mise en application. Les contacts suivis, établis
en février entre AS et FTP furent rompus. Il n'y eut
pas coordination des actes de guerre dans la Loire.
En matière d'équipement, aucune formation de la
Loire ne disposera de moyens de transmission radioélectriques.
Le département n'a aucune liaison de ce type avec la
région. Le groupe "Ange"
disposait d'un téléphone de campagne pour ses
relations internes.
L'habillement est d'abord assuré par les volontaires
eux-mêmes. L'AS de Montbrison s'emparera, à Saint-Just-sur-Loire,
d'un millier de tenues militaires de l'armée d'armistice.
Les maquis des monts du Forez en furent pourvus.
Les problèmes d'armement et de fourniture en explosifs
furent initialement réglés par des moyens de fortune.
Armes récupérées partout où une
occasion se présentait. Cartouches de dynamite prélevées
sur des chantiers divers ou sur le carreau des mines.
Des armes proviennent du 5e RI. Elles sont prises aux gendarmes.
Des fusils de chasse et des armes de poing individuels entrent
dans les dotations. L'AS bénéficie de deux apports
substantiels, l'un vient d'un dépôt clandestin
de l'armée de l'armistice sauvé par le comte
de Neufbourg des rafles de la Wehrmacht ; l'autre lui
est amené "à domicile" par un escadron
de la Garde républicaine, passé au maquis, le
8 juillet 1944, avec armes et bagages. L'essentiel de l'armement
arrivera par la voie aérienne. Le SOE, les Mouvements
et l'AS en seront les destinataires. Les FTP ne recevront aucun
parachutage.
La topographie du département de la Loire se prête
bien aux terrains de parachutage ou atterrissage en campagne.
48 parachutages réussis ont été répertoriés.
On compte 7 échecs. Le premier parachutage est destiné
au BCRA , 8 iront aux Mouvements, 10 à l'AS de la Loire
et 10 à l'AS du Rhône. Une équipe de Jedburg
et des SAS sautent, le 15 août à Grézieux-le-Fromental.
Parmi les arrivages de matériels, 28 sont dirigés
sur Lyon, la Loire n'en percevra que la portion congrue. 4 disparaîtront
avant d'avoir servi. On peut estimer à 16 ceux qui vont
à l'équipement des sédentaires et des unités
combattantes de la Loire. Un avion répond, en moyenne,
à l'armement d'une centaine d'hommes. Ce sont 2 000 hommes
qui pourraient être armés par ce moyen. Les coupes
sombres opérées par l'occupant, réduisent
ce nombre à 1 600. On voit par là, que les autres
sources d'armement ne furent pas négligeables.
On ne pouvait laisser des combattants dans la nature sans les
armer. Mais les tractations avec les FTP portant sur les transferts
d'armes parachutées furent âpres. Aucune indication
sur les effectifs ne pouvait être obtenue, moins encore
vérifiée. Il y eut source de conflits parfois
suivis d'actes caractérisés d'hostilité.
À la libération, toutes les formations FTP de
la Loire étaient correctement armées. Il subsiste
toutefois des imperfections. À Saint-Yan,
la compagnie Lade compte une trentaine
de fusils de chasse. Le groupe Flicker,
de l'AS, au 20 août, comprend 40 hommes non armés.
Le SOE fut servi à profusion. Ses chefs suppléèrent
autant qu'ils le purent aux besoins des autres formations. Il
faut leur rendre un juste hommage.
Plus que dans la quantité d'armes, c'est dans leur mise
en œuvre convenable que réside leur efficacité.
16 hommes et 2 bazookas engagés à Vaugris
font davantage que des compagnies imparfaitement employées.
La différence provient le plus souvent de la plus ou
moins grande aptitude des cadres à accomplir leur fonction.
À tous les niveaux de la prise des décisions et
dans l'exécution, la Résistance réclame
des hommes de convictions. Au niveau supérieur elle exige
qu'ils se doublent d'intelligence et de raison. Au département
et au secteur, il lui faut disposer de véritables meneurs
d'hommes, aptes à partager les risques à la tête
et au milieu de leurs troupes. À tous les échelons,
le rôle essentiel des cadres est de les découvrir
et de les placer aux postes appropriés à leurs
qualités.
Dans la Loire, chez les FTP, Hutinet
et Vial-Massat sont de ceux-là.
Antoine Boirayon en est au SOE.
À l'AS, Jean
Marey, au vu de ses dons et de son charisme, est indiscutable.
On ne peut affirmer la même chose dans tous les secteurs.
Si Adrien Monier à Chazelles-sur-Lyon
et Henri Jeanblanc à Saint-Étienne
sont bien à leur place, on ne peut aller au-delà.
Fort heureusement, les insuffisances seront compensées
par la qualité et l'ardeur des subordonnés :
Michel Flicker et Jean
Boyer dans le Roannais,
le lieutenant Millon dans le Montbrisonnais,
Régis Perrin à Firminy
et Joseph Coste à
Rive-de-Gier, pour ne citer que
les plus en vue.
Avec un nombre plus élevé d'hommes de cette trempe,
le rendement global des formations armées de la Loire
se fut encore accru. Le potentiel existait. Les fluctuations
internes au secteur de Roanne furent
préjudiciables au plein emploi de ses forces.
Les résultats obtenus par l'ensemble des forces armées
de la Loire sont, en tout état
de cause, substantiels. Dans le domaine des sabotages, ils sont
considérables. C'est par un défaut de liaison
entre les exécutants et les états-majors alliés,
que les bombardements aériens de la Ricamarie
et de Saint-Étienne, qui
firent 1 500 victimes parmi la population, ne purent être
évités. À la Ricamarie,
la destruction des machines-outils de la Nadella était
en préparation à l'AS. À Saint-Étienne,
l'équipe du groupe "Ange",
chargée de la paralysie du nœud ferroviaire était
à pied d'œuvre le 26 mai 1944.
Dans le domaine des engagements entre forces adverses, ils sont
des plus acceptables sans pour autant atteindre le niveau de
ceux des départements voisins.
On a vu par la quantité des armes livrées que
l'état-major allié ne fit pas de la Loire
un département prioritaire. En un seul jour, le 1er
août 1944, la Haute-Savoie
a reçu sept fois le contingent global. Cela s'explique
par sa position géographique, mais aussi, par le volume
de ses effectifs.
Laissons parler les chiffres. Au 1er juin 1944, l'ensemble des
maquis rattachés à la Loire
totalise 570 hommes. À cette date, la Haute-Loire
mobilise 4 000 hommes pour le mont Mouchet.
Au 22 août, date officielle
de la libération du département, la Loire rassemble
2 100 hommes dans les unités combattantes et 700 à
800 sédentaires. Ce même jour, la région
lyonnaise annonce 60 000 hommes pour 10 départements,
soit une moyenne de 6 000 pour chacun d'eux. Ces chiffres se
passent de commentaires. Ils ne diminuent en rien les mérites
des résistants de la Loire.
La Loire peut aussi s'honorer d'avoir participé au combat
libérateur par quelques-uns de ses fils, appelés
à des tâches d'une autre ampleur. On ne retiendra
que trois noms ; René Brouillet,
Paul Rivière et Romans-Petit.
René Brouillet est un diplomate
proche de Georges Bidault ; en
avril 1943 il entre au Comité
général d'études, organe annexe du CNR.
Le comité publie des Cahiers
Politiques. René Brouillet
en est l'un des rédacteurs. Il sera le premier
commissaire de la République d'Angers.
Appelé à d'autres fonctions, c'est Michel
Debré qui assumera ce poste.
Paul Rivière joue
un rôle de premier plan en région lyonnaise. Il
est l'un des premiers dirigeants de "Combat".
En janvier 1942, il prend la tête
des services aériens sous leurs différentes formes,
en liaison directe avec l'EM allié. Il aura la haute
main sur ces opérations pour le sud de la France. [note
ci-contre]
Dans "La nuit sans ombre"
Alban-Vistel
lui a consacré, ainsi qu'à son épouse Jannick,
dix pages entières.
Romans-Petit n'est plus à
présenter. Il opère dans l'Ain.
Il est le chef prestigieux des célèbres maquis
qui défilent le 11 novembre 1943 dans Oyonnax.
Officier de l'Armée de l'Air, il est stéphanois.
C'est un ami personnel de Jean Nocher.
Il engagera plus de 3 000 hommes parfaitement organisés
et armés, le 1er septembre 1944, aux côtés
des 157e et 180e R.I. américains dans l'opération
de libération de son département.
Si cet aperçu embrasse les principaux aspects de la Résistance
dans le département de la Loire, il n'en retrace que
les grandes lignes, d'où un débit un peu aride
de l'exposé. Il est loin d'épuiser le sujet. La
matière en est abondante. Pour la pénétrer
jusque dans sa trame, un gros volume serait nécessaire.
Bien des points importants restent dans l'ombre.
Nombreux sont ceux qui ne seront jamais connus. Des acteurs
de premier plan ont disparu avant de témoigner, d'autres
se réfugient dans un silence obstiné, le devoir
étant accompli.
Le rôle éminent de Robert
Kahn, celui du capitaine Berheim
sont couverts d'un voile peu transparent. L'un et l'autre sont
morts à Bron, au fort de
la Duchère le 18
août 1944.
Les réseaux de renseignements n'ont pas été
évoqués. L'aide que le monde paysan apporta à
la vie des maquis et dans les parachutages ne peut être
comptabilisée. Elle est considérable.
II était tentant de situer la place du département
dans la région lyonnaise. Prépondérante
à l'origine, elle s'est estompée peu à
peu.
La Résistance a pleinement rempli son office dans la
libération du sol national mais elle avait une ambition
plus élevée. Elle a combattu une idéologie
malsaine. Elle visait à extirper celle-ci, non de la
mémoire des hommes, mais de leur cœur. Elle rêvait
de lui substituer un idéal de dignité humaine
qui puisse s'exprimer partout dans le monde, au-delà
des croyances, au-delà des civilisations particulières.
À ce titre, elle reste d'actualité. Elle est le
souci de tous les hommes généreux capables de
se dévouer pour le bien d'autrui.
Il reste, il restera toujours à faire pour atteindre
cet objectif difficile et lointain. Vue sous cet angle, la Résistance
peut encore apporter beaucoup aux Français et au monde.
Au-delà du patrimoine historique de la nation, dont elle
forme un fleuron incomparable, elle constitue, par la masse
des enseignements qu'elle dispense, un réservoir inépuisable
mis à la disposition, aujourd'hui et dans l'avenir, de
tous les chercheurs soucieux d'humanité.
Annecy-le-Vieux,
le 27 décembre 1987
1 -
Confédération française des travailleurs
chrétiens.
2 - Parti démocratique populaire, d'inspiration démocrate
chrétienne.
3 - Parti communiste français.
4 - Front national, mouvement de résistance créé
à l'initiative du PCF, mais recrutant en fait dans des
milieux politiques différents.
5 - Armée secrète.
6 - Francs tireurs et partisans français.
7 -Jeunesse ouvrière chrétienne, Jeunesse étudiante
chrétienne.
8 - Comités départementaux de libération,
Comités locaux de libération.
9 - Mouvement de libération nationale.
10 - Noyautage des administrations publiques.
11 - Commissaire central.
12 - Secrète opération executive (Sections spéciales
de l'Intelligence service britannique).
13 - Organisation de Résistance de l'armée.
14 - Forces françaises de l'intérieur, créées
officiellement le 1er février 1944 ; le général
Koenig, héros de Bir Hakeim fut placé à
leur tête.
15 - Corps francs, unités (régulières)
de combat, chargées de missions spéciales ou délicates,
confiées plus tard aux commandos.
16 - Groupes mobiles d'opérations, unités combattantes
de l'Armée secrète.
17 - Automitrailleuses.
18 - Fusil-mitrailleur.
19 - Conseil national de la Résistance.
20 - Bureau central de renseignement et d'action, dirigé
par le colonel Passy et dépendant du gouvernement de
Londres.
(Village
de Forez, supplément au n° 53, du 2e trimestre
1993)
Note
d'Alexis Rivière, fils de Paul
Rivière :
Paul
Rivière n'a jamais été dirigeant de Combat.
Il s'est retrouvé presque par hasard dans cette organisation
car il participait, depuis 1941, par conviction anti-nazie,
aux opérations de propagande (distribution de journaux,
tracts, etc.) et a fini tout simplement par se retrouver sous
les ordres d'Henri Frenay, chef de Combat ; les effectifs
des "activistes" étaient à cette époque
fort réduits ! Il a d'ailleurs très vite quitté
Combat pour devenir l'adjoint de Raymond Fassin, officier
d'opérations de Jean Moulin.
Par ailleurs, il n'a pris la tête des opérations
aériennes dans la zone sud qu'en juillet 1943, après
l'arrestation de Caluire.
Son engagement n'était pas d'origine politique mais
simplement patriotique (à l'instar des milliers d'inconnus
qui ont fait la Résistance), ce qui explique le peu
d'écho qu'elle a eu par rapport à des personnalités
plus connues par leur engagement plus médiatisé.
Il faut reconnaître qu'il est très difficile
de trouver des textes totalement exempts d'erreurs dans les
témoignages des acteurs de l'époque, que ce
soit du fait des défauts de la mémoire ou même
du désir inconscient de recréer une histoire
plus satisfaisante... On leur pardonne.
*
*
*
La
Résistance
Montbrison
Souvenirs
de Lucien Gidon
(Village
de Forez n° 6, 1981)
La bataille de Lérigneux
Voir la page :

Bataille de Lérigneux (7 août 1944)
*
*
*
Publications de Village de Forez
Aventurier
Gérard, Cellier Albert, Des
instituteurs de la Loire au Service du travail obligatoire (STO)
dans le Troisième Reich (1943-1945), suppl. au n°
69-70, avril 1997.
Aventurier
Gérard, Cellier Albert et des anciens du STO, Des
STO de la Loire dans la tourmente, suppl. au n° 73-74,
avril 1998.
Aventurier Gérard, Antoine Jouve (1919-2004), de Combat à l'Armée secrète : la vigilance, la cohérence, la droiture, 2011.
Bouchet Paul, Chambon Pascal, Latta Claude, Moiron Pascale, Steiner Jean-Michel, Aventurier Gérard, Galletti Charles, Le Forez pendant la seconde guerre mondiale, communications au Printemps de l'histoire 2012.
Briand
Roger, Antoinette,
résistante, épouse exemplaire du commandant Marey,
suppl. au n° 77-78, avril 1999.
Briand
Roger, Itinéraire
d'un maquisard FTP : mémoires d'Adrien, suppl. au
n° 81-82, avril 2000.
Cellier
Albert, La
guerre en Forez Velay, chronique, juin 1940, suppl. au n°
81-82, avril 2000.
Collectif, Le
Forez et les Foréziens dans la guerre et la Résistance
1939-1945, Cahier de Village de Forez n° 62, avril 2009.
Collectif, La guerre de 1939-1945, Résistance
et déportation, Cahier de Village de Forez n° 70Communications au Printemps de l'histoire 2009.
Collectif (J.-M. Steiner, C. Latta, Bernard Teper), Le programme du Conseil national de
la Résistance.
Covey Guy et Grange-Gagnère Marie, Une
famille britannique : les Covey, Cahier de Village de Forez n° 68, 2009.
Chassagneux
Jean, STO
(Service du travail obligatoire) Auschwitz-Königstein (1943-1945),
préface de Georges Toupet, suppl. au n° 89-90, avril
2002.
Cuisinier
Antoine, Marguerite
Gonon parle (la Résistance à Arthun, Guy de Neufbourg),
suppl. au n° 81-82, octobre 2000.
Latta Claude, L'appel du 18 juin, Cahier de Village de Forez n° 81, 2010.
Latta Claude,
Thévenet-Merle Marie-Claudette, Le groupe de Résistance d'Arthun,
le comte de Neufbourg, Marguerite Gonon et leurs compagnons,
2012.
Patard
Joanny, Journal de Joanny
Patard, vigneron de Boën, au STO à Linz Donau (Autriche),
7 juin 1943-26 mai 1945, présentation et notes d'Antoine
Cuisinier, suppl. au n° 97-98,
avril 2004.
Vente Joseph, Cinq
ans prisonnier en Allemagne (1940-1945), préface d'Henri Clairet, 2005.
Vial-Flatry Marie-Antoinette, Juste des Nations, présentation et notes d'Antoine Cuisinier,
n° 74, 2010.
Tous
ces ouvrages sont disponibles au Centre social de Montbrison
13,
place Pasteur 42600 MONTBRISON
perso.wanadoo.fr/centresocial-montbrison

*
*
*
Le monument
en hommage
aux morts du groupe Ange
aux
Limites,
sur la route
de Montbrison à Saint-Anthème

*
*
*
Plaque
commémorative
sur la façade
de la mairie de Montarcher

*
*
*
Montbrison

A la Libération,
devant le monument aux morts
Premier rang : 2e en partant de la gauche Jean Marey, 3e Lucien
Gidon, 5e René Gentgen
*
*
*

Le
commandant Marey et son épouse Antoinette
*
*
*
Documents
22 juillet 1940 :
affiche (fonds
Brassart, archives de la Diana)
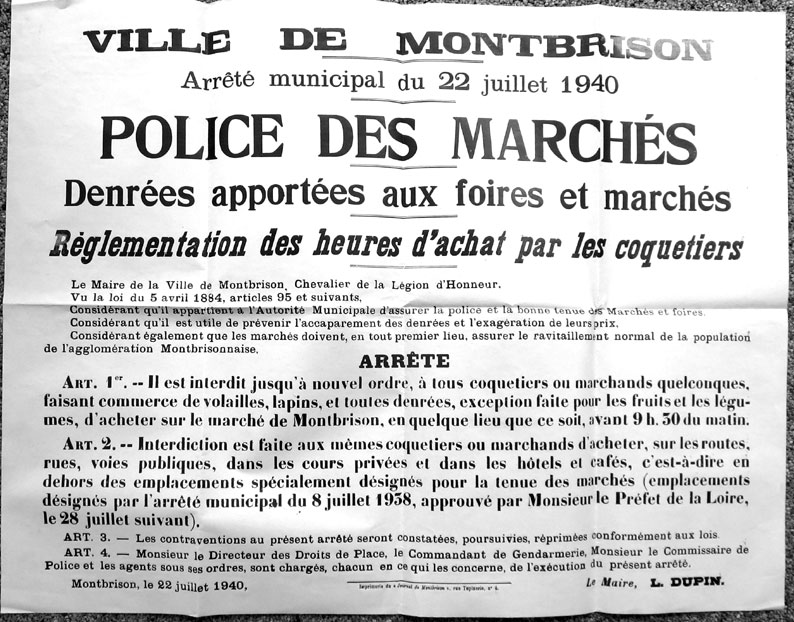
*
* *
26
octobre 1940 :
(Journal de
Montbrison)
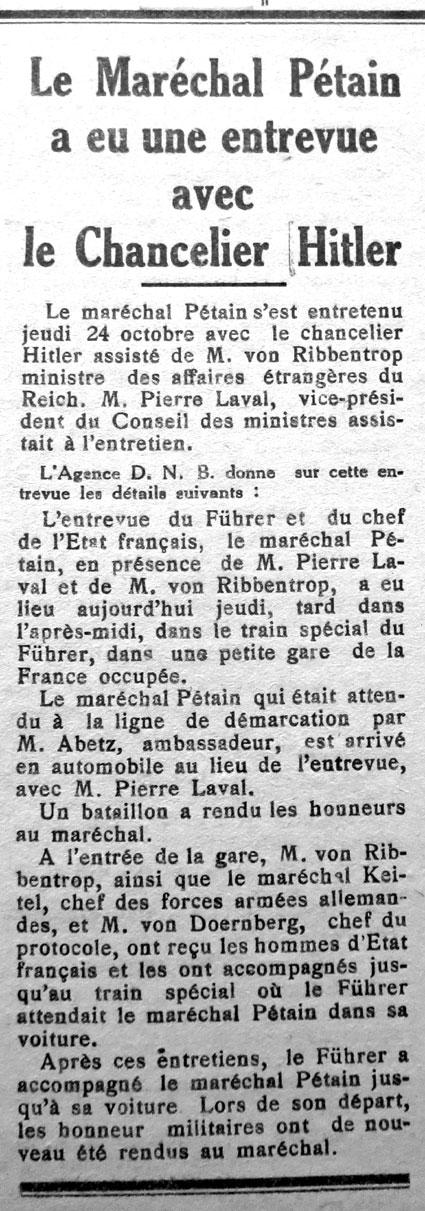
*
* *
Mars
1944 : tract distribué à Montbrison, appel à
la solidarité
des
mouvements d'action catholique
(fonds Brassart, archives de la
Diana)
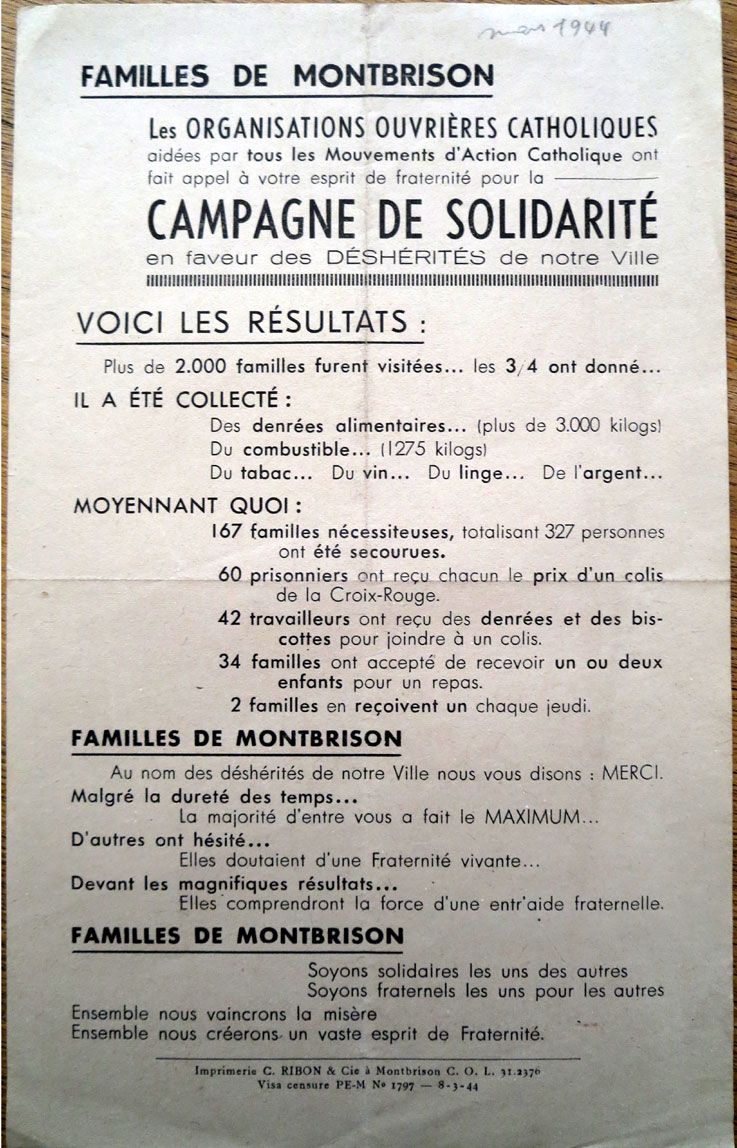
*
* *
18 avril 1944 : tract distribué à Montbrison, propagande
de Vichy
(fonds Brassart, archives de la
Diana)
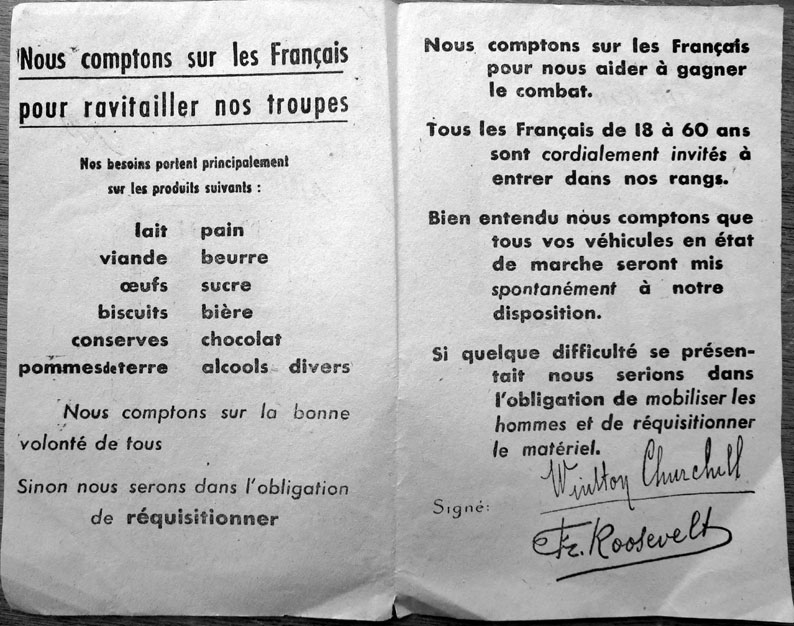
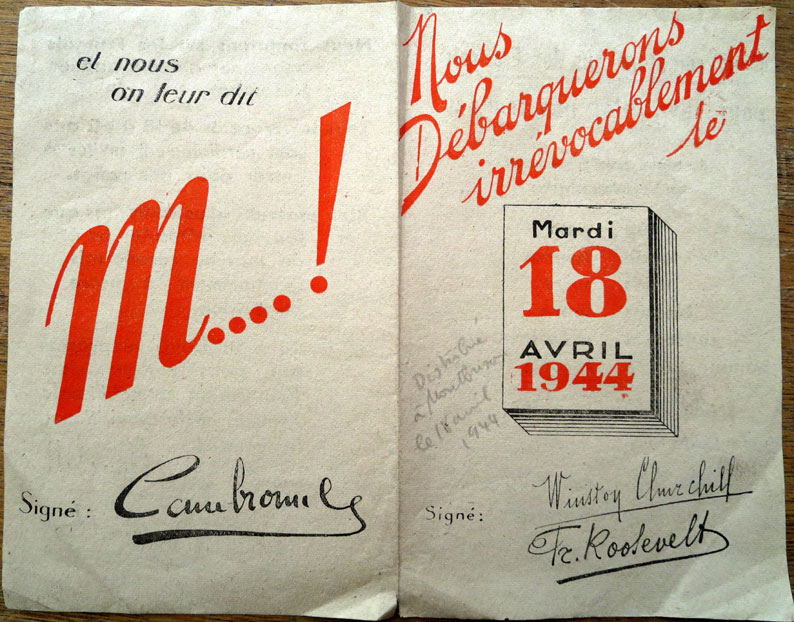
*
* *
8
juin 1944
: tract distribué à Montbrison, appel du Maréchal
(fonds Brassart,
archives de la Diana)
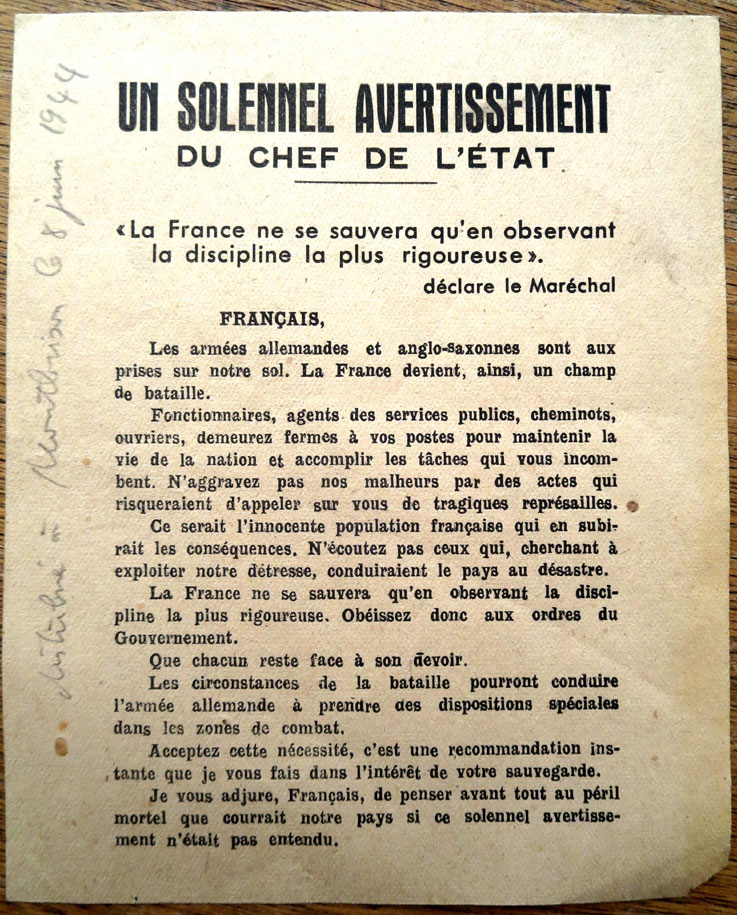
*
* *
8 juin 1944
: autre tract (anti-britannique) distribué à Montbrison
(fonds Brassart,
archives de la Diana)
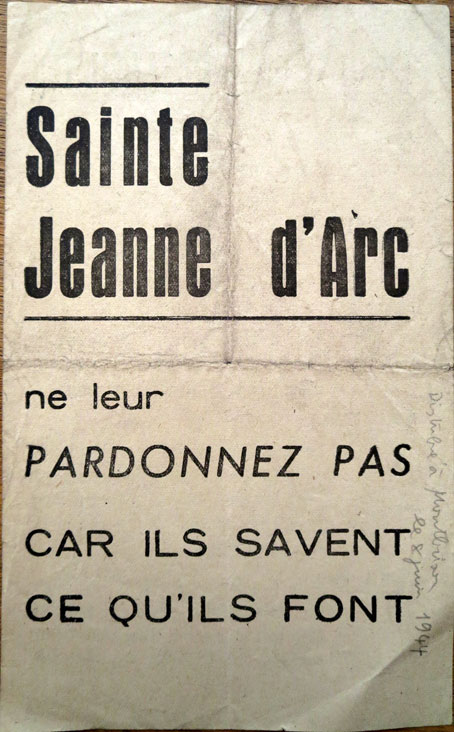
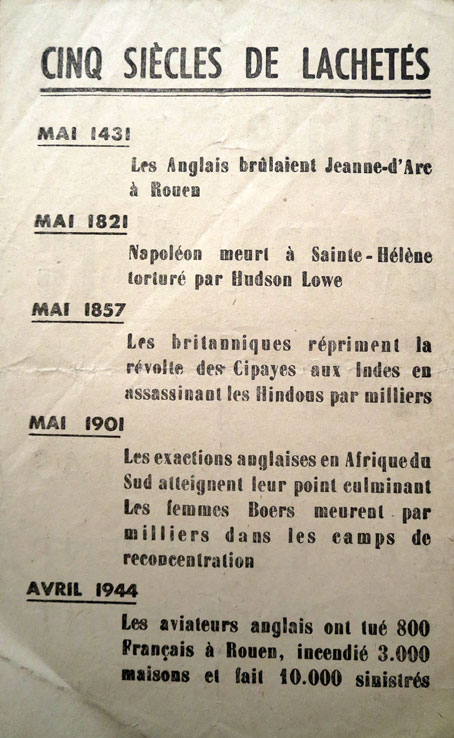
*
* *
Tracts
du Comité de Libération de la Loire
(archives de la Diana)
août 1944
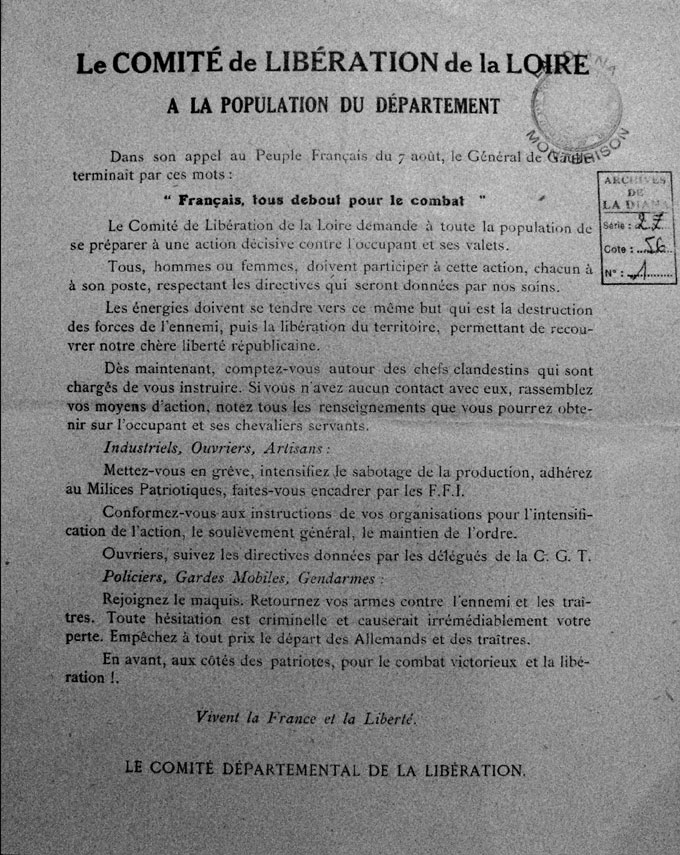
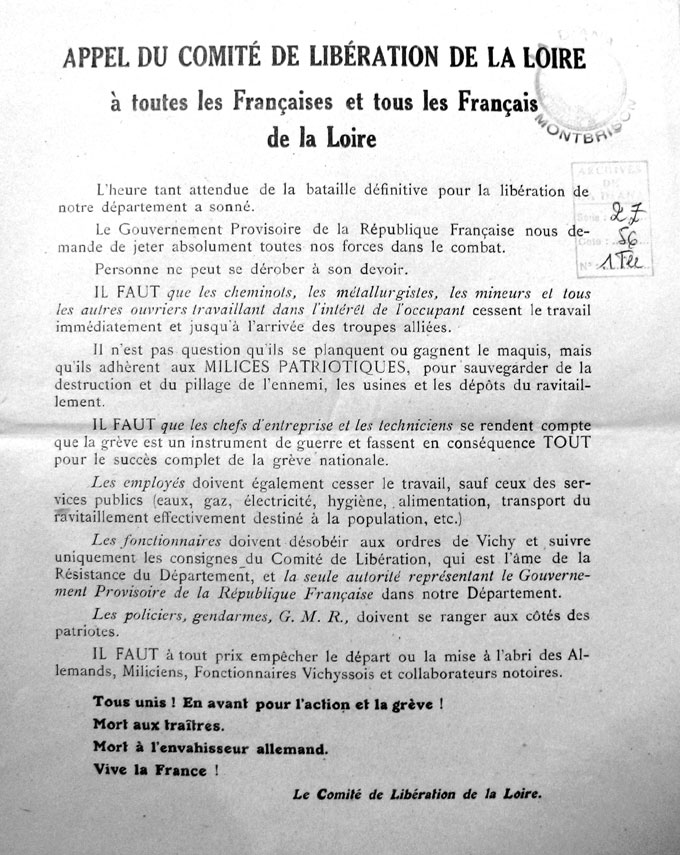
*
* *
Octobre
1944 :
tract pour la visite du préfet à Montbrison
(fonds Brassart,
archives de la Diana)
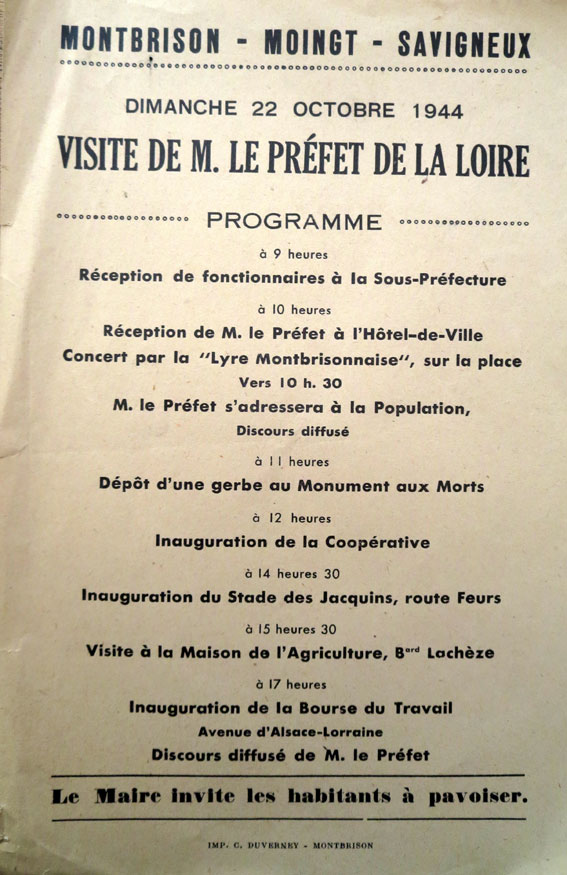
*
* *
Décembre
1944 :
tract distribué à Montbrison, appel à la
solidarité de la JOC
(fonds Brassart, archives de la Diana)
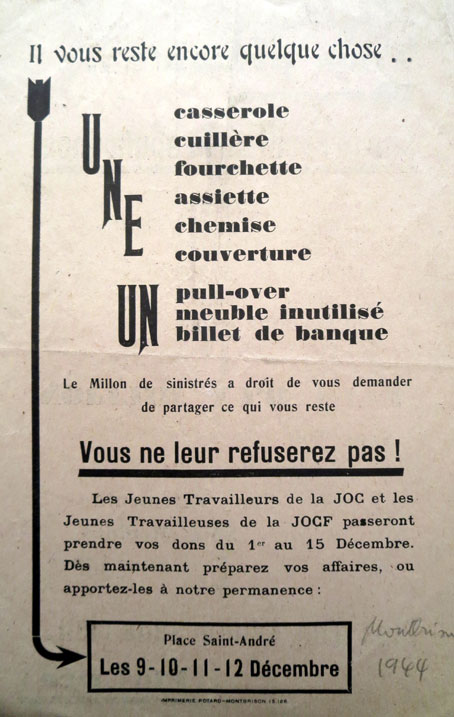
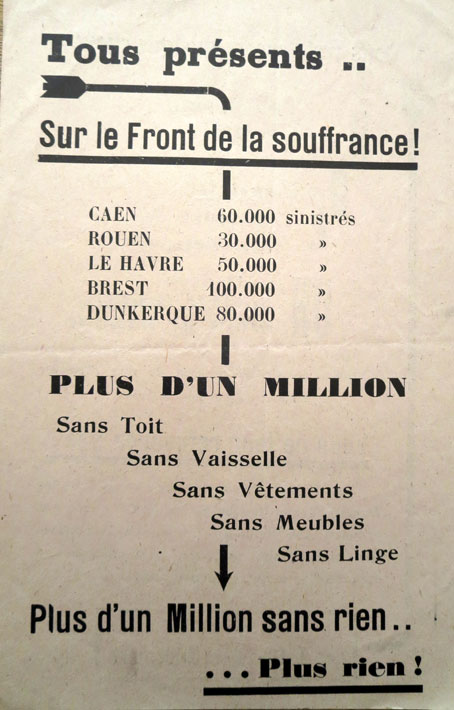
*
*
*
Pays
de Boën
Neufbourg et ses
compagnons

De
gauche à droite : Marius Durand, Pierre Merle, Charles Michel,
Alfred Petit,
Guy Courtin de Neufbourg, Pétrus Durand, Jean Merle, Claude
Michel (vers 1950)
(Extrait de Antoine
Cuisinier, "Marguerite Gonon parle... la Résistance
à Arthun,
Guy de Neufbourg", supplément de Village de Forez,
n° 81-82, 2000).

Château
de Beauvoir à Arthun
*
*
*
Mémorial des Résistants
de Boën
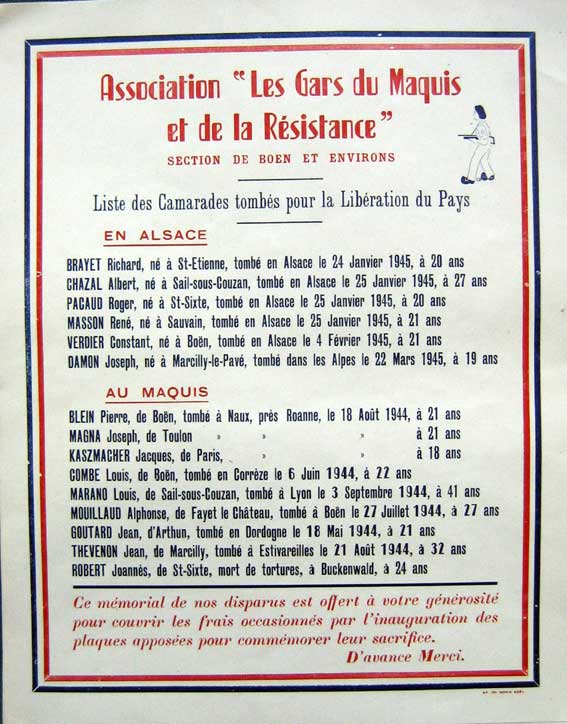
(affichette,
archives de la Diana, Montbrison)
*
*
*
Le
jour de la victoire

Le
Forez, les militaires, la guerre
textes
et documentation
Joseph Barou
questions,
remarques ou suggestions
s'adresser :
|
|
mise
à jour : 21 juin 2016
|
|
|