| |
De
comté de Cambridge au Forez
une famille britannique : les Covey
(1870-2009)

Edouard Harvey Covey
Du
comté de Cambridge aux haras de Fresnay-le-Buffard (Orne)
par
Marie Grange
Notre
terre forézienne est depuis longtemps le rendez-vous
de personnages historiques. Terre d'accueil, la plaine a la
faveur d'abriter de grands voyageurs qui ont désiré
terminer leur vie aventureuse dans les horizons calmes de notre
province. Elle est cernée de montagnes n'atteignant pas
deux mille mètres, les coteaux lyonnais, le Pilat mystérieux
et les monts du Forez qui sont si doux sous le ciel changeant.
Plus encore, certains, après leur vie, ont désiré
y reposer pour toujours. En cheminant dans nos cimetières,
nous y trouverons des noms, des noms prestigieux, des noms inconnus,
des stèles émouvantes, témoignages de vies
dont le destin s'est arrêté chez nous.
Magneux-Hauterive est la dernière demeure d'Édouard
Covey et de son frère Albert. Ces deux hommes sont issus
d'une famille britannique. Pourquoi sont-ils inhumés
en Forez ? Quelle est l'histoire de cette famille ?
Les deux frères ont suivi des chemins différents.
Elevés dans une famille anglaise installée en
France, en Espagne, puis à nouveau en France, les deux
frères ont suivi des chemins différents. Édouard,
né en 1900, se marie avec une Française dont il
a deux fils. Il conserve la nationalité britannique.
De ce fait, il participe au débarquement du 6 juin 1944
en Normandie. Albert, né en 1913, opte pour la nationalité
française. Il combat dans l'armée française
et se trouve grièvement blessé en 1939 dans la
Sarre.
Je connais la famille Covey depuis 1939. Elle est arrivée
dans le Forez en 1937. Les circonstances ont fait que Guy Covey,
l'un des fils d'Édouard Covey a vécu plusieurs
années chez mes parents à Boisset-lès-Montrond.
Depuis lors nous sommes liés d'une amitié réciproque
et il m'a demandé de bien vouloir l'aider à rédiger
une sorte d'histoire de sa famille. J'ai accepté avec
joie et beaucoup d'émotion. Nous allons ensemble présenter
ce parcours plein de péripéties à travers
l'Europe.
Nous sommes à Pane-Lane dans le comté de Cambridge
au nord-est de Londres, en Angleterre, vers 1870. Ici se trouvent
les haras et champs de courses de New-Market de renommée
internationale. Ces établissements réputés
disposent de plusieurs pistes, d'espaces de verdure, d'écuries
et de logements dont l'importance les place au premier rang
mondial. Dans ces lieux sont sélectionnés et entraînés
les meilleurs pur-sang anglais. Depuis longtemps l'Angleterre
se passionne pour la race chevaline. Les courses du Derby d'Epsom,
d'Ascott Heath, de Doucaster, de New-Market ont acquis leurs
lettres de noblesse.
Harvey, fondateur de la lignée des Covey, travaille en
qualité de stud-groom (garçon d'écurie)
à Pane-Lane à l'époque de son mariage avec
Julia Gent. C'est un garçon sec et nerveux, de taille
plutôt petite. Habillé en jockey, botté
et avec la selle sous le bras, il pèse tout juste 44
kg. Mais, bon professionnel, il obtient des succès dans
son métier et remporte même une victoire au fameux
Derby d'Epsom.
De son union avec Julia, Harvey Covey a un fils : Thomas Harry
Covey, né le 12 septembre 1877 à Pane-Lane. Thomas,
plus familièrement appelé Tom, a l'esprit d'aventure.
Il a suivi l'exemple paternel et s'occupe de chevaux mais change
plusieurs fois de région. Après une période
où il vit dans le Surrey (Grande-Bretagne) nous le retrouvons
en France à Lamorlaye, dans l'Oise, au nord-ouest de
Paris. Sur le territoire de cette commune se trouvent les haras
et le champ de courses de Chantilly où se disputent les
prix renommés de Diane et du Jockey-Club français.
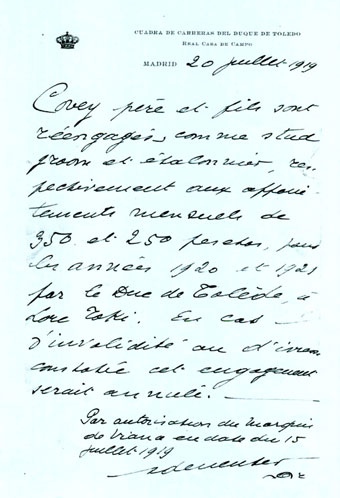
Engagement de Tom Covey et de son
fils Edouard
comme étalonniers dans les Ecuries royales d'Espagne
(20 juillet 1919) |
Tom
Covey est employé aux haras de Chantilly. Il fait
la connaissance d'une jeune orpheline de père :
Suzanne-Marie-Anne Delachasse. Cette jeune fille est née
à Coye-la-Forêt dans l'Oise, le 6 décembre
1880. Son père était mort alors qu'elle
était enfant et sa mère avait épousé
Jack Ellam, un jockey des haras de Chantilly.
Le 27 juillet 1899, Tom Covey épouse Suzanne Delachasse.
Il a 22 ans et sa jeune épouse 19 ans. Le contrat
de mariage est établi à Senlis le 28 juin
1899 devant Me Petit. Suzanne est mineure et dépend
de son tuteur, un oncle paternel. Les époux habitent
Lamorlaye. Ils ont quatre enfants :
- Édouard, né le 30 octobre 1900 à
Lamorlaye ;
- Suzanne-Marie-Anne, née le 10 septembre 1902
à Lamorlaye ;
- Julia-Anna, née le 18 septembre 1906 à
Montesson où sont les haras de Saint-Cloud ;
- Albert-Ernest, né le 20 août 1913 à
Villers-Faucarmont dans la Seine-Inférieure (aujourd'hui
la Seine-Maritime).
Suzanne Delachasse a évoqué quelquefois
sa jeunesse avec ses petits-enfants. Elle se rappelait
avoir vu le duc d'Aumale au cours de certaines festivités.
Pourquoi et en quelles occasions ? Beaucoup de questions
se trouvent sans réponse dans le déroulement
de cette histoire familiale pleine d'imprévus.
|
Tom
Covey et sa famille ont conservé leur nationalité
britannique. Le service militaire n'est pas obligatoire en Grande-Bretagne.
Tom aime le changement et les déplacements. Il ne reste
pas en France où s'annonce la Grande Guerre (1914-1918).
Il part pour l'Espagne avec sa femme et ses quatre enfants.
Il est engagé dans les écuries du roi d'Espagne
Alphonse XIII où il signe un contrat de stud-groom et
étalonnier. Il y a ainsi, parfois, une certaine proximité
avec la famille royale. Édouard se rappelait avoir joué
dans les jardins et sur les pelouses du parc avec les infants
: Jaime de Bourbon, Fernando de Bourbon et Alphonse, prince
des Asturies, l'héritier du trône d'Espagne. Les
écuries royales ont une grande importance. Rappelons
que depuis les guerres napoléoniennes le cheval andalou
avait été croisé avec le pur-sang anglais
donnant le remarquable cheval anglo-hispanique. Pour un professionnel
du cheval il y a de quoi être comblé. Le 20 juillet
1919, ce contrat est renouvelé pour 4 années pour
Tom Covey et son fils aîné Édouard qui a
alors 19 ans.
Le
document frappé de la couronne royale porte la signature
du duc de Tolède, titre que porte Alphonse XIII lors
de ses déplacements non officiels.
Après la seconde guerre mondiale, l'Espagne est secouée
par de graves troubles sociaux et politiques. La monarchie vit
une période très difficile. En 1921, Thomas Covey
et les siens sont à Hernani. Leur fille aînée
Suzanne-Marie-Anne meurt dans cette ville le 1er janvier, à
l'âge de 19 ans. Peut-être avait-elle contracté
la grippe espagnole qui sévissait alors dans toute l'Europe
occidentale ?

Tom
Covey
|
La
famille possède peu de photographies de Thomas Covey
et il est toujours représenté tenant un cheval
par le licol. Nous retrouvons les Covey, toujours sujets
de sa gracieuse majesté, aux haras de Fresnay-le-Buffard
près d'Argentan, en Normandie, au service du richissime
Marcel Boussac. Thomas reste-t-il longtemps dans cet établissement
? Nous savons seulement qu'en 1933 il habite dans l'Oise
où son épouse a des parents.
Son fils aîné, Édouard Covey habite
le village de Neuvy-au-Houlme, dans le bocage normand, près
d'Argentan et des haras nationaux du Pin qu'on appelle le
"Versailles des chevaux". Il est au service de
Marcel Boussac. En sa qualité d'étalonnier,
il a en charge la garde et le soin quotidien des trois plus
fameux étalons de cette écurie : |
-
Astérus, vainqueur en 1927 à New-Markett ;
- Ramus, vainqueur du derby français en 1922, prix du
Jockey club ;
- Tourbillon qui participe en 1922 au derby d'Epsom et qui est
l'un de ses meilleurs chevaux avec une nombreuse descendance
à travers le monde.
Les haras de Fresnay-le-Buffard
et Marcel Boussac
Marcel
Boussac était né le 17 avril 1889 à Châteauroux
dans une famille de drapier. Il réussit rapidement dans
les affaires - à 24 ans il possède "sa"
chemiserie à Paris et acquiert une grande fortune. Passionné
par tout ce qui touche au cheval il achète en Normandie
les haras de Fresnay-le-Buffard, du petit Tellier, de la Grand'Cour
et, près de Versailles, les haras de Jardy. Il achète
aussi l'hippodrome de Saint-Cloud où il dispose d'une
piste pour son avion personnel. Ses jockeys (casaque orange
et toque grise) remportent de nombreuses victoires sur les hippodromes
internationaux…

Haras
de Fresnay-le-Buffard (hiver 1928)
présentation du cheval Ramus par Edouard Covey

Tom Covey et son épouse Suzanne
; entre eux leur petit-fils Guy en 1932
à la ferme Comtesse aux Mureaux à côté
de Meulan ; la chienne Daisy, policier belge, mère de
Zokô
|
|
Édouard se marie le 25 novembre 1924. Il épouse
une jeune Normande : Fernande Grosos née le 18
septembre 1901 à Saint-Germain-de-Vasson (Calvados),
village où a lieu le mariage. Fernande est une
catholique pratiquante. Nous sommes ici tout proches de
Lisieux, village où a vécu née Thérèse
Martin - la petite Thérèse - qui vient d'être
canonisée. Le futur époux devient catholique.
Juste avant son mariage, Édouard est baptisé
et le lendemain fait sa première communion.
Les jeunes mariés s'installent dans la propriété
de Fresnay-le-Buffard. Ils disposent d'une coquette villa
dans un cadre fleuri où sont jalousement gardés
les princes de la race chevaline. Édouard connaît
son métier. La sélection est rigoureuse
tant pour le personnel que pour les animaux. Au confort
luxueux vient s'ajouter une minutie de tous les instants
et rien n'échappe au regard du "Maître",
Marcel Boussac.

Villa
de Fresney-le-Buffard où habitait Édouard
Covey dans la propriété des haras
|
Le
21 janvier 1933 Thomas Covey décède à Levallois-Perret
dans la région parisienne. Édouard désire
assister aux funérailles de son père. Il veut
aussi voir sa mère, douloureusement éprouvée.
Son amour filial est plus fort que les impératifs du
travail quotidien. Son absence sera très courte. Hélas,
le destin est parfois très pervers. Son chef est absent
et Marcel Boussac aussi. Il confie donc les étalons à
des palefreniers pour quelques heures, un jour peut-être,
sans avoir demandé l'autorisation. L'incartade est promptement
punie : Édouard et sa famille ont cinq jours pour quitter
les lieux. Et cela sans aucun recours.
Édouard Covey, Fernande et leurs deux enfants (Guy, 8
ans et Jean, 3 ans) vont trouver refuge à Cordey dans
le Calvados où vit la mère de Fernande. Elle les
accueille dans sa petite exploitation agricole avec tout son
amour maternel. Édouard est embauché dans un chantier
où il écorce des arbres à longueur de journée.
Il trouve bientôt du travail dans les haras de Fleuriel
où les écuries Céran-Maillard ont des trotteurs.
La Normandie est la terre d'élection du trotteur. On
y trouve depuis longtemps des haras réputés et
des propriétés importantes près des champs
de courses.
Le Forez, un peu en retard sur d'autres provinces, connaît
un épanouissement dans ce domaine au XIXe siècle
grâce, notamment, au marquis de Poncins, à Francisque
Balaÿ et au comte Palluat de Bessey. C'est de cette époque
que datent les hippodromes de Villars et de Feurs.
Les haras de Fleuriel sont situés dans la commune de
Fleuré (Orne). Guy, le fils aîné d'Édouard
fréquente l'école primaire du village. Il fait
sa première communion dans l'église de Fleuré
en 1936 et reçoit la même année le sacrement
confirmation dans la cathédrale de Sées. Toute
la famille Covey habite alors la ferme des Touches. Le destin
va se manifester à ce moment-là sous les traits
d'un Forézien : Victor Faurand. Ce propriétaire
éleveur de chevaux de courses est venu en Normandie pour
acheter des trotteurs. Il veut réaliser une "affaire"
et il a la bonne idée d'engager aussi le palefrenier,
en l'occurrence Édouard Covey. C'est ainsi que la famille
Covey arrive en Forez. Laissons maintenant à Guy Covey
le soin de continuer ce récit…

Suzanne Delachasse épouse de Tom Covey entourée
de son petit-fils Guy (1er à gauche),
de son fils Albert (2e), de Fernande épouse d'Edouard
(3e) et de son petit-fils Jean
Je
me souviens…
par Guy Covey
Je me souviens du départ de notre village de Fleuré,
en Normandie. Nous sommes à la gare d'Ecouché
près d'Argentan, dans un wagon à bestiaux. D'un
côté nous avons entassé tout notre déménagement
: mobilier, linge, vaisselle… De l'autre côté
du wagon, mon père a aménagé un enclos
délimité par des cordes pour les trois chevaux
qu'il devait transférer avec foin et eau nécessaires
à leur nourriture. Nous nous installons tant bien que
mal dans l'espace restant sans oublier Zokô, un chien
policier belge qui, après avoir fait son temps à
Fresnay-le-Buffard, s'était pris d'affection pour mon
père. Au moment de quitter la maison pour aller à
la gare, pas de Zokô !
En fait, il s'était posté près du camion
de déménagement, en fidèle gardien de nos
biens, et il nous attendait. Son intelligence et sa mémoire
étaient prodigieuses. Il a fini ses jours chez le maréchal-ferrant
de Boisset-lès-Montrond où la Providence m'a fait
arriver un matin du mois de septembre 1939.
Combien dura notre voyage ? Nous avons dû passer par Argentan,
le Mans, Tours, Vierzon, Nevers, Saint-Germain-les-Fossés,
Roanne, Montrond. Et le terminus fut la petite gare de Boisset-le-Cerizet.
Il fallait abreuver les chevaux. Nous couchions sur la paille
du wagon. Je me souviens des chocs des tampons des wagons dans
les gares de triage qui nous jetaient les uns contre les autres.
Mes souvenirs sont vagues et je n'ai pas conscience du temps
qu'il nous a fallu pour faire le voyage. En revanche je me souviens
très bien du café Caire à la gare de Boisset-le-Cerizet.
Aujourd'hui le café Caire est devenu le restaurant l'Écuelle
et la gare existe toujours. Le lendemain matin, avec tout le
contenu du wagon et accompagnés de Zokô, nous sommes
arrivés à Grangeneuve. C'était environ
à un kilomètre et demi de la gare, un domaine
au milieu des prés que Victor Faurand avait loué
à la famille Balaÿ pour y installer ses haras. En
face, les écuries Bedel créeront les Haras Antony
pour leurs trotteurs.
Nous avions là une maison d'habitation dans une grande
cour fermée où étaient répartis
écuries, boxes, remises, hangars. Un puits, dans la cour,
fournissait l'eau potable. Le cadre verdoyant rappelait un peu
la Normandie… En moins bien.
Le premier souci de mon père fut de me trouver une école.
J'avais douze ans et déjà pointait à l'horizon
de mon avenir l'examen du certificat d'études. Quelqu'un
suggéra à mon père qu'à Boisset-lès-Montrond
il y avait un instituteur dont les élèves avaient
de bons résultats. Illico, mon père m'emmena voir
monsieur Mouton, directeur de l'école publique du village
et secrétaire de mairie. "Dessine-moi un trapèze",
me dit-il en tendant une craie. Troublé, anxieux, je
me demandais bien ce que cela pouvait être. Je fus tout
de même inscrit à l'école.
Sur le chemin du retour mon père me fit une confidence
: "Si tu réussis au certificat l'an prochain, je
te donne mon vélo de courses !" Son vélo
de courses, le seul luxe qu'il possédait ! Cela donnerait
bien des ailes à n'importe quel cancre en 1937…
! J'en fus ému. Il ne pouvait vraiment pas faire plus.
Du coup je me sentis devenir un homme. Je fis de mon mieux et
en juin 1938, je réussis au certificat d'études
à Andrézieux ! Mon père n'avait plus de
vélo puisqu'il s'était démuni du sien ;
désormais, il fera ses courses avec une voiture attelée
d'un cheval dont il pouvait disposer à Grangeneuve.
J'ai de bons souvenirs de l'école de Boisset. Je m'y
suis fait des copains : Jean Recorbet, Marius Guillien, Henri
Frécon, Francette Méallier, Nanou Rivollier, Raymonde
Recorbet, Marie Gerin et son frère Antoine. Avec mon
frère, nous étions les seuls à venir à
l'école à vélo ce qui nous permettait de
rentrer pour le repas à la maison. À cette époque
tous les autres, qui faisaient trois kilomètres, apportaient
leur gamelle pour midi. Malgré notre accent normand qui
vaut bien le parler forézien et le patois de la plaine,
notre qualité "d'étrangers" au pays
et d'anglais ne me causa pas de complexe. Comment se termina
l'année 1938 ? J'ai dû savourer ma réussite
avec joie.
Les travaux des champs ne manquaient pas et les jeunes bras
étaient toujours les bienvenus aux foins, aux moissons,
au jardin. Je n'ai pas de souvenir important de cette époque.
En fin d'année un événement important vint
faire basculer ma vie. En 1938-1939, on ne restait pas inactif.
En entrant dans le monde adulte, il fallait travailler. On disait
: gagner son pain. Des bruits de guerre commençaient
à courir. Où devrai-je aller travailler ? M. Marmonnier,
le cuisinier du château de Sourcieux, connaissait un paysan
qui exploitait une ferme appartenant à monsieur Bernard
Deust à Jourcey, commune de Veauche.
Cette ancienne abbaye de femmes de l'ordre de Fontevrault était
depuis longtemps désaffectée. La chapelle que
les occupants avaient transformée en fenière avait
conservé son clocher carré. Les bâtiments
conventuels étaient aménagés en étables
et en remises. Les exploitants, aujourd'hui décédés,
avaient besoin d'un commis. C'était encore l'habitude
en 1938, dans la plaine du Forez, d'embaucher de grands ou de
petits enfants pour les travaux de la ferme. Souvent orphelins
ou issus de familles nombreuses, ils n'allaient à l'école
qu'en hiver, entre la Toussaint et Pâques, et encore…
Heureux étaient-ils ces pré-adolescents de trouver
une table accueillante, une soupe chaude et un lit pour dormir.
Mon premier placement se fit dans une ferme spécialisée
dans l'élevage bovin Simmenthal. Mon arrivée dans
cette ferme me pose question aujourd'hui. Pourquoi mon père
n'a-t-il pas pu m'accompagner ce lundi matin ? Où était-il
? Était-il trop pris par son travail ? Était-ce
tout simplement parce qu'il n'avait plus de vélo ? Toujours
est-il j'ai été amené, avec mon baluchon,
par le garde-chasse du château des Rayons de Chalain-le-Comtal.
Étant un ami de la famille, il s'est sans doute gentiment
proposé pour m'y conduire.
Bref, je dus dès le premier jour me familiariser avec
cette nouvelle vie de labeur. Mes patrons faisaient participer
les plus beaux spécimens de leur cheptel au comice de
Feurs. Pour que leurs animaux leur fassent honneur, je devais
les étriller, les brosser et leur laver la queue tous
les jours, à l'eau froide. Et en ce début janvier
1939 il gelait. Que cela fut dur pour moi. Je pris des engelures
énormes avec des crevasses qui saignaient, et rien pour
soulager ces gonflements rouges qui se renouvelaient tous les
jours plus forts. Pour dormir mes patrons m'avaient affecté
un réduit, une sorte de fournil où il y avait
la chaudière et des fagots. De gros bidons en fer où
on jetait les eaux grasses et les débris des repas supportaient
une planche. Une botte de paille me servait de matelas, de couverture
et d'oreiller. J'aimais l'odeur de la paille.
Je n'avais que le dimanche après-midi tous les quinze
jours pour retrouver mes parents. Devant l'état de mes
mains, ils me conseillèrent de tirer un seau d'eau la
veille et de la laisser passer la nuit dans l'étable
où elle tiédirait. Hélas ! Le premier geste
de mon patron fut de jeter cette eau et de m'envoyer chercher
un seau plein d'eau froide. J'étais un adolescent rebelle
et combatif et je ne restais que deux mois et dix jours dans
cette ferme. Le 10 mars je revins chez mes parents avec mon
sac, bien décidé à chercher autre chose.
Je ne cherchais rien… les bruits de guerre se rapprochaient.
La France alliée avec la Grande-Bretagne se demandait
comment juguler la pression des armées allemandes. Déjà
l'Autriche, puis la Pologne, la Belgique… sont les victimes
d'Hitler. Mon père était anglais. Il se devait
de rejoindre l'armée britannique. Et nous, qu'allions-nous
devenir loin de la Normandie où était toute notre
famille ? Cruel dilemme pour mes parents. Ma mère n'avait
aucun emploi, de quoi allions-nous vivre ? Comment nourrir les
deux enfants qu'il allait laisser ? Un instant, mon père
songea à nous envoyer dans les Dominions . Là,
au moins, nous serions à l'abri. Ma mère s'y refusa,
elle ignorait tout de la langue anglaise. Déjà
certaines familles quittaient les provinces proches de la Belgique
et de la ligne Maginot. Notre oncle Albert, le frère
de mon père, sursitaire depuis 5 ans, s'engagea dans
l'armée française. Incorporé à Metz
au 30e régiment de dragons, il participa en 1939 aux
combats de la Sarre où il fut grièvement blessé.
Malgré tous mes efforts de recherche j'ai une notion
complètement opaque de cette époque. Tant de questions
! Tant d'hésitations et de crainte ! Mon frère
Jean était en vacances en Normandie en 1939. Où
était mon père ? Ma mère faisait la cuisine
pour les ouvriers agricoles qui travaillaient pour Victor Faurand
en échange du loyer de la maison que nous occupions à
Grangeneuve. Le 22 août 1939 la Providence vint à
mon secours sous les traits de la fille du maréchal-ferrant
de Boisset-lès-Montrond.
Cet artisan, André Gagnère, était un ancien
combattant de 1914-1918. Il tenait une échoppe de forgeron
et de maréchal-ferrant dans le village. Il avait également
une petite exploitation agricole avec deux chevaux et sept vaches.
Monsieur Gagnère avait trois filles : Edith, l'aînée,
18 ans, Marie, la cadette, 16 ans et Myriam, la plus jeune,
9 ans. Et pas de garçon : aussi aimait-il la présence
d'hommes, même jeunes pour l'aider dans ses multiples
activités. Il était affligé d'un bégaiement
permanent ce qui était terriblement stressant pour lui.
Il en était devenu taciturne et bourru.
J'entrai chez les Gagnère dès le lendemain de
l'entrevue entre ma mère et la fille du maréchal.
Madame Gagnère me prit en affection et se montra toujours
très maternelle pour moi.
Du
printemps 1940 à juillet 1942
Ma vie, dans ce contexte artisanal, agricole et familial, me
procura un dépaysement certain. Le travail était
constant, tantôt à l'étable et aux champs,
tantôt à la forge… J'étais sollicité
par une extrême variété de travaux et mon
patron était d'une grande exactitude. J'allais voir ma
mère tous les dimanches… Et là je me demandais
toujours : "Que faisait donc mon père entre octobre
1939 et mai 1940 ?" Une petite lueur survient en me rappelant
qu'à cette époque mon père avait la charge
d'un étalon de Victor Faurand nommé N'y-touchez-pas.
Il le promenait tous les jours sur la route qui relie Grangeneuve
à Boisset-lès-Montrond. L'élégance
de ce trotteur à la robe grise ne pouvait passer inaperçue
et l'attelage fut remarqué à plusieurs reprise
sur ce trajet. C'est donc bien que mon père travaillait
toujours en Forez pour le même patron.
Au printemps 1940 la population du nord de la France sentait
que la drôle de guerre n'était pas drôle
du tout. Dans un sentiment patriotique toujours présent
mon père nous fit ses adieux et quitta son foyer. Je
ne peux décrire ce départ tant ce fut douloureux
pour tous. Pour ma mère surtout. Qu'allait-elle devenir
sans un emploi sûr, à la merci de l'inconnu ? Et
nous deux, Jean encore bien jeune, 10 ans et moi, 15 ans ! Où
irait notre soldat ?
Le 14 mai 1940 Édouard Covey est à Paris. Il signe
sa feuille de recrutement au consulat britannique. Devant Dieu,
il prête serment de fidélité et d'obéissance
à Sa Majesté le roi Georges VI et à ses
héritiers et descendance. Le consulat britannique ratifie
cet engagement solennel. Édouard Covey est désormais
engagé "sur l'honneur" dans l'armée
britannique. Il reçoit un ordre de départ, valide
du 15 au 17 mai 1940 pour rejoindre Londres.
Comment est-il parti ? Ce 5 août 2009, un cousin, René
Boscher, le fils de tante Julia est venu nous voir. Longuement
nous avons songé à cette période. Lorsque
mon père eut signé son engagement dans le Pionner
Corps il alla faire ses adieux à sa mère et à
sa sœur. René était présent. Édouard,
mon père, leur dit : "Albert avait opté pour
la France, il a payé son tribut. Je suis anglais, je
ne me déroberai pas à mon devoir patriotique.
Je pars pour la délivrance de mon pays." Ce soir-là,
les adieux furent douloureux. Mon père devait être
à Lyons-la-Forêt dans l'Eure d'où il rejoignit
un port de la côte française pour s'embarquer vers
l'Angleterre.
L'engagement
(14 mai 1940)
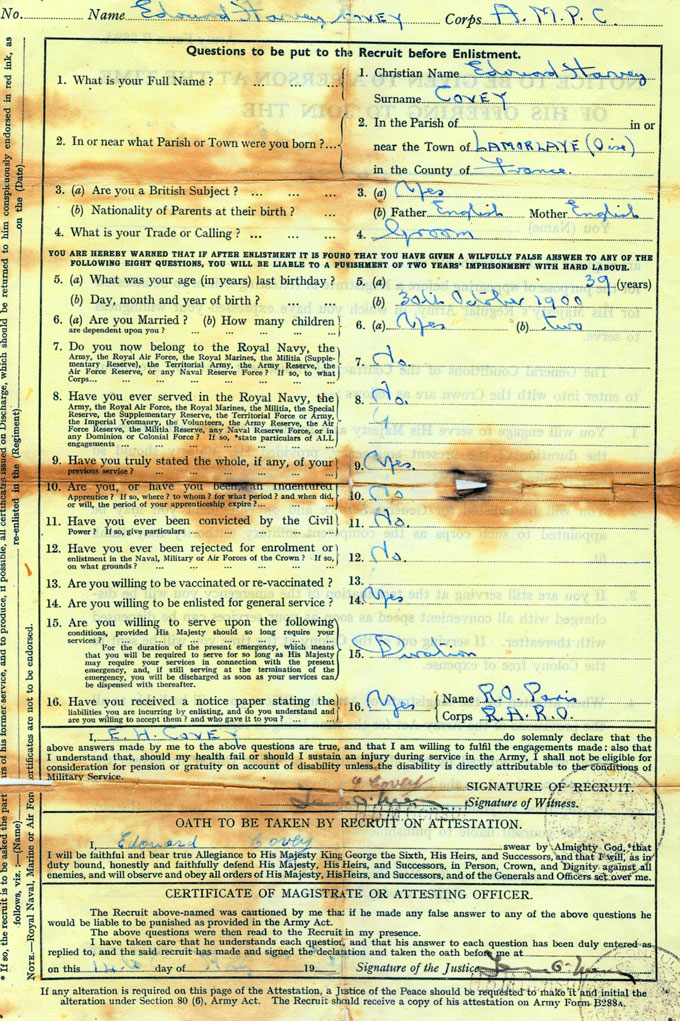

Certainement
l'une des premières photos prides en Angleterre
Edouard Covey est assis et porte la moustache

Edouard Covey, debout le 1er à gauche,
après son incorporation en Angleterre

Edouard Covey au 2e rang, 2e en partant
de la droite,
dans un groupe du 139e Pionner Corps.
Sur ces différentes photos, on remarque l'air soucieux
d'Edouard Coyey.
Sans doute pensait-il à sa famille
À
la fin de mai 1940, ma grand-mère paternelle Suzanne,
son fils Albert grièvement mutilé, sa fille Julia
avec son mari et ses enfants vinrent se réfugier à
Grangeneuve auprès de ma mère. En tout sept personnes
de la région parisienne vinrent partager notre toit.
Les armées allemandes arrivaient et les populations du
Nord commençaient à quitter leurs villes.
Nous avons reçu une ou deux fois des nouvelles de mon
père. Nous n'avons aucun souvenir de ces lettres. Seule
nous reste une photo de mon père en militaire au dos
de laquelle est écrit : "À ma Fernande chérie
et à mes chers enfants, le 23 janvier 1941, É.
Covey." Je ne sais pas précisément à
quelle date nous l'avons reçue. Nous avons su aussi que
lors de son séjour en Angleterre il avait été
affecté au déblaiement de Londres que les bombardiers
allemands pilonnaient constamment. S'il a eu une ou deux permissions
il n'a pas pu, sans doute, renouer des liens avec la famille
Covey. Nous avons connu et entendu parler de notre parenté
en Grande-Bretagne : l'oncle Jim, la tante Célina, une
nièce, Emily Covey.
Pendant les mois de mai et juin 1940, ce fut "la débâcle"
aux Pays-Bas, en Belgique, le nord de la France, la Picardie,
la région parisienne, la Bourgogne. Une peur collective
s'empara des villages. Les gens déménageaient
en toute hâte et fuyaient en abandonnant leurs maisons.
Mon oncle Albert vint me chercher chez mes patrons pour gagner
l'Auvergne où il espérait se cacher. Étant
soldat français, bien que blessé grièvement,
il aurait pu être interné dans un camp de prisonniers.
Tant de bruits couraient alors. Nous sommes partis tous les
deux à vélo. Par Saint-Bonnet-le-Château,
Usson, Pontempeyrat, Craponne, Loudes, nous envisagions d'arriver
dans le Vivarais pour échapper à la captivité.
Nous sommes restés dans la région d'Arlempes au
lieu-dit Fourches grâce à l'hospitalité
d'un cultivateur, M. Belledent.
Lorsque je suis revenu à Boisset-lès-Montrond,
j'y ai retrouvé ma place et mes occupations. Un événement
considérable était arrivé pendant mon absence.
Un train entier bondé de plusieurs milliers de réfugiés,
en provenance de Montereau dans l'Yonne, avait été
mis en garage à Boisset-le-Cerizet. Ces malheureux de
toutes conditions chassés de Laumes-Alésia près
de Dijon avaient été mitraillés dans leur
fuite par les avions allemands. Arrivés en masse, ils
se ruèrent sur les petites épiceries du village.
Toutes les maisons vides avaient été réquisitionnées
pour leur trouver un toit. J'arrivai ici alors que des dispositions
avaient été prises pour les rapatrier. Je retrouvai
ma chambre qui avait hébergé pendant trois semaines
une famille de cheminots.
À partir de la signature de l'Armistice le 22 juin et
de l'établissement de la ligne de démarcation
qui coupait la France en deux, l'instabilité de notre
situation s'aggrava. Mais nous n'avions pas encore vu le pire.
Mon petit frère fut rapatrié de Normandie par
la Croix-Rouge avec une étiquette au cou portant son
nom et l'adresse de ma mère à Chalain-le-Comtal.
Nous avions un poste de radio à la maison, bien caché
dans le bas du buffet de la cuisine. Dès le soir tombé,
nous l'écoutions religieusement parce qu'on y captait
Radio-Londres. Chez mes patrons il n'y avait pas de poste de
radio.
De
rares nouvelles du soldat Edouard Covey
La première
photo d'Edouard Covey en provenance d'Angleterre
format carte postaale, dédicace au revers

Message
transmis par la Croix-Rouge
Année
1942
par
Marie Grange
Les familles Covey et Gagnère ont été
concernées par les événements qui se
sont déroulés à Boisset-lès-Montrond
en 1942. Les faits décrits ont eu lieu en juillet 1942
et, providentiellement, la France ne fut occupée entièrement
qu'en novembre de cette même année. Autrement
les représailles auraient pu être terribles pour
plusieurs d'entre nous.
Il s'agit du premier parachutage en Forez. Cet événement
dramatique eut lieu à Grézieux-le-Fromental
aux abords du domaine agricole de la Chaux. Dans la nuit du
24 au 25 juillet, une belle nuit où la lune baignait
l'obscurité, un avion tourna plusieurs fois au-dessus
d'immenses pâtures qui n'étaient pas bornées
de piquets. C'était un ancien terrain pour le vol à
voile utilisé de 1935 à 1939. Un des parachutistes
fut grièvement blessé et ses compagnons alertèrent
le curé du village de Boisset-lès-Montrond.
Celui-ci secourut le mourant et s'occupa des décisions
à prendre tandis que les autres parachutistes essayaient
de prendre le large. Le blessé fut conduit par la famille
Joassard à l'hôpital de Montbrison. Le procureur
de la République fut prévenu qu'une rixe mortelle
avait probablement eu lieu.
Ce matin-là, à Boisset, Guy Covey aidait mon
père à ferrer un cheval, au tournant de la route,
en plein village. Il était environ sept heures du matin.
Il vit deux hommes jeunes, portant de lourdes valises, hésiter
en face de la boulangerie Gouttefarde. Intrigué par
ces inconnus et par leur comportement bizarre, inhabituel
dans une commune paisible, Guy les suivit sur la route de
la Terrasse. Qui était ces hommes ? La radio évoquait
parfois l'envoi de parachutistes, on commençait à
parler "de la Résistance". Et si ces hommes
connaissaient son père ? Il ne parla de rien bien sûr.
Le lendemain, un dimanche, mon père fit conduire les
vaches dans un morceau de ces prés qui étaient
traversés par un fossé de drainage nommé
"le Gand". Ses eaux assez tranquilles abondaient
en grenouilles. Et là, Marc Petit, un jeune garçon
qui était chez mes parents, découvrit cachés
sous un petit pont qui franchissait le cours d'eau, un parachute
en soie vert et marron, une combinaison, un casque amortisseur,
un couteau à cran d'arrêt. Complètement
abasourdi devant ces trouvailles, il chargea le tout sur son
vélo et arriva triomphant au village en fin de soirée.
Avec l'aide de Guy Covey Marc Petit étala le parachute
dans la cour, et tous les passants, curieusement s'interrogeaient
sur cette exposition inexplicable !
Je suis allée prévenir le curé du village
qui avait dit être témoin de l'agonie d'un inconnu.
Il arriva aussitôt chez nous, nous fit ranger immédiatement
ces objets et prévint la gendarmerie. Le lendemain
matin les gendarmes arrivèrent à Boisset et
ce fut le début d'une enquête pleine de péripéties.
Par ignorance et naïveté nous étions au
cœur d'un fait-divers dont les conséquences pouvaient
être très dangereuses. Nous étions inconscients.
Nous avions chez nous le fils d'un soldat britannique qui
était, peut-être, dans les rangs de la Résistance.
Et nous nous étions permis de montrer à tous
des objets venant d'un parachutage ! Si cet événement
avait eu lieu après la suppression de la ligne de démarcation
peut-on imaginer les conséquences qui pouvaient en
résulter.
L'enquête débuta très rapidement. Après
les interrogatoires de rigueur à la maison puisque
c'est nous qui avions "trouvé" les pièces
à conviction, les soupçons se fixèrent
sur Guy Covey. Évidemment, c'était le suspect
rêvé. Par deux fois il fut interrogé au
café Touron, en face de chez nous, une première
fois par les gendarmes, une deuxième fois par des agents
de la Gestapo. Guy fut ensuite conduit à la prison
de Montbrison et enfermé dans une cellule. On lui demanda
ensuite s'il reconnaissait des suspects qui avaient été
arrêtés. Bien sûr il ne reconnut personne.
L'abbé Clouye, curé de Boisset, qui avait été
aumônier de la prison de Montbrison, intercéda
pour qu'on libère le jeune Anglais. Il était
totalement hors de cause.
Ces faits ont été racontés plusieurs
fois. Mais a-t-on pensé aux grandes inquiétudes
qu'a dû souffrir l'épouse d'Édouard Covey.
Elle était isolée dans la ferme de Grangeneuve
avec son plus jeune fils et ne pouvait se déplacer
qu'avec un laissez-passer délivré par la mairie
de Chalain-le-Comtal. Elle a passé de terribles journées
à se demander quel avenir serait réservé
à ses enfants, à son mari, à elle-même.

La belle charpente de Grangeneuve
|

Gare de Boisset-lès-Montrond
|

L'église de Boisset-lès-Montrond
|

Zone d'atterrissage du 24
juillet 1942
|
Les
années noires
par
Guy Covey
Pour
chaque déplacement ma mère devait faire 3 km
pour aller chercher son laissez-passer et 3 km pour revenir
de la mairie, à pied, bien sûr. Un jour, pour
se rendre à Montbrison elle décida de passer
outre et prit le car au Cerizet. Les cars étaient toujours
archi-bondés avec autant de voyageurs debout que de
personnes assises. L'aller se passa bien. Au retour, deux
Allemands firent monter tous les voyageurs puis ils fermèrent
les portes et procédèrent à la vérification
de l'identité de chaque personne. Ma mère s'était
mise au fond du car. Par bonheur, en raison de l'entassement
des gens les contrôles furent rapides. Un coup d'œil
et le Gut rassuraient les gens. Ma mère présenta
son livret de famille en dissimulant sa carte d'identité
pliée en accordéon parce qu'elle devait mesurer
un mètre ! La Providence était là…
et le retour se fit sans encombre.
La guerre et l'occupation continuaient. Le couvre-feu fut
obligatoire. Des contrôles avaient lieu et on devait
soigneusement éviter toute lumière visible du
chemin. Il y avait des Allemands qui patrouillaient partout,
jour et nuit. Soupçonnés d'appartenir à
la Résistance et de communiquer avec les Forces libres
à cause de notre nationalité anglaise nous avons
subi plusieurs fois des fouilles en règle… chez
nous. C'était toujours pendant la nuit. Vers minuit,
une heure du matin, à grand bruit, on frappait à
la porte. Qui est-ce ? demandait maman. Ouvrez ! Vite…
! Maman ouvrait la porte fébrilement : Si c'était
lui ? On ne sait jamais, pensait-elle. Les soldats allemands
écartent brusquement maman et fouillent la maison de
fond en comble.
- Qui cherchez-vous ?
- Nous cherchons Édouard Covey.
- Il n'est pas là.
Et ils repartent. Nous restons tous sans voix. Une autre fois,
même bruit, même scénario. Maman tremblant
de peur demande :
- Mais enfin que voulez-vous ?
- Nous cherchons Édouard Covey.
- Pourquoi ?
- Nous devons l'emmener à la Kommandantur à
Saint-Étienne.
Complètement perdue ma mère leur crie alors
:
- Et bien, allez le chercher, il est à Londres !
Elle était tellement anxieuse et troublée que
cela impressionna ces militaires. Ils firent preuve d'humanité
et ne revinrent plus nous tourmenter avec leurs perquisitions.
Je me demande aujourd'hui comment elle a pu surmonter tant
d'angoisses renouvelées ! Tant de représailles
auraient pu survenir. Comment avons-nous échappé
à l'emprisonnement ? La Providence, j'en suis persuadé,
était là.
Bien plus tard, je me souviens, mais sans savoir le jour exact,
une voiture de la Croix-Rouge entra dans la cour à
Grangeneuve. Les Allemands étaient alors refoulés
vers la Belgique. Nouvelle inquiétude pour maman. Qui
est-ce ? Que me veulent-ils encore ? Après vérification
d'identité, enfin une bonne nouvelle ! Il s'agissait
d'un message de la Croix-Rouge de Genève daté
du 26 septembre 1943 : "Je vais bien, j'ai reçu
de vos nouvelles." Enfin ! Il est vivant, quel bonheur
! Nous nous rendons compte qu'il y a trois mois que ces nouvelles
fraîches sont parties de
Londres. Nous avons pu, par le même biais de la Croix-Rouge
via Genève lui transmettre une lettre et un petit colis.
Merci à tous ces correspondants de la Croix-Rouge,
quel soulagement ils apportent dans les épreuves terribles
du monde cruel et indifférent.
Chaque jour, en sourdine, Radio Londres crépitait dans
le silence de la maison. C'est par elle qu'un jour la grande
nouvelle est parvenue : "Ils ont débarqué
en France ! Et en plus en Normandie, le pays natal de toute
notre famille… Dans notre joie une question nous revenait
sans cesse : "Peut-être y était-il ?"
Eh bien oui ! Il y était. C'est dans le Calvados, entre
Arromanches et Asnelles, dans la 1re division canadienne commandée
par Montgomery que mon père a été mis
à l'eau pour pouvoir enfin fouler le sol français…
! Mais nous ne le savions pas. Il a fallu attendre de longs
mois pour en avoir la confirmation. Après avoir fait
la campagne de France, de Belgique et Hollande, notre soldat
obtint la permission de venir en France voir sa famille qu'il
avait quittée en 1940.
Avant
le débarquement


Message du général Crerar aux troupes canadiennes
avant l'opération Overlord
La longue marche vers la Libération
À
ce jour (juillet 2009) je n'ai que peu de renseignements précis
sur le parcours du soldat Édouard Covey. Le 14 mai 1940,
il s'engage pour la durée du conflit dans les troupes
britanniques de Sa majesté Georges VI.
Insigne du Royal Pioneer Corps Des indices indiquent qu'il sert
dans le génie où il participe au déblaiement
de Londres profondément frappée par les continuels
assauts des bombardiers allemands. Il est affecté dans
le Pioneer Corps où sont entraînés les hommes
qui vont participer au débarquement. Ce corps a joué
un rôle essentiel pendant la seconde guerre mondiale et
s'est particulièrement illustré au cours du débarquement
de Normandie. En février 1950, en reconnaissance des
services rendus, par décret du roi Georges VI, il devient
le Royal Pioneer Corps. Sur son béret kaki, Édouard
Covey portait son glorieux insigne.Édouard Covey fait
partie de la division canadienne qui veut venger les morts de
Dieppe. Il ne débarque pas le jour J , le 6 mai 1944,
mais le surlendemain matin. Comme ses camarades il sera jeté
à la mer à partir d'un de ces canots poussés
par la marée montante, sous une pluie diluvienne. Casqués
et le fusil à bout de bras, les soldats sont chargés
d'un équipement impressionnant. "Ici, dira le colonel
Taylor, il n'y a que deux catégories d'hommes : ceux
qui sont morts et ceux qui vont mourir." Bayeux est libéré
le 8 mai.
Les soldats qui débarquent ont la surprise de constater
que la population civile n'a pas été évacuée.
Des habitants émergent des caves apportant leurs dernières
bouteilles de Calvados aux libérateurs parmi lesquels
bon nombre sont d'origine française.
Le temps de la séparation est long, très long
pour cette famille déchirée. Pensons un peu à
toutes les familles déchirées à cette époque,
à notre époque, de quelque bord qu'elles soient.

Insigne du Royal Pioneer Corps
Le retour
Lorsque
la grande nouvelle du débarquement nous est parvenue
grâce à la radio une joie immense s'est emparée
de nous. Mon père était parmi les troupes débarquées.
C'est à Asnelles qu'il a été mis à
l'eau pour enfin fouler le sol français mais il nous
a fallu attendre de longs mois pour en avoir la confirmation.
Enfin arrive une permission pour le soldat Covey après
avoir quitté sa famille depuis plus de cinq ans ! Mais
là… se place un événement tellement
dur qu'il nous a semblé être complètement
abandonnés par la Providence.
Pendant que mon père s'acheminait vers la France en septembre
1945, Maman, Jean et moi, nous partions pour la Normandie revoir
- avec quelle hâte - ma grand-mère maternelle,
tous nos oncles, tantes et cousins… Immense fut notre joie
de les retrouver tous en bonne santé. Ils avaient subi
l'occupation et tant de privations, de bombardements, de destructions
: Argentan, Falaise, Caen… C'était là qu'ils
habitaient… Pendant deux ou trois jours ce fut un bonheur
sans nuages. Un matin arrive un télégramme : "Suis
en permission à Chalain-le-Comtal pour 6 jours."
Ce télégramme avait trois jours pour nous parvenir.
Comment allions-nous faire pour rejoindre le département
de la Loire… en 3 jours ! Pas d'essence ou si peu, pas
d'argent pour prendre un taxi. Encore aurait-il fallu en trouver
un !
Après beaucoup de tracasseries et d'efforts incroyables,
tantôt en train, un peu en camion ou en auto-stop quelquefois
en car et même à pied, nous avons voyagé
tous les trois pour rejoindre notre maison. Nous dormions à
même le sol, une nuit nous avons été hébergés
dans un asile d'aliénés. Nous avons fait de nuit,
à pied, les derniers kilomètres depuis la gare
de Montrond en traînant nos valises. Si proches du but
nous étions fiévreux et angoissés en nous
posant toujours la même question : "Y sera-t-il ?
Aura-t-il pu nous attendre ?"
Arrivés à environ 700 m de la maison, là
où finit la route et où commence le chemin, maman
me souffle : "Va voir, sans bruit, s'il y est." Je
posai mes valises et me mis à courir. Tout était
noir. La défense passive ordonnait qu'aucune lumière
ne puisse s'apercevoir du dehors. On mettait des couvertures
pour obstruer les fenêtres sans volets… Par un petit
trou de la couverture mitée, j'aperçus mon père
dans la cuisine. Vite, vite, je retournais vers maman et Jean.
Nous laissons nos valises dans les ornières du chemin.
Ce n'est pas grave puisqu'il est là ! Et nous nous précipitons
vers Papa.
Nous
tournerons la page sur cette histoire d'amour
Car ce serait violer l'instant des retrouvailles
Nos mots sont impuissants à décrire ce retour
Nous dirons simplement l'angoisse des batailles.
Ce soir-là mon père prit le risque de rallonger
sa permission de quelques jours. Lors de son retour aux armées
son commandant lui déclara avec bienveillance : "Je
me doutais bien que tu prendrais quelques jours de plus !"
Cette courte phrase de la part d'un supérieur de l'armée
montre que les sentiments d'humanité et de fraternité
peuvent exister malgré la rigidité du règlement.
C'est à la fois admirable et réconfortant.
Mon père contracta une pneumonie qui le fit revenir à
la maison pour plus d'un mois. Grâce aux soins du docteur
Bartholin de Montrond qui vint toujours gratuitement le visiter,
il acheva cette période noire sans séquelles.
Merci de tout cœur au docteur Bartholin.
J'ai écrit ces pages pour honorer la mémoire de
mon père Édouard Covey qui n'a jamais sollicité
ni reçu aucune reconnaissance de la nation et aussi pour
montrer le dévouement conjugal et maternel de ma mère
qui a su assumer courageusement cette douloureuse séparation.

Une des dernières photos d'Edouard Covey
décédé à l'hôpital de Montbrison
le 29 juin 1984
Hommage
à Édouard Covey
lors de ses funérailles le 2 juillet 1984
par le président des anciens combattants de Montrond
Un douloureux devoir nous réunit aujourd'hui,
conduire à sa dernière demeure un camarade, un
ami. Édouard Covey vient, à 84 ans, de quitter
ses compagnons anciens combattants.
Nous l'avons connu et estimé. Nous admirions son allant,
son héroïsme, un chemin jalonné de grands
principes, ceux du courage, de l'honneur, du sacrifice total.
Engagé volontaire pour la durée de la guerre,
en mai 1940 il rejoint Londres. Affecté dans le génie,
missions dures, dangereuses, rien ne le rebutait. Il était
toujours prêt, et à toutes les heures.
Le 6 juin 1944, débarquement sur les sables de Normandie
"Arromanche". A l'aube du 6 juin une mer constellée
de navires, 5 000 bâtiments de tout tonnage, la plus grande
flotte de l'histoire, 11 000 avions se dirigeaient sur la mer
de l'Atlantique. Américains, Britanniques mettent le
pied sur le sol français et se lancent à l'assaut
des postes ennemis : des pages sanglantes, des pages héroïques,
"le jour le plus long". Et bien Édouard Covey
y était.
Ensuite direction la Belgique, puis la Hollande et, pour terminer,
l'Allemagne.
Démobilisé il entre en France en novembre 1945
pour retrouver sa famille, ses amis.
L'assistance nombreuse aujourd'hui est là pour prouver
de quelle estime monsieur Covey était entouré.
Puissent ces marques de respect et d'affection que lui apportent
une dernière fois tous ceux qui l'ont connu et aimé
[adoucir un peu la peine des siens].
À M. et Mme Guy Covey, M. et Mme Jean Covey, leurs enfants
et petits-enfants, à toute votre famille, nous adressons
nos sincères condoléances et notre fidèle
amitié.
Quant à ses camarades anciens combattants, ils conserveront
longtemps le souvenir de l'ami qui s'en va.
Je signale qu'Albert Covey, hospitalisé à l'hôpital
de Feurs depuis le 2 février, et qui vient de subir sa
onzième intervention chirurgicale, regrette, avec beaucoup
de peine et de chagrin de ne pouvoir accompagner son frère
à sa dernière demeure.
Montrond-lès-Bains
le 2 juillet 1984.
Le
président : Germain Séon
*
*
*
L'histoire
de la famille britannique dont il est question dans ces pages
nous intéresse surtout à cause du parcours atypique
d'Edouard Covey. Engagé à 40 ans dans le Pioneer
Corps, il participe au débarquement en 1944. C'est avec
une unité canadienne qu'il met le pied sur le sol de
France à Ver-sur-Mer, proche de Courseulles-sur-Mer,
en Normandie.
Son parcours a été retrouvé grâce
aux recherches de Nathalie Worthington, conservatrice du musée
Juno Beach. Nous sommes allés au musée en cet
été 2010 et nous avons vu les "passeports"
destinés aux visiteurs. Ces documents nous disent les
dangers affrontés par les soldats qui nous ont libérés
et leur courage…
Nous avons découvert avec émotion un peu de la
vie d'Edouard et de ses camarades de combat…
*
*
*
Pélerinage
en Normandie



Guy
Covey et son épouse Paul
et Marie Grange

Réception du Ministre d'Etat canadien des Anciens Combattants,
au mois d'août 2010
en présence d'un vétéran du débarquement
N°
68
des Cahiers de Village de Forez
(octobre 2009)
publié par le Centre social de Montbrison
Les
publications de Village de Forez
sont disponibles au Centre social
13, place Pasteur, 42600 MONTBRISON
04 77 96 09 43
centresocial.montbrison@laposte.net
http://csmontbrison.free.fr
Mis
à jour le 5 novembre 1010
|
|
