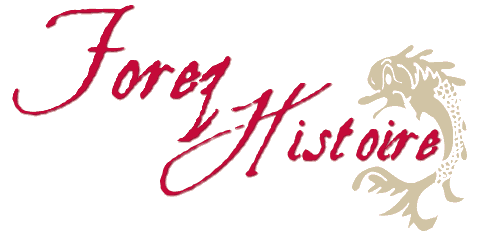
|
|
| |

Le
temple de Montbrison
Un lieu de mémoire et de vie :
la chapelle Sainte-Anne au temple de Montbrison
Joseph
Barou - Claude Latta
-
1 -
L'église
et la paroisse Sainte-Anne
de Montbrison
par
Joseph Barou
I.
Sainte-Anne, chapelle de l'hôtel-Dieu et église
paroissiale
Fondation
de l'hôtel-Dieu Sainte-Anne
A la fin du XIe siècle, avant de partir pour la croisade,
le comte de Forez Guillaume III fonde un hôpital pour
les " pauvres passants " dans l'enceinte de son
château de Montbrison. Au siècle suivant, la
ville, qui est devenue la capitale du comté, se développe
entre le château comtal et le Vizézy, autour
de l'église Saint-André. Vers 1215, l'hôpital
est transféré sur la rive sud de la rivière,
près du Grand chemin de Forez, sur le territoire
de la paroisse de Moingt qui s'étend alors jusqu'à
la rivière.
Dix ans plus tard, le comte Guy IV fonde, tout près
de l'hôpital, l'église collégiale Notre-Dame.
Autour de ces deux établissements se forme un nouveau
quartier modestement peuplé. L'hôtel-Dieu possède
une petite chapelle, Sainte-Anne, située au bord
du Vizézy et un cimetière.
En 1428, la ville est entourée de
remparts. Les Montbrisonnais habitant au voisinage de l'hôpital,
entre le Vizézy et la porte de Moingt, sont des paroissiens
de Moingt. Ils se trouvent coupés de Saint-Julien,
leur église paroissiale située à une
demi-lieue. Ils prennent l'habitude d'utiliser la chapelle
de l'hôpital comme église paroissiale. Ainsi
la chapelle Sainte-Anne continuant à desservir l'hôtel-Dieu
devient aussi, en fait, église paroissiale annexe
de celle de Moingt. Cette situation particulière
entraîne, au cours des siècles suivants, une
kyrielle de difficultés.
Les
recteurs de l'hôtel-Dieu contre le curé de
Moingt
Les recteurs de l'hôpital utilisent Sainte-Anne comme
la chapelle privée de l'établissement. Ils
font des modifications à leur guise. De son côté
le curé de Moingt s'efforce de faire valoir ses droits
curiaux. Enfin, le chapelain de Sainte-Anne, qui est désigné
par le chapitre de Notre-Dame, cherche à affermir
sa prébende en face de l'une et l'autre des parties.
Il s'ensuit des frictions. Une sorte de guerre d'usure s'installe,
coupée, de temps à autre, par des arrangements.
En 1429 intervient une première transaction (1) entre
le recteur et maître de la maison de l'hôpital
de Sainte-Anne de Montbrison et le curé ou vicaire
de la chapelle de l'hôpital :
Pour éviter
les contestations mues et éviter celles qui pourraient
survenir... Il est dit que ledit recteur et maître
dudit hôpital recevra et percevra toutes les oblations,
aumônes et autres droits qui seront offerts en mémoire
des reliques de ladite chapelle et église... Et que
pour la nourriture dudit vicaire ou curé ledit maître
et recteur sera obligé de lui donner chaque année
sept anées (2) de vin bon et pur, un setier (3) de
seigle, un setier de froment, mesure de Montbrison, un bichet
de pois, un bichet de fèves, dite mesure, et six
moutons d'or (4) ...
En 1479, on relève un nouveau différend entre
" Maistre Anthoine de Vezato, docteur en théologie,
recteur et gouverneur de l'hostel Dieu et Claude Vende,
bachelier en décrêt, chappellain et vicaire
de la chappelle Saincte Anne aiant cure et charge d'âmes
(5)". Cette fois, sont en question, vingt livres tournois
et de huit livres d'huile dues au vicaire pour prix de ses
services. Des considérations étroitement économiques
se mêlent souvent à des problèmes de
préséance et d'autorité.
Une
petite paroisse
La chapelle Sainte-Anne bénéficie d'une certaine
faveur parmi les artisans montbrisonnais. Elle s'enrichit
d'un autel dédié à saint Joseph et
doté d'une prébende. Le 3 septembre 1486,
les " maistres en l'art de menuserie, charpenterie,
bennerie et massonnerie " de la ville se constituent
en confrérie auprès de l'autel de leur saint
patron. Les statuts sont approuvés le 22 septembre
suivant (6).
Des inventaires nous indiquent qu'à la fin du XVIe
siècle, peu de temps après le saccage de Montbrison
par le baron des Adrets (1562), la chapelle possède
d'assez riches ornements :
1574 : une chasible de damas rouge
ayant la croix de veloux violletz avec son estolle et garnitures,
ung devantier (7) pour madame Ste Anne de damas rouge bordé
de passements, item une robbe de velours viollet fleurdelisé
de fleurs de lis de filz dor et les bordeures de fillet
d'or (8).
1584 : une baniere taphetas rouge
au millieu delaquelle y a l'ymaige Ste Anne avec les franges
de soye verte, deux taphettas bleu celeste lung ayant des
passemens dargent pour servyr aporter corpus domini, ung
parement d'haultel de moscade rouge avec franges bleues,
ung tappis de sarge verde et rouge pour mectre en la chayre
et aultre tappis de mesme pour mectre au polpitre, une ymaige
de Ste anne dallebastre (9) avec une petite croix de boys,
ung calice dargent avec la platine (10) et ung reliquaire
aussi dargent, une petite cloche de metail et un encensier
(11) de cuyvre, et encores ung rellicaire de saincte Anne
qui est enchassé dargent et ung grand chandellier
de fer... (12)
Le nombre des paroissiens de Sainte-Anne est pourtant réduit.
Le procès-verbal de la visite pastorale de Mgr de
Marquemont, archevêque de Lyon, indique qu'en 1614
il y a une seulement une centaine de communiants. C'est
moins de quatre pour cent des fidèles de la ville.
La paroisse de Saint-André compte alors 1 600 communiants,
celle de Saint-Pierre 500 et celle de la Madeleine 500 également
(13).
Cependant le petit sanctuaire bénéficie du
voisinage du prestigieux chapitre de l'église collégiale
et royale Notre-Dame-d'Espérance. Ainsi, en 1610,
Messire Jean Favier, chanoine, fonde par testament une messe
de l'office des morts à dire à perpétuité
en la chapelle de l'hôtel-Dieu (14). De 1644 à
1664, pendant vingt années, la prébende de
Sainte-Anne a pour titulaire noble Jean Marie de la Mure,
chanoine-sacristain de Notre-Dame, le savant historien de
la province de Forez. Avant de résigner sa charge,
de la Mure a un beau geste. Le premier janvier 1664, il
donne " par aumosne et par charité aux pauvres
malades et à l'hôtel-Dieu " la somme de
vingt-trois livres qui lui était due pour l'année
1663, "savoir vingt livres de pension annuelle comme
prébendier, et trois livres pour faire les enterrements
des pauvres... (15)"
II.
Au XVIIe siècle
Pour
l'histoire de Sainte-Anne, le Grand siècle est, malheureusement,
surtout celui des disputes et des procès. Les difficultés
renaissent perpétuellement pour l'utilisation de
la chapelle. De 1606 à 1610 se déroule une
procédure entre le curé de Moingt qui est
alors Pierre Chovon, chanoine-sacristain de Notre-Dame et
Pierre Magaud, prébendier de Sainte-Anne (16). Le
curé de Moingt revendique formellement la chapelle
comme église annexe de sa paroisse.
Réparations
à la chapelle
Et quand la chapelle a besoin de réparations, les
recteurs de l'hôtel-Dieu s'adressent aux paroissiens
pour obtenir des fonds. Le 14 juillet 1635, les recteurs
présentent une requête au bailli de Forez afin
d'obtenir l'autorisation de faire les travaux nécessaires
à Sainte-Anne aux frais des habitants de la rue de
Moingt et du quartier de la Porcherie. En effet, depuis
que la ville a été close de murs, ils ont
constamment utilisé la chapelle comme annexe de l'église
paroissiale de Moingt (16).
Les paroissiens de Sainte-Anne mettent peu d'empressement
à payer. Il faut, le 5 avril 1636, une ordonnance
du lieutenant général pour leur enjoindre
de s'assembler à l'issue de la messe paroissiale
afin de nommer un syndic chargé de les représenter
au procès en cours au bailliage concernant des réparations
à effectuer . Finalement, le 6 septembre 1636, les
officiers du bailliage rendent une ordonnance portant qu'à
la diligence des syndics des habitants les réparations
seront faites aux dépens de la paroisse(16) .
Visite
pastorale de Mgr de Neuville-Villeroy
En 1662, le 17 juin, lors de sa visite pastorale, l'archevêque
de Lyon trouve un sanctuaire modeste mais décemment
tenu. Le procès-verbal de la visite est très
bref :
L'églize de Ste-Anne est
dans la ville de Montbrison et est une annexe de l'églize
de Moing.
Le lambris en est assez vieux et le pavé inégal
et raboteux à cause des sepultures qui s'y font.
Au maistre-autel il y a un tabernacle de bois peint et doré
au dedans duquel il y a un ciboire d'argent dans lequel
repose le St Sacrement.
Il y a aussy un soleil d'argent et un ciboire d'estain pour
le viatique des malades. L'églize est pourveue d'un
calice d'argent, 4 chazubles, une chappe de satin, du linge,
chandeliers, etc. en quantité suffisante. Les saintes
huiles sont tenues proprement en cette église ainsy
que les eaux baptismales. Le luminaire n'a aucun revenu
certain.
Le cimetière est clos, mais il n'y a aucune maison
curiale.
Cette
dernière remarque est tout à fait significative.
Sainte-Anne est " presque " une vraie paroisse
car elle possède un cimetière pour ses morts,
cependant elle n'a pas de presbytère, la résidence
normale du curé étant au bourg de Moingt,
il s'agit bien d'une annexe.
Nouvelles
disputes
Et pour l'utilisation de la petite église la querelle
continue. Le 21 août 1673, le curé, les marguilliers
et les habitants de la paroisse Sainte-Anne adressent une
requête à l'archevêque de Lyon pour s'opposer
aux modifications que les recteurs de l'hôtel-Dieu
projettent d'apporter à l'église. Il s'agit
vraisemblablement de la construction d'un mur permettant
de réserver le chœur de l'église aux
religieuses hospitalières. En effet, depuis 1654,
des religieuses ont été installées
à l'hôtel-Dieu pour remplacer l'hospitalier
et sa femme. Sœur Marie Janin, religieuse hospitalière
de l'ordre de Saint-Augustin venant de la Maison-Dieu de
la Charité-sur-Loire en Nivernais est la première
supérieure de la communauté.
Bien qu'en 1662, lors de sa visite, l'archevêque ait
clairement reconnu Sainte-Anne comme une annexe de l'église
paroissiale de Moingt (17), un fragile statu quo est rompu
en faveur de l'hôpital. Les religieuses sont une douzaine,
toujours présentes. La communauté utilise,
évidemment, beaucoup la chapelle. Elle a même
tendance à s'approprier totalement les lieux (17).
Le 23 août 1673, les recteurs de l'hôtel-Dieu
présentent une requête au bailli de Forez contre
Guillaume Berthaud, curé de Moingt qui revendique
Sainte-Anne comme annexe de son église paroissiale.
D'ailleurs, à ce moment-là, le curé
réside à Montbrison et entretient un vicaire
au bourg de Moingt ce qui indique bien que l'annexe est
plus importante, à ses yeux, que l'église
principale.
Le 31 octobre 1673, Guillaume Berthaud s'adresse à
son tour à l'archevêque de Lyon pour se plaindre
des transformations que les responsables de l'hôpital
ont apportées à la chapelle. Mgr de Neuville-Villeroy
désigne alors un chanoine de Notre-Dame, Messire
de la Chaize d'Aix, pour enquêter sur les faits.
Une transaction intervient le 17 décembre 1673 :
l'église Sainte-Anne servira à la fois à
l'hôtel-Dieu et à la paroisse. Le curé
de Moingt, le desservant de l'annexe, le prébendier
de Sainte-Anne et les recteurs de l'hôpital sont parties
contractantes. Leurs droits respectifs sont précisés
(18).
Trois ans plus tard, en 1676, on envisage d'utiliser pour
l'annexe de Moingt la chapelle du prieuré de Saint-Eloy
qui appartient à la confrérie des maréchaux.
Cet édifice, aujourd'hui disparu, était situé
hors des murs, près des casernes et sur le territoire
moingtais (19). De leur côté, les administrateurs
de l'hôpital achètent de 1661 à 1715,
plusieurs maisons situées rue de la porte de Moingt
avec l'intention de rebâtir sur leur emplacement la
chapelle Sainte-Anne qui menace ruine (20).
Le projet du prieuré Saint-Eloy n'aboutit pas et
la querelle continue. En 1687, les habitants du quartier
s'adressent une nouvelle fois à l'archevêque
de Lyon pour qu'il oblige les recteurs de l'hôtel-Dieu
à exécuter la transaction passée en
1673 (21) . Le prélat rend une ordonnance sur cette
question le 28 juillet 1687. Elle n'a guère d'effet
car les paroissiens renouvellent leur requête le 18
septembre 1688. De 1690 à 1706, les curés
successifs de Moingt, Lambert Vayron et Jean-Baptiste Marcland,
réclament l'annulation de la transaction de 1673
et poursuivent une procédure contre les recteurs
de l'hôtel-Dieu (22).
III.
La nouvelle chapelle Sainte-Anne
Transfert
du cimetière de Sainte-Anne
Entre Moingtais et Montbrisonnais, le différend s'aggrave
encore à propos de deux affaires distinctes mais pourtant
liées : la translation du cimetière de Sainte-Anne
et la démolition de la chapelle Saint-Lazare.
Un cimetière exigu jouxte la vieille chapelle Sainte-Anne,
elle-même située sur la rive du Vizézy.
Il sert à inhumer les pauvres de l'hôpital et les
paroissiens. Cet enclos est devenu très insuffisant.
Il constitue une gêne pour les malades et les religieuses
de l'hôpital tout proche. En l'année 1700,
les religieuses s'estant plaintes auxdits
recteurs conjointement avec les medecins et les chirurgiens
de la maison que le cimetière trop petit pour enterrer
les pauvres et les paroissiens infectoit les malades de l'hostel
Dieu quy joint ledit cimetière et prend ses jours dessus
et attiroit sur eux une quantité de grosses mouches quy
les désoloient pendant les chaleurs, sur ces plaintes
et sur ces remontrances (23).
les recteurs obtiennent sa translation hors les murs de la ville
dans un lieu moins resserré. Un terrain est trouvé
dans un lieu plus commode environ à deux cens pas de
l'ancien cimetière. Cette parcelle a d'ailleurs déjà
servi de lieu de sépulture en 1545, au moment d'une forte
épidémie de peste. Au début du XXe siècle
les Montbrisonnais ont redécouvert avec surprise l'existence
de cet ancien cimetière (voir ci-après l'encadré).
Le curé de Saint-Pierre, Simon Pactier effectue l'enquête
préalable. Le grand vicaire de Lyon autorise l'installation
et la bénédiction d'un nouveau cimetière
qui doit estre commun aux pauvres et
aux habitans. Le doyen de Notre-Dame bénit
solennellement le nouvel enclos qui se trouve hors
de ladite ville et sur les fossés d'icelle dans un endroit
lequel a servy autresfois de sepulture aux huguenots (23).
Ce cimetière, situé tout près des casernes,
figure sur le plan d'Argoud de 1775. Aujourd'hui, c'est approximativement
l'emplacement de la poste principale.
Mais il faut compter avec la vive opposition des habitants et
du curé de Moingt soutenus par l'abbé de la Chaise-Dieu,
patron de la paroisse. Le transfert entraîne des incidents
regrettables. Pendant la nuit du 2 au 3 septembre 1706, les
recteurs " déménagent " subrepticement
le cimetière en faisant
conduire et trainer sur une charrette
par les rues dudit Montbrison en des sacs ou boges (24) les
ossements des habitants de ladite esglize sainte Anne. Les habitants
du quartier de l'hôpital s'indignent et, touchés
de la piété naturelle vont amasser eux mesmes
sur les sept heures du lendemain les chairs et reliques de leurs
proches parens et amis en des corbeilles pour les rapporter
aveq tout le respect possible au cimittière de ladite
parroisse de Ste Anne (25).
C'est seulement après ces incidents que les recteurs
consentent à présenter l'autorisation écrite
qu'ils avaient obtenue du vicaire général de Lyon
pour opérer ce transfert.
1906,
les Montbrisonnais retrouvent le cimetière des Huguenots
Juin
1906, émoi dans la ville. En creusant les fondations
d'une maison, au 30 du boulevard Lachèze, les maçons
ont découvert des monceaux d'ossements humains !
Plusieurs tombereaux de restes sont transportés au
cimetière de la Madeleine. Tout Montbrison en parle.
Souvent sans rien savoir d'ailleurs. Pour couper court à
des "suppositions fantastiques" le rédacteur
du Journal de Montbrison croit bon de faire un peu d'histoire
locale. On vient tout simplement de découvrir - ou
plutôt de redécouvrir - un ancien cimetière.
La peste de 1545
Remontons jusqu'au 16e siècle. La peste ravage la
contrée. Elle frappe Montbrison à partir de
mars 1545. Et durement, au point d'en rendre les cimetières
bossus.
L'hôtel-Dieu Sainte-Anne, surchargé de malades,
ne sait plus où inhumer ses morts. Le petit cimetière
près de la chapelle (aujourd'hui le temple de l'Église
réformée) ne suffit plus. Il sert à
la fois à la paroisse Sainte-Anne et à l'hôpital.
Où trouver une terre bénite pour recevoir
les pestiférés ? Un moment on pense au cimetière
de la commanderie de Saint-Jean-des-Prés. Il est
tout proche. Mais le commandeur, Frère François
de Montjornal, ne veut souffrir d'enterrer d'autres gens
que les chevaliers de Malte et leurs affidés.
Les recteurs de l'hôtel-Dieu cherchent alors un cimetière
de fortune. Ce sera un petit champ que possède l'hôpital.
Il est tout près, sur les fossés et hors les
remparts. Ce lopin servait à la culture du chanvre
d'où son nom de "chenevier". C'est l'emplacement
approximatif de la poste actuelle.
Selon Barthélemy Puy, un chroniqueur du temps, l'épidémie
fait 300 victimes en 1545. Et 200 sont inhumées dans
ce coin de terre. L'année suivante, tout est fait
en bonne et due forme. Le 10 mai 1546, le Père franciscain
Jean Bothéon, évêque de Damas, au nom
de l'archevêque de Lyon, consacre solennellement ce
champ du repos improvisé.
Cimetière réservé
aux protestants
Les
temps devenant moins durs, on reprend les inhumations au
cimetière habituel de Sainte-Anne. Sauf pour quelques
protestants qui seront enterrés hors la ville. Le
cimetière des pestiférés devient alors
celui des huguenots.
Devenu
décidément trop petit, le cimetière
de Sainte-Anne, y est transféré en 1706. Cela
ne va pas sans récriminations et procès de
la part des paroissiens. Il figure encore sur le plan d'Argoud
de 1775, tout près de la Caserne.
Après
la Révolution, il est complètement abandonné
et vendu comme bien national. C'est aussi le sort des autres
cimetières de la ville : celui de Saint-André
situé à l'emplacement de la maison des francs-maçons,
de Saint-Pierre, sur les lieux de l'ancienne école
supérieure, de la Madeleine, près de la rue
Saint-Antoine…
Ainsi
vont les choses. Même les cimetières disparaissent.
Celui de la Madeleine, bénit le 24 novembre 1809,
est désormais la dernière demeure des Montbrisonnais.
J. B.
[extrait de La Gazette de la Loire du 6 octobre
2006]
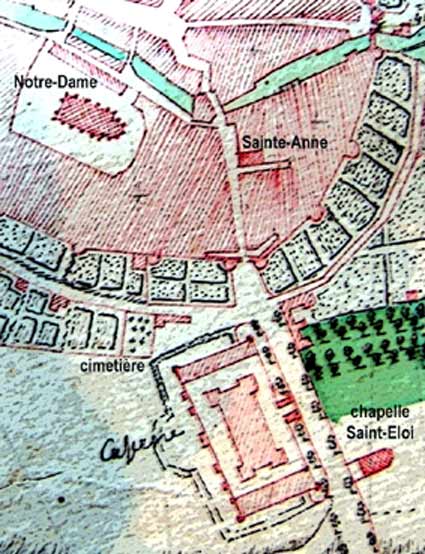
Plan
d'Argoud de 1775
*
* *
Démolition de la chapelle Saint-Lazare
En 1148, Guy II, comte de Forez, avait ordonné la fondation entre
Moyn et Montbrison, en la parroisse de Savigny (Savigneux)
une esglise pour les malades de la maladie de lèpre (26)
. La maladrerie de Saint-Lazare, établissement déjà
modeste à l'origine, perd de son importance à
la fin du Moyen Age et devient un simple bénéfice.
En 1670, ses revenus sont une première fois unis à
ceux de l'hôtel-Dieu de Montbrison. En 1672, lors d'une
réorganisation générale des établissements
hospitaliers, la maladrerie de Moingt est réunie à
l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare. Mais
peu après, par arrêt du 13 juillet 1696 du conseil
du roi, elle définitivement unie à l'hôpital
de Montbrison.
La chapelle de la léproserie, laissée depuis
longtemps sans entretien, est en piteux état :
Elle
tombe en ruine, ne s'y disant aucune messe depuis plus de
vingt ans, la voûte d'icelle estant corrompue et fendue
sur le point de tomber, aussi bien que les murailles de ladite
église qui a esté profanée, et polluée
par les animaux et l'entrepos de foins et pailles... (27).
Les recteurs de l'hôpital décident donc de faire
démolir Saint-Lazare afin d'en utiliser les matériaux
pour réparer l'hôtel-Dieu de Montbrison. Nouveau
sujet de mécontentement pour les habitants de Moingt
qui soudain déclarent que Saint-Lazare est un sanctuaire
vénéré et doté de fondations "
considérables ".
Un long procès oppose donc les recteurs de l'hôtel-Dieu
au curé de Moingt soutenu par l'abbaye de la Chaise-Dieu.
Ces affaires entraînent aussi des dissensions à
l'intérieur même du bureau de l'hôpital.
Les recteurs laïques ou séculiers reprochent aux
recteurs ecclésiastiques - désignés par
le chapitre de Notre-Dame - de préférer les
procès plutôt que de rechercher des solutions
amiables.
Les années passent et il devient urgent de s'entendre
avant que les chapelles Sainte-Anne et Saint-Lazare ne s'écroulent,
l'une et l'autre. Le 19 mars 1722, Antoine Chault, curé
de Moingt, transige avec les recteurs de l'hôpital :
la chapelle Sainte-Anne sera reconstruite sur un nouvel emplacement
et elle sera commune aux paroissiens et aux pauvres malades.
La chapelle Saint-Lazare est démolie en 1729 et ses
matériaux sont employés pour reconstruire Sainte-Anne.
Construction
de la nouvelle chapelle Sainte-Anne
Un accord étant enfin trouvé, les recteurs entreprennent
la reconstruction de la chapelle, rue de Moingt, à
l'emplacement où elle se trouve aujourd'hui. Le 17
mars 1729, ils passent prix fait pour les travaux de reconstruction
avec Joseph Mirandon, tailleur de pierres. Le 18 mars ils
prennent des conventions avec Antoine Gouilloud, marchand
tailleur de pierre, du lieu du Treuil, paroisse de Saint-Etienne
de Furan, pour la fourniture de pierres de taille. André
Menut, Jamier l'aîné et Jamier le jeune, chaudiers
de Sury-le-Comtal, fournissent pour 1 026 livres 10 sols et
6 deniers de chaux.
Le 20 mai, prix fait est passé avec Georges Mosnier
et Benoît Bernard, maîtres charpentiers et menuisiers
de Montbrison (28).
Mathieu Poyet, qui est receveur de l'hôtel-Dieu, verse
151 livres 12 sols au sieur Jamier pour l'achat de poudre
à canon et 178 livres à Estienne Fournier, "joueur
de mine", pour son travail de démolition des immeubles
anciens. Les tuiles, briques et autres matériaux de
terre cuite coûtent 535 livres 11 sols. Jacques Dubois,
tailleur de pierre, reçoit 213 livres 10 sols pour
salaire.
La dépense totale se monte à 8 790 livres 1
sol et 6 deniers, somme assez considérable supportée
par l'hôtel-Dieu (29) . A titre de comparaison, rappelons-nous
que l'ensemble immobilier du petit couvent de Sainte-Ursule
(la maison de retraite actuelle), au faubourg de la Croix,
est vendu 11 000 livres en 1753 et que les revenus du chapitre
de Notre-Dame se montent alors à 12 000 livres par
an.
Un nouvel arrangement intervient le 1er mai 1733 entre le
curé de Moingt et les recteurs au sujet de l'utilisation
du nouvel édifice. Il ne reste plus qu'à bénir
solennellement la chapelle neuve. C'est chose faite le 27
avril 1734 par Messire François Basset, chanoine de
Notre-Dame commis à cet effet par l'archevêque
de Lyon.
IV.
La paroisse Sainte-Anne de Montbrison avant
la Révolution
Le cloître Notre-Dame
La paroisse Saint-Anne comprend, intra-muros, deux quartiers
bien distincts, la Porcherie à l'ouest et la rue de Moingt
à l'est, séparés par le cloître Notre-Dame.
Cet enclos ombragé de tilleuls constitue une petite cité
rectangulaire d'un peu moins de deux hectares. Les maisons canoniales,
toutes de même facture et peintes en rouge (30) , forment
un bel ensemble autour de la collégiale.
Le quartier, bien limité au nord par la rivière
et au sud par les remparts de la ville, est complètement
fermé, ne communiquant que par trois portes avec le reste
de la ville. Dans ce périmètre le chapitre est
souverain. Bien que Notre-Dame n'ait pas le titre d'église
paroissiale le chanoine doyen exerce les droits curiaux sur
les chanoines et leur domesticité. Le chapitre est aussi,
collectivement, seigneur de Moingt. Son influence est souvent
prépondérante dans les assemblées de ville.
Les recteurs ecclésiastiques qu'il nomme régentent
les hôpitaux montbrisonnais : l'hôtel-Dieu Sainte-Anne
et l'hôpital du Bourgneuf.
Outre une douzaine de chanoines plus de trente clercs animent
ce centre spirituel de la ville (31). Dans les disputes au sujet
de la chapelle Sainte-Anne, il n'y a rien d'étonnant
à ce que le puissant et proche chapitre ait, le plus
souvent, tenu en échec, par l'action des chanoines administrateurs
de l'hôtel-Dieu, le curé de Moingt soutenu, lui,
par la prestigieuse mais lointaine abbaye de la Chaise-Dieu.
La
Porcherie
Le quartier de la Porcherie fait pauvre figure auprès
du cloître de Notre-Dame. Soixante petites maisons s'entassent
entre le Vizézy et les murs de la ville, le long de venelles
tortueuses. Même le quai de la rivière est bâti
ce qui n'est pas sans inconvénients. En 1572, le 4 juin,
une crue soudaine emporte le pont (32) qui relie le quartier
au reste de la cité et la plupart des maisons et étables
qui surplombent la rivière.
L'entassement des habitations rend encore plus dramatiques les
incendies. Le 10 octobre 1726, plusieurs maisons du quai du
Vizézy sont la proie des flammes. L'une d'elles appartient
à l'hôpital et sert de logement aux "archers
des pauvres", personnages qui ont pour fonction d'arrêter
mendiants et vagabonds et de les conduire à l'hôpital
général. Les dégâts sont tels que
les recteurs des deux hôpitaux montbrisonnais, l'hôtel-Dieu
et la Charité, décident de soulager les sinistrés
en accordant " quelques secours extraordinaires ",
surtout à ceux qui se trouvent chargés d'enfants
en bas âge. Sainte-Anne et l'hôpital de la Charité
versent chacun 25 livres par mois pendant une année pour
être distribuées aux victimes (33).
Quartier rural - son nom même est révélateur
- un des plus pauvres de la ville avec celui du Bourgneuf, la
Porcherie abrite une population de journaliers, vignerons, jardiniers
et domestiques. Quelques artisans complètent l'éventail
des professions. Au-delà de la Poterle ou porte d'Ecotay,
la faubourg d'Ecotay (actuelle rue du Parc) regroupe une vingtaine
de feux. On y trouve des journaliers et vignerons, un bouvier,
un peigneur de chanvre, un scieur de long... (34).
La
rue de Moingt
Parce qu'elle est placée sur le Grand chemin de Forez
et à l'une des entrées principales de la ville,
la rue de Moingt (actuelle rue de l'Ancien-Hôpital ou
Marguerite-Fournier) est plus commerçante et plus riche
(35). Une soixantaine de familles logent dans vingt-cinq maisons
à étages (36). En 1789, on dénombre huit
marchands, trois cabaretiers, deux aubergistes dont l'hôte
du Chapeau rouge, cinq boulangers, deux cordonniers, des chapeliers,
des perruquiers et même deux avocats et deux huissiers.
C'est là que se trouve "la
plus notable partie" de la paroisse Sainte-Anne.
A la veille de la Révolution, la paroisse Sainte-Anne
regroupe un peu plus de dix pour cent de la population de la
ville (37). Le rôle de taille retient près de 150
cotes pour la rue de Moingt, la Porcherie et le faubourg d'Ecotay
(38). Enfin si l'on décompte les actes de catholicité
effectués de 1785 à 1790 (six années) dans
les quatre paroisses de la ville, la moyenne annuelle s'élève
à 41 pour Sainte-Anne ce qui représente plus de
12,5 % du total.
Certes, Sainte-Anne est la plus petite des paroisses de Montbrison
et la plus pauvre, mais elle est sensiblement plus peuplée
qu'au XVIIe siècle. Il y a au moins 300 communiants,
soit de 500 à 600 habitants, trois fois le nombre indiqué
au moment des visites pastorales de 1614 et 1662.
Disparition
de la paroisse Sainte-Anne
La Révolution entraîne de profonds bouleversements.
Les chanoines sont contraints de quitter le cloître, l'hôtel-Dieu
devient "Maison d'humanité", les sœurs
augustines sont sommées de quitter l'habit religieux.
Javogues, l'enfant perdu de la bonne société montbrisonnaise,
prétend faire de Montbrison Montbrisé...
L'orage passé, Sainte-Anne a perdu son rang d'église
paroissiale. Le curé de Moingt est définitivement
évincé des affaires de Montbrison. Il perd même
toute la partie montbrisonnaise de sa paroisse. Les habitants
de la rive méridionale du Vizézy seront désormais
paroissiens de Notre-Dame, utilisant désormais la prestigieuse
collégiale qui était jadis réservée
aux chanoines.
*
* *
Sainte-Anne
sert de chapelle de l'hôpital jusqu'en 1975, date du transfert
de l'établissement à Beauregard. La chapelle Sainte-Anne
est un édifice modeste mais qui a une longue histoire.
On ne peut l'évoquer sans se souvenir du comte de Forez
Guy IV fondateur, dans un acte de foi de la collégiale
Notre-Dame d'Espérance, et qui tout près, dans
un geste de charité, avait transféré de
son château l'hôtel-Dieu pour les pauvres malades.
Les pierres de la maladrerie Saint-Lazare de Moingt ont servi
à sa reconstruction.
Un cimetière l'entourait. Surchargé, il fut transféré
hors de la ville. Comment ne pas penser à la lèpre,
à la peste, aux guerres, à toutes les misères
des siècles passés Le lieu a été
aussi l'objet de disputes et de réconciliations, avec
des drames et des moments de liesse. A l'image de la cité
et de la vie, tout simplement.
Dans ce lieu de célébration, des hommes, des femmes
et des enfants, en foule, se sont rassemblés : des pauvres
et des riches, les paroissiens de Sainte-Anne, les religieuses
augustines, les familles de nombreux petits baptisés
venant de tout le Forez.
Il restait à souhaiter que l'on respectât cet édifice
et qu'il retrouvât une destination digne de son passé.
C'est aujourd'hui chose faite puisque, après quelques
années d'abandon, la chapelle est devenue en 1995 le
temple de l'Eglise réformée du Forez, un lieu
de prière et un signe d'œcuménisme.
Joseph
Barou
Notes
de la première partie
(1)
Archives hospitalières de Montbrison, Sainte-Anne,
C 2, transaction du 7 avril 1429 ; ces archives ont été
inventoriées et classées par Henri Gonnard (1834-1912),
dessinateur, peintre et érudit montbrisonnais.
(2) Une ânée : environ 110 litres.
(3) Un setier : 16 bichets ; un bichet : 19,7 litres.
(4) Mouton d'or : monnaie de Charles VI (1417) valant 1 livre
tournois.
(5) Archives hospitalières de Montbrison, Sainte-Anne,
C 2, ordonnance rendue par Jean, duc de Bourbonnais et d'Auvergne,
à Moulins, le 8 octobre 1479.
(6) Archives hospitalières de Montbrison, Sainte-Anne,
C 1.
(7) Un tablier ; il s'agit d'un mot de patois local utilisé
pour désigner une pièce du costume d'apparat
de la statue de sainte Anne. Lors de certaines fêtes
la statue de sainte Anne était richement habillée.
(8) Archives hospitalières de Montbrison, Sainte-Anne,
E 1, "Décharge portant obligation des meubles
de l'église Sainte-Anne de l'hôtel-Dieu de Montbrison
contre Messire Claude Mulat, 1er janvier 1574.
(9) Une statue d'albâtre.
(10) Il s'agit de la patène, petit plat qui reçoit
l'hostie.
(11) Un encensoir.
(12) Archives hospitalières de Montbrison, Sainte-Anne,
E 1, "Inventaire des ornements et joyaux de l'église
de Sainte-Anne", 18 décembre 1584.
(13) Visite du 28 juin 1614 de l'archevêque de Lyon
à Montbrison et à Moingt, "Recueil des
visites pastorales du diocèse de Lyon aux XVIIe et
XVIIIe siècles, t. I, Lyon, 1926."
(14) Archives hospitalières de Montbrison, Sainte-Anne,
C 1, "Testament de messire Jean Favier, du 18 octobre
1610".
(15) Archives hospitalières de Montbrison, Sainte-Anne,
C 2, quittance en date du 1er janvier 1664.
(16) Archives hospitalières de Montbrison, Sainte-Anne,
C 2.
(17) Visite pastorale de Mgr de Neuville-Villeroy.
(18) Archives hospitalières, Sainte-Anne, C 2.
(19) Cf. cinq pièces datées du 28 décembre
1676, archives hospitalières, Sainte-Anne, C 2.
(20) Archives hospitalières, Sainte-Anne, C 2., actes
d'acquisition.
(21) Requête du 20 mai 1687, archives hospitalières,
Sainte-Anne, C 2.
(22) 12 juin 1690, 2 septembre 1706, archives hospitalières,
Sainte-Anne, C 2.
(23 )Archives de Sainte-Anne, C 4 - 16..
(24) Sacs grossiers, aujourd'hui de jute, pour transporter
les récoltes.
(25) Archives de Sainte-Anne, C 4 - 15, du 5 janvier 1708.
(26) Inventaire des titres du comté de Forez par Perrin
Gayand, livre des compositions, Bibliothèque de Saint-Etienne,
p. 625.
(27) Archives Sainte-Anne, C 4, du 19 avril 1706.
(28) Ce document a été publié par M.
Jean Bruel, dans le Bulletin de la Diana, 1987, tome
L, n° 4, p. 205-210.
(29)
Archives hospitalières, Sainte-Anne, C 2.
(30) Selon Pierre Pourrat, auteur forézien qui a laissé
une "Géographie ou description de la terre",
ouvrage manuscrit daté de 1669 que possède la
Diana.
(31) Le chapitre compte un doyen, douze chanoines, vingt-cinq
prêtres, quatre prébendiers, seize enfants de
choeur, un maître de musique et quinze ou seize autres
clercs selon Pierre Pourrat, "Géographie...",
op. cit. ; le Mémoire d'Herbigny indique un doyen,
dix chanoines, dix-huit semi-prébendiers.
(32) Le pont d'Ecotay ou pont d'argent sera plusieurs fois
rebâti. Cf. la communication de Jean Bruel, "Le
pont d'Ecotay, autrefois pont d'argent", Bulletin Diana,
t. L, n° 4, 1987, p. 211-216.
(33) Archives hospitalières de Montbrison, Sainte-Anne,
E 10, délibération du 24 octobre 1726.
(34) D'après le registre de la taille subsidiaire et
vingtième de 1789.
(35) En 1781 :
La Porcherie : 60 maisons ; revenu moyen par maison : 43 livres.
51 propriétaires ; revenu moyen : 76 livres.
Rue de Moingt : 23 maisons ; revenu moyen par maison : 125
livres.
23 propriétaires ; revenu moyen : 175 livres.
Montbrison (ensemble de la ville) :
Revenu moyen par maison : 71 livres.
Revenu moyen par propriétaire : 130 livres.
("Montbrison à la fin de l'Ancien Régime",
groupe de recherches d'histoire économique", Centre
d'Etudes Foréziennes, t. 4, p. 23 à 47.)
(36) On compte 56 cotes pour la rue de Moingt (en 1789) pour
seulement 23 immeubles (1781).
(37) Montbrison : 735 maisons - La Porcherie et la rue de
Moingt : 83 maisons ; Montbrison : 651 propriétaires
- la Porcherie et la rue de Moingt : 74 propriétaires"Montbrison
à la fin de l'Ancien Régime", op. cit.
(38) Bulletin Diana, "Registre de la taille subsidiaire
et vingtième de Montbrison", année 1789,
t. 27 :
Rue Porcherie : 70 cotes.
Rue de Moind : 56 cotes.
Faubourg d'Ecotay : 21 cotes.

Statue
mutilée de sainte Anne
et de la Vierge
provenant de l'hôtel-Dieu
(musée de la Diana, Montbrison)
Un
temple, une communauté
et son histoire
par Claude Latta
A
mon ami Pierre Cronel
C. L.
I.
Un événement œcuménique :
L'ancienne
chapelle de l'hôtel-Dieu devient le temple protestant
de Montbrison
Inauguration
officielle
Le 4 mai 1996, l'Eglise réformée de Saint-Etienne
et du Forez a célébré un culte de reconnaissance
et a procédé à l'inauguration officielle
du Temple de Montbrison. Deux cents personnes environ assistaient
au culte qui était présidé par le pasteur
Sophie Zentz-Amédro qui avait revêtu la robe noire
traditionnelle des ministres du culte protestant et qui commenta
un passage du deuxième livre de Samuel (1): importance
de la prédication et de la liturgie de la Parole dans
la célébration du culte protestant.
Avant la célébration du culte lui-même,
Geneviève Rey, présidente du conseil presbytéral
et Marthe Stahl, membre de ce conseil et présidente du
conseil de secteur, ont prononcé quelques mots d'accueil
en constatant le caractère œcuménique de
cette réunion. Après la célébration,
Geneviève Rey prononça une allocution et remercia
toutes les personnes ayant apporté leur concours ; Denis
Cateland, premier adjoint, prit la parole au nom de la municipalité
et présenta les excuses de Philippe Weyne, maire de Montbrison,
retenu par une réunion familiale. On notait la présence
de plusieurs pasteurs et aussi du Père Rolle, curé
de la paroisse Notre-Dame, du Père Baisle, ancien curé
de Notre-Dame, et du Père Baralon, représentant
du Père Joatton, évêque de Saint-Etienne.
Marc Vernhes, sous-préfet de Montbrison, Guy Poirieux,
sénateur et ancien maire de Montbrison, Jean-François
Chossy, député de la Loire, Denis Cateland, premier
adjoint au maire de Montbrison, Liliane Faure, conseillère
municipale de Montbrison, honoraient le temple de leur présence.
Il y avait aussi des clarisses et des religieuses augustines
de l'ancien hôtel-Dieu dont la présence était
particulièrement symbolique et émouvante puisqu'elles
retrouvaient leur ancienne chapelle...
Le
culte de Noël
Mais je crois que c'est la date du 17 décembre 1995 qui
sera, en fait, importante dans l'histoire religieuse de Montbrison
: ce jour-là, en effet, cinq mois avant l'inauguration
officielle, le temple de Montbrison a été ouvert
au culte dans l'ancienne chapelle de l'hôtel-Dieu. Ce
culte de Noël fut célébré, sous la
présidence du pasteur Sophie Zentz-Amédro qui
dirigea les chants de Noël repris par une nombreuse assistance.
Les enfants participèrent activement à la célébration
du culte : évocation de la succession des prophètes
et de l'ascendance du Christ, lectures de l'Evangile, intentions
de prières, défilé des rois mages personnifiés
par les enfants costumés.
L'assistance était nombreuse, venue de toute la communauté
protestante du Forez et de Saint-Etienne. Il y avait beaucoup
d'enfants. Des catholiques - souvent les conjoints des membres
de la communauté protestante - étaient venus manifester
par leur présence l'existence d'une communauté
des chrétiens et la réalité de l'œcuménisme.
Un goûter salé sucré fut ensuite offert
à tous avec beaucoup de gentillesse et de convivialité
dans la salle aménagée au nord de l'ancienne chapelle.
Le "Petit Protestant", journal rédigé
par les enfants du catéchisme fut distribué. On
sentait les membres de la communauté protestante heureux
d'être ensemble et d'avoir enfin un lieu de culte digne
de leur foi. Parmi eux, des pratiquants et des non-pratiquants
; et des agnostiques : mais en France, quand on est d'origine
protestante, on ne l'oublie jamais car on fait partie d'une
communauté minoritaire qui, ayant été opprimée,
connaît le prix de la liberté et de la solidarité.
II. L'ancienne chapelle de l'hôtel-Dieu
La
chapelle
Le nouveau temple est l'ancienne chapelle Sainte-Anne de l'hôtel-Dieu
(2) de Montbrison, située en bordure de la rue de l'Ancien-Hôpital
: sous l'Ancien Régime, c'était la rue de Moind
(Moingt).
Reconstruite au début du XVIIIe siècle, la chapelle
Sainte-Anne est de style classique. Sa façade en pierre
est assez austère ; la porte est surmontée d'un
fronton triangulaire posé en avancée sur deux
modillons. Une rosace est située au-dessus de la porte.
Le plan intérieur est très simple :
· la nef est surmontée d'une tribune haute à
laquelle on accédait de l'intérieur de l'hôpital.
Dallée de pierre et, sur les côtés, de carreaux
de brique à l'ancienne, elle est éclairée
de trois fenêtres et d'un oculus. Les murs sont garnis
de boiseries.
· Le chœur, auquel on accède par une marche,
est légèrement surélevé ; son chevet
plat est occupé par un retable de faux marbre, de style
néo-grec, surmonté d'un oculus. Il est flanqué
de deux chapelles latérales dont l'une était réservée
aux religieuses de l'hôpital. Il y a une tourelle sur
le côté nord ; on accède par deux petites
portes situées sous le retable, à une ancienne
sacristie et à une autre entrée à l'est
du chœur.
Les vitraux de la chapelle datent des
XIXe et XXe siècles.
· Les fenêtres hautes du chœur ont des vitraux
du XIXe siècle dernier et représentent, au sud,
le Christ tenant un calice et, au nord, la Vierge, la tête
ceinte d'un étroit bandeau, avec un livre posé
devant elle sur un lutrin (3). L'oculus situé au-dessus
du retable a une croix.
· Les vitraux de la nef, de la chapelle sud, de la nef
et de l'oculus qui surmonte la tribune sont de 1926 et ont été
offerts par Mme de Bichirand, née Jordan de Sury, une
Montbrisonnaise dont les libéralités financèrent
l'agrandissement de l'hôtel-Dieu qui fut alors surmonté
d'un étage pour qu'une maternité moderne y soit
installée. Ces vitraux sont de bonne facture et leur
iconographie a été choisie spécialement
pour une chapelle d'hôpital (la guérison, l'épreuve
de la mort, la miséricorde) :
· Le vitrail de la chapelle sud est consacré au
Christ thaumaturge. Plusieurs guérisons sont représentées
sur ce vitrail : un mort se lève de son cercueil ; un
infirme appuyé sur une béquille et une femme portant
son enfant mort se présentent au Christ. Ce vitrail a
été réparé en 1995 par Suzanne Philidet,
vitrailliste à Pélussin (4).
Les vitraux de la nef représentent (5) :
· La mort de saint Joseph, scène rarement montrée
: saint Joseph est identifiable grâce à ses outils
de menuisier accrochés au mur ; le Christ, debout, lui
tient la main ; la Vierge est agenouillée au pied du
lit.
· Le curé d'Ars, devant son église, est
"au milieu des affligés" et impose les mains
à une petite fille debout devant lui.
·
Notre-Dame de la Miséricorde, couronnée, et tenant
l'Enfant Jésus, nimbée des rayons du soleil, apparaît
aux malades et aux malheureux qui tendent les bras vers elle.
· Au-dessus de la tribune - ce qui correspond extérieurement
à la façade -, un beau vitrail, traité
dans des tons pastel, représente la rencontre de la Vierge
et d'Elizabeth, agenouillée devant elle. Zacharie est
à l'arrière-plan, à droite.
... et son histoire
Cette chapelle a une longue histoire. Dès le début
du XIIe siècle, l'hôpital de Montbrison, installé
ici par le comte Guy IV, était doté d'une chapelle,
située au bord du Vizézy, avec un cimetière.
Progressivement, les habitants de ce quartier trouvèrent
plus commode de suivre l'office dans cette chapelle plutôt
que d'aller à l'église de Moingt, sur la paroisse
de laquelle elle se trouvait. Une nouvelle paroisse fut créée
sous le patronage de sainte Anne. L'ancienne chapelle de l'hôtel-Dieu
devint l'église de la paroisse
Sainte-Anne, "annexe de Moingt"
Au
XVIIIe siècle, la vieille église médiévale
menaçait ruine : en 1729, les recteurs de l'hôtel-Dieu
décidèrent de sa reconstruction (6). On utilisa
des matériaux provenant de la démolition de la
chapelle de la maladrerie Saint-Lazare et de l'ancienne chapelle
de l'hôpital. Les recteurs de l'hôtel-Dieu et le
curé de Moingt conclurent un accord pour l'utilisation
de la chapelle par les religieuses augustines de l'hôpital.
En 1734 eut lieu la bénédiction solennelle de
la chapelle Sainte-Anne.
Après la Révolution, Sainte-Anne cessa d'être
une église annexe de la paroisse de Moingt et redevint
chapelle de l'hôpital. Pendant tout le XIXe siècle
et au XXe siècle - jusqu'en 1975 - de nombreux baptêmes
d'enfants nés à l'hôtel-Dieu y furent célébrés,
et aussi les funérailles de ceux qui étaient morts
à l'hôpital.
Le souvenir des religieuses augustines, qui se sont dévouées
aux malades et qui entendaient ici l'office quotidien, flotte
dans ces murs ; et aussi celui des aumôniers de l'hôpital,
de l'abbé Para, dont le docteur Rey rappelle la charité
dans ses Historiettes Foréziennes (7) jusqu'à l'abbé Merle qui fut aussi un bon
historien forézien et qui n'avait que peu de trajet à
faire pour gagner sa chère Diana.
Après la construction de l'hôpital de Beauregard,
la chapelle fut fermée au culte (1975). Les plaques sur
lesquelles étaient gravés les noms des bienfaiteurs
de l'hôpital furent transférées à
Saint-Etienne. Le petit musée qui est installé
près du hall d'entrée de l'hôpital de Beauregard
présente des objets qui viennent de l'ancien hôtel-Dieu
et de sa chapelle et qui en évoquent le souvenir.
Vingt
ans d'incertitude
Pour la chapelle Sainte-Anne s'ouvre alors une longue période
d'abandon et d'incertitude. Il fut d'abord question d'y installer
un musée d'objets religieux. On aurait présenté
des statues, reliquaires, chasubles et autres objets liturgiques
venus des églises du Montbrisonnais et menacés
de disparaître par suite de l'évolution de la liturgie
ou de la fermeture de nombreuses églises privées
de desservants réguliers. Le projet, intéressant,
fut finalement abandonné.
La chapelle fut quelquefois ouverte pour accueillir des ventes
des Compagnons d'Emmaüs, puis du Rotary-Club. C'était
l'occasion pour les Montbrisonnais de constater l'état
d'abandon dans laquelle elle se trouvait et quelle était
la quantité de poussière accumulée...
La communauté protestante ne disposait comme lieu de
culte que d'une salle de l'ancien hôpital : local peu
adapté à certaines célébrations
qui rassemblent parfois, lors de mariages par exemple, beaucoup
de monde. Elle avait demandé à pouvoir disposer
d'un lieu de culte plus convenable et avait suggéré
que l'ancienne chapelle Sainte-Anne lui fût attribuée.
Celle-ci aurait ainsi retrouvé sa vocation première
de bâtiment voué au service divin.
Le projet n'aboutit pas immédiatement. Il y avait des
réticences, voire l'opposition déclarée
de quelques catholiques montbrisonnais - minoritaires - qui
n'admettaient pas que la chapelle fût confiée aux
protestants et qui le firent connaître à la municipalité,
propriétaire des locaux. L'évêque de Saint-Etienne,
le Père Joatton, et le clergé montbrisonnais firent
pourtant savoir explicitement qu'ils approuvaient la demande
de la communauté protestante et le projet de transformation
de la chapelle en temple. La demande fut ajournée. Le
sujet avait même provoqué quelques passes d'armes
un peu vives au conseil municipal et l'on entendit même
les membres de l'opposition de gauche et de la majorité
municipale discuter du baptême dans un échange
qui prenait des allures de débat théologique !
La
décision du conseil municipal
Finalement, le temps, comme toujours, fit son œuvre d'apaisement.
En 1994, un accord intervint. L'ancienne chapelle Sainte-Anne
fut confiée, par un bail emphytéotique de 99 ans
à la communauté protestante du Forez, à
charge pour elle de respecter le caractère originel de
la chapelle (les vitraux), de faire les travaux nécessaires
et d'entretenir le bâtiment, ce qui fut approuvé
par un vote unanime du conseil municipal.
*
*
*
L'Eglise
réformée de France (ERF)
La création et les structures de l'ERF
La communauté protestante de Montbrison appartient à
l'Eglise réformée de France (ERF). Celle-ci s'est
organisée en 1938 et est issue de la réunion de
ses courants libéraux et orthodoxes qui s'étaient
constitués en diverses unions après la Séparation
des Eglises et de l'Etat en 1905. L'Eglise réformée
de France (ERF) est la plus importante Eglise protestante en
France, membre et cofondatrice de la Fédération
protestante de France (FPF).
Elle rassemble environ 110 000 " foyers connus " (familles
ou individus avec lesquels il y a un lien plus ou moins fort),
soit environ 400 000 personnes, avec un noyau actif de 50 000
foyers participants à sa vie financière, 492 associations
cultuelles (l'association cultuelle est la base légale
de l'Eglise locale), 881 lieux où le culte est célébré
plus ou moins régulièrement. L'Eglise réformée
de France compte 340 pasteurs (ministres) en poste dans les
Eglises, 70 autres pasteurs exercent leur ministère dans
des œuvres et mouvements. 29 % des pasteurs sont des femmes.
Il y a 28 couples de pasteurs.
Le synode national, annuel, a la charge de gouverner l'Eglise
réformée de France. Il est composé de 92
membres - laïcs et pasteurs, hommes et femmes - élus
par les huit synodes régionaux et par des membres à
voix consultative représentant les œuvres, mouvements,
institutions et équipes liés à l'Eglise
réformée.
L'ERF est donc membre de la Fédération protestante
de France qui rassemble 800 000 personnes. La Fédération
comprend, outre l'ERF, l'Eglise évangélique luthérienne
de France (EELF), l'Union des Eglises protestantes d'Alsace-Lorraine
(EPAL), les Eglises évangéliques et baptistes
et l'Eglise adventiste. La Fédération est présidée
depuis 2007 par le pasteur Claude Baty (de l'Eglise évangélique
de France) qui est ainsi le porte-parole des protestants français.
La tradition calviniste
L'ERF incarne, au sein du protestantisme français, la
tradition calviniste. Elle a adopté en 1938, au moment
de sa fondation, une déclaration de foi dont voici quelques
extraits :
" Fidèle aux principes
de foi et de liberté sur lesquels elle est fondée,
[…] elle affirme la perpétuité de la foi
chrétienne, à travers ses expressions successives,
dans le Symbole des Apôtres, les Symboles œcuméniques
et les Confessions de foi de la Réforme, notamment la
Confession de La Rochelle ; elle en trouve la source dans la
révélation centrale de l'Évangile […]
Elle affirme l'autorité souveraine des Saintes Écritures.
Elle proclame devant la déchéance de l'homme,
le salut par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ,
Fils unique de Dieu, qui a été livré pour
nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification
[…].
Pour obéir à sa divine vocation, elle annonce
au monde pécheur l'Évangile de la repentance et
du pardon, de la nouvelle naissance, de la sainteté et
de la vie éternelle.
Sous l'action du Saint-Esprit, elle montre sa foi par ses œuvres
: elle travaille dans la prière au réveil des
âmes, à la manifestation de l'unité du Corps
du Christ et à la paix entre les hommes. Par l'évangélisation,
par l'œuvre missionnaire, par la lutte contre les fléaux
sociaux, elle prépare les chemins du Seigneur jusqu'à
ce que viennent, par le triomphe de son Chef, le Royaume de
Dieu et sa justice. "

Eglise Sainte-Anne
(temple de Montbrison)
*
*
*
III.
La communauté protestante de Montbrison
Une
communauté récente
En 1996, lors de l'inauguration du temple, la communauté
protestante de Montbrison et du Forez représente environ
cent trente familles, dont une trentaine pratiquent régulièrement.
Leur pasteur était alors Sophie Zentz-Amédro,
une jeune femme mère de famille dont le mari achevait
ses études pour être, lui aussi, pasteur.
Les membres de cette communauté sont issus de plusieurs
régions de France mais surtout de la Haute-Loire et de
son fief protestant du Chambon-sur-Lignon.
Le protestantisme français était autrefois groupé
en quelques grandes communautés régionales, fortement
implantées en milieu rural : l'Alsace ; le Velay (Haute-Loire
actuelle), le Vivarais et le Dauphiné ; les Cévennes,
le Bas-Languedoc et la région de Nîmes ; le Poitou.
L'exode rural et la mobilité professionnelle des Français
les ont beaucoup dispersés, même si ces "bases"
régionales subsistent et gardent une forte identité.
De cette dispersion est née la communauté du Forez
qui commence à grouper quelques familles à Montbrison
avant la Deuxième Guerre mondiale : un pasteur venait
présider le culte qui, dans les années 1930, avait
lieu dans la salle des conférences (actuelle bibliothèque
municipale) et groupait une quinzaine de personnes. Mme Claire
Mazoyer jouait de l'harmonium et donnait aux enfants les cours
de l'Ecole du Dimanche (8).
Cette communauté s'organise, sur le plan ecclésial,
après 1945, autour de quelques familles : M. et Mme Degrémont,
qui étaient originaires du Cateau, dans le Nord, le Docteur
et Mme Eyraud, de Feurs, M. et Mme Stahl, de Montbrison, M.
Ruel, pharmacien à Veauche. D'autres familles viennent
ensuite renforcer cette petite communauté. En 1959, arrivent
Pierre Tauzia, nouveau principal du collège et son épouse
Jacqueline Tauzia, professeur de lettres, qui jouent un rôle
important dans la communauté. Mais on ne peut malheureusement
citer toutes les familles.
Les pasteurs se succèdent : le pasteur Brenner, le pasteur
Perrier et, plus récemment, deux femmes pasteurs, le
pasteur Bettina Cotin (9) et le pasteur Sophie Zentz-Amédro.
La communauté s'organise autour de l'Association cultuelle
des Eglises réformées de Saint-Etienne-Forez,
conforme à la loi de 1905 (10) ; en 1996, elle est administrée
par un conseil presbytéral élu, présidé
par Mme Geneviève Rey, de Saint-Etienne. La communauté
du Forez conserve une certaine autonomie et a un conseil de
secteur. Trois membres de la communauté du Forez, M.
Caddoux, Mme Ohier et Mme Stahl, siégeaient au conseil
presbytéral de Saint-Etienne. Les membres de la communauté
cotisent : la "cible" est le montant de la cotisation
par Eglise, fixé par le Conseil régional de l'Eglise
réformée de France.
Les lieux de culte restèrent longtemps provisoires :
une salle de la mairie, un local situé rue de la République
et après 1975, une salle de l'ancien hôpital (11).
Après toutes ces pérégrinations, l'installation
du temple de Montbrison est donc un événement
: le local est aménagé avec la simplicité
propre à un temple réformé ; cependant
les vitraux et leurs scènes historiées rappellent
et respectent l'ancienne destination du bâtiment : des
"images" dans un temple protestant (12).
Des travaux importants, financés par un emprunt de l'Association
cultuelle, ont été faits par la communauté
protestante : des boiseries habillent les murs de l'ancienne
chapelle et le chauffage a été installé.
Les vitraux ont été réparés. Des
aménagements améliorant l'acoustique (colonnes
de diffusion) ont été réalisés.
Dans le chœur, une chaire en bois et un orgue électronique
(13) ont été placés.
L'histoire
continue…
L'installation du temple de la rue Marguerite-Fournier a donné
à la communauté un cadre ecclésial plus
digne que les installations précaires qui l'avaient précédé
; elle lui a assuré une visibilité plus grande
dans la ville et a permis le développement d'autres activités.
Les
pasteurs
Depuis 1993, plusieurs pasteurs se sont succédé
:
- Sophie Zentz-Amédro a
été en poste à Montbrison de 1993 à
1998. Elle est devenue ensuite pasteur à Saint-Lô
avec son mari le pasteur Christophe Amédro. Ils sont
aujourd'hui (2008) en poste dans les Cévennes, fief historique
du protestantisme français. Sophie Zentz-Amédro
est à Saint-Hippolyte-du-Fort, Cros et Monoblet (Gard)
et Christophe Amédro au Coutach, à Sauve et à
Quissac (Gard). Sophie Zentz-Amédro a publié plusieurs
ouvrages destinés à la catéchèse
des enfants (14).
- Alain Arnoux, pasteur à
Montbrison-Forez de 1998 à 2005, est aujourd'hui dans
l'Est lyonnais et animateur régional pour l'évangélisation.
Il a publié en 2006 le Voyage à pied dans le Vivarais
et le Velay. Journal de mission du pasteur François David
Delétra (éditions Olivetan, collection Histoire
protestante régionale).
- Colette Chanas-Gobert est restée
un an (2006-2007) et est aujourd'hui à Crest (secteur
de l'Est Crêtois.
- Loïc de Putter, jeune pasteur
proposant (15), est pasteur à Montbrison et à
Firminy depuis 2007.
Les
membres de la communauté
L'importance de la communauté réformée
est la même qu'il y a douze ans (150 familles inscrites
sur les listes de Montbrison-Forez). Une vingtaine de personnes
assistent au culte à Montbrison.
L'endogamie religieuse qui était autrefois la règle
- on se mariait entre protestants - n'existe pratiquement plus.
La plupart des couples sont mixtes au point de vue religieux
: le ou la conjoint(e) sont catholiques. Autrefois, dans ce
cas-là, la tradition voulait que les garçons soient
de la religion du père et les filles de celle de la mère
(16). Aujourd'hui, la majorité des enfants sont élevés
dans la foi protestante - comme si appartenir à une minorité
donnait une force de conviction plus grande et exprimait la
nécessité vitale de se maintenir. Mais les protestants
ont les mêmes problèmes que les catholiques : la
pratique religieuse diminue, en particulier chez les jeunes.
Deux laïcs montbrisonnais - Janine
Treille et Sylvie Jacquelin - siègent en 2008
au conseil presbytéral de Saint-Etienne qui comprend
une quinzaine de personnes et qui est présidé
par Geneviève Rouanet. Marthe
Stahl a siégé pendant trente ans au conseil
mais a pris sa retraite. Agée de 90 ans (2008), elle
reste une référence et une autorité morale.
Le
culte
Le temple est d'abord, bien sûr, le siège d'une
activité cultuelle. Le culte a lieu un dimanche par mois
au temple de Montbrison, à 10 h 30 (les dates et les
heures sont affichées devant le temple) et aussi, un
autre dimanche du mois dans l'église catholique de Veauchette,
prêtée par le curé de cette paroisse. Cette
dualité de lieu est d'ailleurs aujourd'hui l'objet d'un
débat au sein de la communauté montbrisonnaise.
Le culte est marqué par l'importance de la Parole. Il peut y avoir un culte sans la Cène
mais pas sans lecture de la Bible ou prédication. Le
pasteur est d'abord le ministre de la Parole. Pendant le culte,
de nombreux cantiques sont chantés qui reprennent souvent
des psaumes.
Les deux seuls sacrements sont le baptême et la Cène :
- Le baptême : les enfants
sont soit baptisés directement après la naissance
soit présentés au temple (la présentation)
: ils reçoivent ensuite, s'ils le désirent, le
baptême.
- La Cène : pour les protestants,
la Cène, signe de la gratuité de l'amour de Dieu,
est célébrée en mémoire du Christ
et de sa Passion. La Cène se reçoit dans le pain
et dans le vin (17). Il n'y a pas la présence réelle
à laquelle croient les catholiques. La Cène a
un sens symbolique. Elle n'a de sens que dans la foi. Elle n'ajoute
rien à la parole de Dieu, elle ne fait que l'attester.
Partager le pain et le vin, c'est communier avec Dieu et communier
les uns avec les autres.
Les mariages et les funérailles sont de simples bénédictions
et n'ont pas de caractère sacramentel.
La
catéchèse et le groupe d'étude biblique
La catéchèse joue un rôle très important.
A Montbrison, elle a longtemps été assurée
par Christine Langue et Mia
Verchère. Elle l'est aujourd'hui par Hélène
Spatazza, Hassina Razahamanantso et Myriam Coutansou.
Un groupe d'étude biblique existe depuis longtemps. En
2008, il a rassemblé une dizaine de protestants et de
catholiques - dont deux sœurs augustines de Montbrison.
Le livre de Ruth (18) était soumis à l'étude
et à la réflexion de ses membres.
La
"nuit des veilleurs"
La communauté montbrisonnaise participe, chaque année,
dans le cadre de l'ACAT (Association
des chrétiens contre la torture) à la "nuit
des veilleurs" destinée à soutenir
par la prière ceux qui, à cause de leurs idées
ou de leur foi, sont victimes de la torture. Ces engagements
sont dans la tradition d'un protestantisme libéral engagé
dans la défense de la personne humaine et des valeurs
démocratiques.
La
semaine de prières pour l'unité des chrétiens
Depuis 1908, la Semaine de l'unité est célébrée
tous les ans, en janvier, par les chrétiens appartenant
aux différentes confessions. Dans sa forme actuelle,
elle existe depuis 1939. Les chrétiens se retrouvent
pour demander par la prière la grâce de "l'unité
que Dieu voudra, par les moyens qu'Il voudra." Un
thème de réflexion et de prédication, fondé
sur un passage de l'Evangile, est proposé chaque année.
Une célébration œcuménique a eu lieu
au temple de Montbrison, le 20 janvier 2008, avec le pasteur Loïc de Putter et un prêtre
de la paroisse Sainte-Claire. Dans les années précédentes,
les pasteurs Bettina Cottin et Sophie Zentz-Amédro avaient
prêché dans l'église Notre-Dame
d'Espérance, ce qui était un symbole fort
de l'unité..
Le
temple de Montbrison, lieu de culture
Le temple de Montbrison est aussi un lieu de culture :
- Des concerts (musique et chants) sont régulièrement
organisés.
- Des expositions ont été consacrées à
la Bible, au 5e centenaire de l'Edit de Nantes (1598-1998 -
avec visite de nombreux scolaires).
- Des conférences : j'ai eu l'honneur de faire au temple
de Montbrison, en 1996, une conférence sur la Réforme,
à la demande du pasteur Sophie Zentz-Amédro qui
souhaitait que le sujet soit traité "par
un historien qui ne soit pas protestant". En 2000, Thérèse Mascle, professeur
de lettres, et moi-même avons évoqué la
belle figure d'André Chamson (1900-1983), protestant cévenol, romancier (Les
hommes de la route, La tour
de Constance, La Superbe),
membre de l'Académie française, conservateur du
château de Versailles. Il fut pacifiste au nom de la Bible
(Roux le bandit) et résistant
parce qu'on ne peut plus être pacifiste face à
Hitler. André Chamson commanda, en 1944, avec André
Malraux, la célèbre Brigade Alsace-Lorraine.
Le pasteur André Gounelle,
professeur à la faculté de théologie de
Montpellier, est venu faire une conférence très
stimulante et accessible sur le thème ; " Qu'est-ce
qu'être protestant ? "
Ajoutons que le temple a fait l'objet d'une étude récente
à l'occasion de l'Inventaire du Patrimoine réalisé
par les services du même nom (les fiches du Patrimoine
seront ensuite disponibles sur Internet). Un ouvrage consacré
au canton de Montbrison sort en septembre 2008. Le temple est
régulièrement ouvert pour les journées
du patrimoine, le troisième dimanche de septembre.
La
kermesse
Chaque année la communauté protestante organise,
pendant un week-end de novembre, la kermesse qui a lieu dans
le temple (19). De nombreux objets fabriqués par les
membres de la communauté, des livres, des objets de brocante
sortis des greniers sont offerts à la vente. Les bénéfices
de la kermesse alimentent la "cible" versée
à l'Eglise réformée de Saint-Etienne-Forez.
Cette kermesse est un événement convivial. Un
repas a lieu dans le temple le dimanche à midi. On mange
le bæckehoff, plat alsacien aux trois viandes, longuement
mijoté avec des légumes dans une terrine et tout
à fait roboratif. C'est l'un des attraits de la kermesse.
Bref, cette kermesse est l'un des événements du
calendrier montbrisonnais.
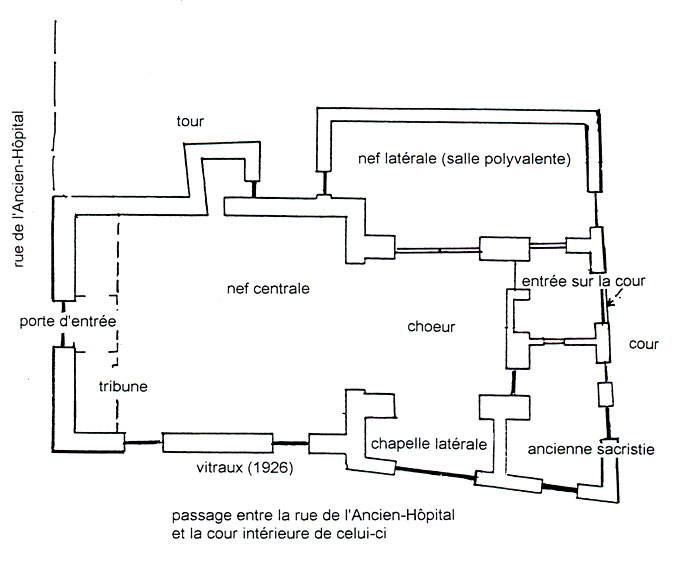
Plan
du temple de Montbrison
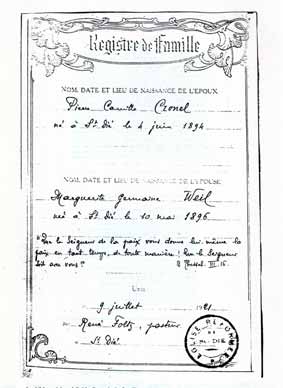
La
Bible est le véritable livrede
la famille protestante :
la bible de la famille Cronel, habitant à Montbrison
et originaire de Saint-Dié (Vosges), était précédée
d'un "registre de famille", véritable "livre
de raison"
dans lequel on inscrivait les événements familiaux (archives Pierre Cronel)
IV.
Une communauté à la recherche de ses racines
Au
siècle de la Réforme
Le fait d'être installée dans un monument historique
de Montbrison et de disposer d'un lieu de culte définitif
conduit tout naturellement la communauté protestante
à rechercher ses racines et à renouer les fils
invisibles qui la relient à la petite communauté
réformée qui a existé ici au XVIe siècle.
Certes, au XVIe siècle, la Réforme ne s'est pas
vraiment enracinée en Forez et, pendant les guerres de
religion, la province est restée dans le camp catholique.
On cite souvent le mot de Jean Papon, Grand Juge de Forez et
lieutenant général du bailliage qui déclarait,
en 1574, devant l'assemblée générale des
Trois Ordres réunie à Montbrison : "Quant
à l'Eglise, par tout ledict pays, Dieu y a toujours esté
servy selon les décrets de l'Eglise catholique et romaine."
La noblesse se groupait autour des d'Urfé qui constituèrent
une véritable dynastie de baillis : ces grands seigneurs,
qui avaient fait aménager la Bastie où le roi
était venu en 1536, maintenaient la fidélité
des gentilshommes de moindre importance et, ceux-ci, celle de
leurs paysans : "De la noblesse ne
s'en trouve pas un audict pays sur lequel on ayt pu prendre
soupçon de ceste religion (réformée)"
(J. Papon).
La bourgeoisie qui, sur le plan national, était souvent
gagnée par les idées de la Réforme, était
restée, en Forez, dans l'obéissance à l'Eglise
: elle avait le respect de l'autorité et de l'ordre moral
traditionnel. Et il n'y avait pas d'université, de collège,
d'imprimerie importante qui pût servir de relais aux nouvelles
croyances. L'attachement à la cause du "parti catholique"
fut, en outre, renforcé par le souvenir des atrocités
commises par le baron des Adrets lors de la prise de la ville
en 1562 (20).
Cependant, au XVIe siècle, des églises réformées
avaient été fondées en Forez à Bourg-Argental
(1561), Saint-Bonnet-le-Château (1562), Feurs (1562),
Saint-Galmier (1562), Saint-Etienne (1570) et Malleval. Des
communautés réformées existèrent
aussi à Charlieu, Saint-Rambert, Saint-Germain-Laval
(21), Montbrison. Trois éléments nous fournissent
la preuve de l'existence de la communauté de Montbrison
:
Les
protestants et la prise de la ville par le baron des Adrets
Pendant les guerres de religion, Montbrison est pris et mis
à sac par deux des principaux chefs protestants, le baron
des Adrets et le capitaine de Poncenat (1562).
Pendant
l'assaut donné à la ville, il y a dans Montbrison
des protestants qui le guident et combattent à ses côtés
; après la prise de Montbrison, certains acceptent des
postes de responsabilité. Les Mémoires manuscrits de Jean Perrin (22), châtelain de Montbrison,
nous donnent les noms de quelques-uns d'entre eux : Pierre Philippe,
dit Saduret, qui est nommé prévôt de Forez
; deux de ses archers, Marcellin Charbonnier et Raymond Cepery
; Jean Dalmais (ou Dalmès), un notable qui est élu
de l'élection de Forez (23) ; Antoine Niolly, Jean Bombardier,
Claude Purveray, fils d'Alexandre Purveray, barbier de la ville
et Jean de Vau, serrurier (24). Après cette liste de
noms, Jean Perrin ajoute d'ailleurs ; "et
plusieurs aultres de la dicte ville". Et si, pendant
la période où s'exerce l'autorité du baron
des Adrets, des pasteurs prêchent dans la collégiale
Notre-Dame, c'est qu'il y a des gens pour les écouter.
Après
le départ du baron des Adrets - qui tient la ville pendant
trois semaines - la plupart des membres de la petite communauté
protestante se dispersent pour échapper aux représailles.
Ceux qui sont restés quittent la ville dans les années
qui suivent.
La
dispersion
Le livre des habitants de Genève qui enregistre au XVIe
siècle l'arrivée des protestants venus se réfugier
dans la ville dirigée par Calvin mentionne les noms de
deux Montbrisonnais (25) : Maurice Pélisson, orfèvre,
arrivé en 1557 et Guillaume Matin, "espinglier"
(fabricant d'épingles ?), entré à Genève
en 1573. Cette dernière date est particulièrement
intéressante à noter car elle montre que, onze
ans après le passage du baron des Adrets, la communauté
protestante de Montbrison n'était pas complètement
dispersée. Les émigrés avaient d'ailleurs
dû garder des liens avec ceux qui étaient restés
à Montbrison : en 1773, lorsque Guillaume Matin arrive
à Genève, c'est Maurice Pelisson, arrivé
seize ans auparavant, qui lui sert de témoin (26).
Il existait à Montbrison un "cimetière
des huguenots", mentionné sur un plan de
1775 (27). Redécouvert en 1906, lors du creusement des
fondations d'une maison, il était situé "hors
les murs" à peu près à l'emplacement
actuel de l'entreprise Combat, sur le boulevard Lachèze.
C'était un cimetière annexe de celui de l'hôpital
et de la paroisse Sainte-Anne, ouvert en 1545 pour enterrer
les pestiférés. Il devint ensuite le lieu d'inhumation
des protestants (28). Cette existence d'un cimetière
confirme qu'il y avait eu (29) à Montbrison une communauté
réformée puisqu'elle y enterrait ses morts : "au-delà
des fossés", c'est-à-dire en dehors
de la ville délimitée par ses remparts (30) et,
sans doute, en dehors de l'espace consacré du cimetière
catholique.
Mais entre la dispersion de la petite communauté - pour
l'essentiel, dès la fin du XVIe siècle - et le
XIXe siècle, il ne nous paraît pas y avoir eu à
Montbrison de communauté réformée. Après
1685 - Révocation de l'édit de Nantes - nous ne
trouvons, dans les registres paroissiaux, ni baptêmes
ni actes d'abjuration de membres de la "R.P.R." ("Religion
Prétendue Réformée") comme
on disait alors...
Au XVIIIe, nous avons trouvé un seul événement
: un aubergiste d'origine suisse abjure et se fait baptiser,
sans doute pour pouvoir continuer à exercer son métier
: il a créé, rue Tupinerie, le premier café
montbrisonnais (31): pendant la Révolution, les royalistes
de la ville se réunissent ainsi "chez les Suisses…"
Au XIXe siècle, le protestantisme n'est représenté
à Montbrison que par quelques individualités :
fonctionnaires, magistrats ou officiers de passage dans le chef-lieu
du département qui est aussi siège de la cour
d'assises et ville de garnison...
Puis, comme on l'a dit, l'exode rural et la mobilité
géographique et sociale de la France des "Trente
Glorieuses" conduit à Montbrison et dans le Montbrisonnais
des familles protestantes venues d'horizons très variés,
avec cependant une majorité de gens dont l'origine se
trouve sur les plateaux de la Haute-Loire.
Le
présent et le passé
Le rôle et la passion de l'historien sont de ressusciter
et de déchiffrer le passé ; mais l'historien n'est
pas un simple érudit perdu dans la poussière des
archives. Il aime aussi son époque et essaie de la comprendre
: un temple à Montbrison, c'est un événement
du présent, avec des hommes et des femmes rassemblés
dans un bâtiment chargé d'histoire et qui, symboliquement,
s'ouvre directement sur l'une des rues les plus anciennes et
les plus passantes de la cité. Pour un catholique, il
était émouvant d'y avoir été invité
et son remerciement aura été d'apporter quelques
éléments d'histoire - de leur histoire - à
ceux qui ont désormais l'usage et la charge de l'ancienne
chapelle de l'hôtel-Dieu. C'est aussi notre histoire puisqu'elle
s'inscrit, hier et aujourd'hui, dans celle de la cité
tout entière.
Ce temple est ainsi, selon la belle expression popularisée
par l'historien Pierre Nora, un lieu de mémoire. Il nous
a permis quelques aller-retour entre le passé et le présent
de la chapelle de l'hôtel-Dieu devenue temple protestant,
entre les religieuses augustines et les réformés
qui ont prié et qui prient ici le même Dieu.
Claude
Latta
Notes
de la deuxième partie
(1) Deuxième livre de Samuel, 7, prophétie
de Natân.
(2) Joseph Barou, " L'église et la paroisse Sainte-Anne
de Montbrison ",Village de Forez, n° 17, p. 19-22
et n° 18, p. 19-22, 1984.
(3) Identification proposée par Joseph Barou (le bandeau
et le livre figurent dans les attributs de la Vierge).
(4) Témoignage Marthe Stahl, 24 juin 2008. Suzanne
Philidet a exposé ses œuvres en juin-juillet 2008
dans trois églises du Pilat dans le cadre de la l'exposition
" Lumières du verre ", IIIe biennale du verre
de Pélussin.
(5) Ils sont identifiés par une inscription sur chaque
vitrail, sauf celui qui occupe l'oculus de la façade.
(6) Jean Bruel, " L'église Sainte-Anne à
Montbrison ", Bulletin de la Diana, tome L, n° 4,
1987, p. 205-210.
(7) [Docteur Eugène Rey], Historiettes foréziennes
et vieux souvenirs, extrait des mémoires d'un Montbrisonnais,
Montbrison, Librairie Emile Faure, imprimerie E. Brassart,
2 volumes tirés à cent exemplaires, 1896.
(8) Témoignage de Pierre Cronel, 7 mai 1996, 27 et
28 juin 1996.
(9) Le pasteur Bettina Cottin est actuellement pasteur de
l'Eglise réformée d'Enghien et de ses environs.
(10) La loi de Séparation de
l'Eglise et de l'Etat (1905) a prévu des associations
cultuelles (et non pas culturelles, comme on le trouve souvent
écrit) ; ces associations sont chargées de l'organisation
du culte.
(11) Je remercie Mme Stahl de ses témoignages (entretiens
du 16 avril 1996 puis du 24 juin 2008).
(12) Dans un temple, il n'y a pas, en principe de représentation
de la Divinité, à plus forte raison, de la Vierge
ou des saints dont le culte est condamné : "Toute
et chaque fois qu'on représente Dieu en image, sa gloire
est faussement et méchamment corrompue" (Calvin
: Institution de la religion chrétienne, 1559. Cité
par Olivier Christin, Les Réformes. Luther, Calvin
et les protestants, Paris, Gallimard, coll. Découvertes,
1995, p. 143.).
(13) Cet orgue a été prêté par
l'association des Amis des Orgues.
(14) Hélènette Gourdon, Michèle Mélières
et Sophie Zentz-Amédro, Regards d'artistes, Paris,
SED (Société des Ecoles du Dimanche), 2001,
3 vol. : Des peintres, sculpteurs interprètent la Bible
et les fêtes chrétiennes, 2001 : De Pâques
à … Pentecôte, 2001 ; La Nativité,
2001. Sophie Zentz-Amédro et Nicolas Fels, Jonas, Paris,
SED, 2002 et Jonas : Un conte théologique et humoristique.
Matériel pédagogique, Paris, SED, 2002.
(15) Pour être ordonné pasteur, il faut être
titulaire d'un DESS de théologie, avoir exercé
dans une paroisse une fonction de "pasteur proposant"
pendant 1 ou 2 ans. A l'issue de ce cursus, et après
acceptation des différentes instances concernées
(Commission des Ministères régionale et nationale)
le (ou la) futur(e) pasteur peut être admis(e) à
l'ordination au ministère pastoral.
(16) Témoignage Marthe Stahl, 24 juin 2008.
(17) Rappelons que, pour les catholiques, l'Eucharistie rend
le Christ présent dans l'hostie consacrée.
(18) Le Livre de Ruth est un livre de la Bible hébraïque,
classé parmi les livres historiques de l'Ancien Testament
chrétien. L'histoire de Ruth se déroule à
l'époque où les Juges dirigeaient le peuple
d'Israël. Ruth, une Moabite, c'est-à-dire une
femme étrangère, est non seulement entrée
dans le peuple d'Israël mais est devenue l'ancêtre
du roi David et donc du Christ.
(19) Avant 1996, la kermesse avait lieu à la salle
des fêtes de Montbrison puis au collège Victor-de-Laprade.
(20) Cf. nos travaux sur ce sujet :
- Claude Latta, " La prise de Montbrison par le baron
des Adrets et le capitaine de Poncenat (1562) ", Village
de Forez, n° 44, octobre 1990.
- Claude Latta, Marie-Claude Mioche et les élèves
du lycée de Beauregard (Montbrison), " Evénement
et mémoire : la prise de Montbrison par le baron des
Adrets ", in Renaissance européenne et phénomènes
religieux 1450-1650, Actes du colloque du Festival d'Histoire
de Montbrison 1990, Montbrison, 1990, p. 425-441. Tout cela
a été bien analysé par Claude Longeon,
Une province française à la Renaissance. La
vie intellectuelle en Forez au XVIe siècle, Saint-Etienne,
Centre d'Etudes Foréziennes, 1975.
(21) Il existe encore à Saint-Germain-Laval une "rue
des Huguenots".
(22) Manuscrits de La Mure, fonds ancien de la Diana, 3 vol.
Ces manuscrits reproduisent les témoignages de contemporains
: parmi eux, celui de Jean Perrin.
(23) L'élection est une circonscription financière
et fiscale, soumise à la juridiction des élus
; ceux-ci, détenteurs d'une charge vénale et
héréditaire, répartissent la taille entre
les communautés de leur ressort et jugent les litiges
concernant la taille et les privilèges fiscaux.
(24) Manuscrits de La Mure, op. cit.
(25) Claude Longeon, " Documents sur la Réforme
en Forez ", Bulletin de la Diana, Tome XL, n° 2,
1967, p. 87-104.
(26) Longeon, art. cit., p. 91.
(27) Carte de Montbrison à Bellegarde levée
par le sieur Argoud (1775), Archives de la Diana, I C 9. renseignement
communiqué par Joseph Barou.
(28) Joseph Barou, " 1906 : les Montbrisonnais retrouvent
le cimetière des Huguenots ", La Gazette, 6 octobre
2006.
(29) Le document ne nous dit pas si ce "cimetière
des huguenots" est encore utilisé en 1775 où
s'il s'agit d'un lieu-dit rappelant l'existence ancienne,
à cet endroit-là, d'un cimetière protestant.
(30) A Feurs, les protestants avaient aussi leur cimetière
"proche des fossés de la ville, vers la tour de
Donzy". Cf. Jean-François Duguet, Mémoire
inédit : observations sur la ville de Feurs, Recueil
des mémoires et documents sur le Forez publiés
par la Société de la Diana, tome VI, 1880, p.
26. Cf. aussi Longeon : La vie intellectuelle..., op. cit.,
p. 35.
(31) Etablissement où on sert du café. Cette
boisson devient alors à la mode au XVIIIe siècle.
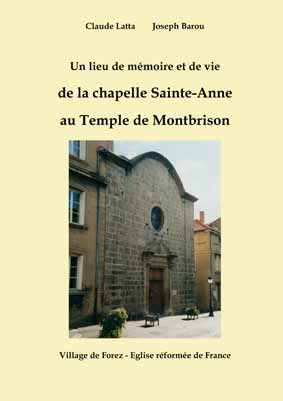
N° 52 - Barou (Joseph), Latta (Claude),
Un lieu de mémoire et de vie :
de la chapelle Sainte-Anne au temple de Montbrison,
préface du pasteur Sophie Zentz-Amédro, septembre 2008.
Un
cahier de 36 pages a été publié par Village
de Forez.
Il reprend
l'histoire de la chapelle Sainte-Anne
et celle de la communauté protestantede
Montbrison.
il
est disponible : au Centre social de
Montbrison 13, place Pasteur, 42600
Montbrison
tél. : 04-77-96-09-43
courriel
: centresocial.montbrison@laposte.net
*
* *

Chapelle Sainte-Anne (mai
1936)
fonds Brassart, archives de La Diana

Les religieuses augustines
dans le choeur de la chapelle Sainte-Anne
fonds Brassart,
archives de La Diana
Vitraux
de la chapelle Sainte-Anne

Le Christ thaumaturge,
offert par Madame de Bichirand, bienfaitrice de l'Hôtel-Dieu
Le
vitrail de la chapelle sud est consacré au Christ thaumaturge.
Plusieurs guérisons
sont représentées sur ce vitrail : un mort se
lève de son cercueil ; un infirme appuyé
sur une béquille et une femme portant son enfant mort
se présentent au Christ.
Ce vitrail a été réparé en 1995
par Suzanne Philidet, vitrailliste à Pélussin.

Le Christ thaumaturge (détail)
Notre-Dame de Délivrance, couronnée,
et tenant l'Enfant Jésus, nimbée
des rayons du soleil,
apparaît
aux malades et aux malheureux qui tendent les
bras vers elle.

Notre-Dame de Délivrance
(détail)
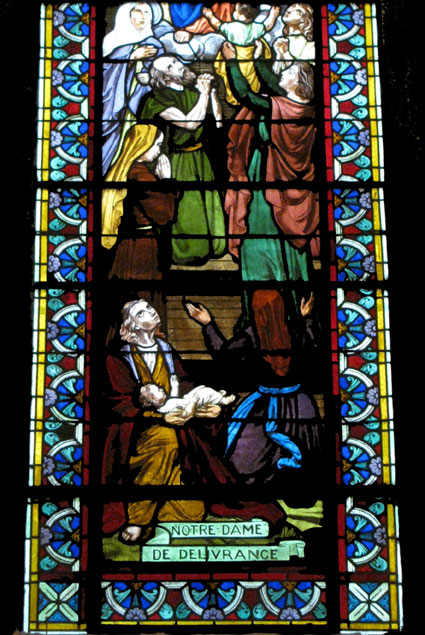
Notre-Dame de Délivrance
(détail)
Chapelle nord

Au
dessus de la tribune - ce qui correspond
extérieurement
à la façade -, un beau vitrail,
traité dans des tons pastel,
représente la rencontre de la Vierge
et d'Elizabeth, agenouillée devant
elle.
Zacharie est à l'arrière-plan,
à droite.
Mort
de Saint Joseph
La
mort de saint Joseph, scène
rarement montrée :
saint Joseph est identifiable
grâce à ses outils
de menuisier accrochés
au mur ;
le Christ, debout, lui tient
la main ; la Vierge est agenouillée
au pied du lit.
Le
saint curé d'Ars
Le
curé d'Ars, devant son
église,est
"au milieu des affligés"
et
impose les mains à une
petite fille debout devant lui.
textes
et documentation
Joseph Barou
questions, remarques ou suggestions
s'adresser :
|
|
14 décembre 2014
|
|
|
|
|