| |
un
monument disparu :
Le
prieuré Sainte-Croix
de Savigneux
Où
se trouvait le Savigneux d'autrefois ? Que reste-t-il de son
prieuré ? Peu de chose.
C'est
pourtant à ce vénérable prieuré
bénédictin que la commune doit son existence.
Vers l'an mil, Montbrison n'existe pas encore. Et déjà, quelques moines
se sont installés, près d'une modeste église,
au bord du Vizézy, sur un
terrain marécageux concédé par un comte
de Lyon et de Forez. Voici Savigneux,
le lieu-dit aujourd'hui nommé Bicêtre.
L'église primitive du XIe siècle est reconstruite, sauf le chœur, au XIIIe
siècle par Guillaume de
la Roue. Ce moine de la Chaise-Dieu,
prieur de Savigneux de 1233 à 1262,
devient ensuite évêque du Puy.
Le prieuré, connu d'abord sous le nom de Saint-Nizier est ensuite appelé Sainte-Croix.
Une note de 1699 indique que l'église
n'a rien de beau ou éclatant". Elle
a deux clochers, un grand et un petit : Le
clocher est assez considérable, c'est une tour quarrée... Le prieur dom Pierre Sauret fit faire
un petit clocher sur la jonction des voûtes de la nef
et de la croupe de l'église .
En 1765 le grand clocher est
en mauvais état. Il contient deux bourdons tandis que
le petit clocher abrite trois petites cloches. L'église,
moins grande mais plus fine que Notre-Dame de Montbrison,
a trois nefs d'un beau style gothique. Les baies sont très
élancées : 10,50 m de hauteur pour 0,70 m de
largeur. Outre le maître-autel réservé
au prieur, il y a deux chapelles au bout des nefs latérales,
une pour le curé de la paroisse, l'autre dédiée
à la Vierge. Une troisième chapelle est située
sous le clocher. L'intérieur est orné de retables
baroques.
Démolition
A défaut de gravures, reportons-nous aux souvenirs
d'Auguste Broutin, témoin
oculaire de la démolition : Nous
croyons la voir encore, vers 1825… Ses piliers, composés
chacun d'un faisceau de colonnettes gothiques, ne supportaient
plus les voûtes effondrées de ses nefs. Deux
rosaces, dépouillées de nervures et de vitraux,
laissaient passer aux deux bras du transept un jour sans mystère,
et les grandes baies du chœur livraient à tous
les orages le sanctuaire désert...
Octave de la Bâtie nous apporte aussi quelques informations sur l'aspect du clocher.
Ce sont de lointains souvenirs d'enfance : Dans
ma jeunesse, en venant à Montbrison, mon attention
était attirée par le clocher de Savigneux qui
me semblait faire le pendant du clocher actuel de Notre-Dame
d'Espérance : deux rangs de fenêtres placés
comme l'un au-dessus de l'autre… Quand je le vis disparaître
cela me fit un véritable chagrin tant il me semblait
instinctivement que cela gâtait le paysage…
Passe la Révolution.
Le prieuré est vendu comme bien national, la paroisse
supprimée. Les bâtiments en mauvais état
servent de dépôt de mendicité puis d'asile.
En 1830, un entrepreneur en bâtiments,
le sieur Zanoly de Montbrison,
possèdent les ruines. Il en vend peu à peu les
matériaux jusqu'à la totale disparition de l'église.
Plusieurs maisons de Montbrison sont bâties avec ses
pierres rue des Moulins, quai
des Eaux-Minérales, boulevard Lachèze et rue Saint-Jean.
Que reste-t-il de
Sainte-Croix ?
En 1850, selon Ogier, une magnifique
ferme est installée dans les dépendances
du prieuré. Et aujourd'hui, de l'ancien prieuré,
il ne reste plus rien, sinon, peut-être un portail marqué
d'une date. Et c'est bien dommage pour Savigneux…
Joseph Barou
[la Gazette du 24 août 2007]
*
* *
Le prieuré
Sainte-Croix de Savigneux
Fondation
du prieuré
Les communes actuelles sont, pour la plupart, issues des paroisses
de l'Ancien Régime qui correspondaient elles-mêmes
à des communautés d'habitants fort anciennes. Pour
comprendre la situation actuelle de Savigneux, ses limites territoriales
et sa proximité d'avec Montbrison, il est indispensable
de connaître son histoire sur le plan religieux. Cette histoire,
jusqu'à la Révolution, se confond pratiquement avec
celle de son prieuré car Savigneux doit son existence aux
disciples de saint Benoît.
On a peu de précisions sur la fondation du prieuré
de Savigneux qui intervient avant l'an mil. Selon Auguste Broutin
elle aurait eu lieu en 930 à l'initiative d'un comte de
Lyon et de Forez, Gérard ou Arthaud 1er, mais la charte
de fondation ne nous est pas parvenue. Pierre Roger Gaussin, très
prudemment, indique qu'il pourrait avoir été fondé
par les comtes de Lyon et de Forez au Xe siècle et qu'il
est attesté dès 1116 .
Quelques moines bénédictins installent au bord du
Vizézy un petit monastère dédié d'abord
à saint Nizier puis à la Sainte Croix au lieu aujourd'hui
nommé Bicêtre. Ils entreprennent de défricher
le voisinage, un territoire peu engageant, bas, humide et couvert
de forêts. A deux kilomètres plus au sud se trouvent
les restes de la ville gallo-romaine de Moingt (Aquae Segetae)
et réduite à un petit village après avoir
été ruinée au IIIe siècle par les
invasions germaniques.
Bien que modeste le prieuré bénédictin de
Savigneux n'en est pas moins le plus ancien établissement
religieux de la région si l'on excepte, peut-être,
une petite chapelle dédiée à la Vierge Marie
qui aurait été incluse dans l'enceinte d'un premier
château sur la butte volcanique de Montbrison. C'est aussi
l'un des plus anciens monastères du Forez après
Montverdun et Ambierle.
Cette ancienneté fait que le prieuré a juridiction
ecclésiastique sur un vaste territoire qui correspond aujourd'hui
aux communes de Montbrison, Savigneux, Moingt, Chalain-le-Comtal
et Boisset-lès-Montrond. Montbrison se réduit d'ailleurs,
vers l'an mil, à un petit village situé en bordure
du grand chemin de Forez près du ruisseau venant de Curtieu,
à l'emplacement de l'actuel faubourg de la Madeleine. L'église
dédiée à sainte Marie-Madeleine dépend
de la paroisse de Savigneux qui est, elle-même, sujette
du prieuré.
La paroisse de Savigneux
Les gens du voisinage fréquentent l'église du
prieuré et jusqu'en 1115 le prieur exerce directement
les fonctions de curé avec l'aide d'un moine comme vicaire.
La paroisse ainsi jointe au prieuré de Savigneux est
placée sous le vocable de saint Nizier. Après
le XIIe siècle, le prieur reste le curé primitif
et nomme à la cure de Savigneux, aux cures des paroisses
de Montbrison (Sainte-Madeleine, Saint-Pierre et Saint-André)
et de Saint-Julien de Moingt. Cette dernière paroisse
a comme annexe Sainte-Anne à Montbrison.
Cependant, le lieu étant trop inhospitalier, le prieuré
n'attire pas, semble-t-il, autour de lui beaucoup d'habitants
des environs.
Jusqu'au XVIIIe siècle il reste isolé contrairement
à ce qui se passe en d'autres lieux, à Champdieu
par exemple où une agglomération se forme auprès
du prieuré. La population peu nombreuse est éparpillée
dans des hameaux anciens mais chétifs avec, ici et là,
quelques châteaux ou maisons fortes : Cromirieu (Crémérieux),
Foris, Merlieu, Bullieu, Vaure...
En revanche une décision politique va décider
du développement de Montbrison. Vers 1075-1080, le comte
Arthaud II qui est en conflit avec l'archevêque de Lyon
fait bâtir - ou agrandir - le château sur la colline,
forteresse qui commande le grand chemin de Forez. En 1173, le
comte de Forez et l'archevêque de Lyon mettent un terme
à leur long conflit. Guy II abandonne ses possessions
en Lyonnais et Montbrison devient la capitale et le centre de
ses possessions.
Une agglomération se forme entre le château et
le Vizézy suivant l'axe nord-sud déterminé
par le chemin déjà existant. Les paroisses de
Saint-Pierre et surtout de Saint-André prennent de plus
en plus d'importance. Au XIVe siècle, Montbrison, en
plein essor, atteint une population de plus de 4 000 habitants,
nombre important pour l'époque. De 1428 à 1438,
la ville s'entoure d'une enceinte fortifiée. Le développement
de Montbrison ruine ainsi pour Savigneux toutes chances de devenir
une ville.
Selon une note datée de 1699 d'un auteur resté
anonyme , il y aurait eu autour du monastère un bourg
considérable qui aurait subsisté jusqu'au XIIe
siècle. Ce village se serait totalement dépeuplé
quand les comtes de Forez résidant à Montbrison
attirèrent les habitants en faisant faire une grande
enceinte de murailles autour de leur château situé
sur un rocher qui domine sur la plaine. Et, ajoute-t-il, les
guerres firent hâter le reste des habitants de Savigneux
de se renfermer dans la clôture nouvelle de ce fort, tellement
qu'à peine est-il resté une petite maison près
le monastère. L'explication est plausible mais il n'y
a, vraisemblablement, jamais eu beaucoup d'habitations autour
du prieuré. Et il est bien vrai que sur le plan dressé
en 1775 par le sieur Argoud, ne figure qu'une seule petite maison
dans le voisinage de Sainte-Croix.
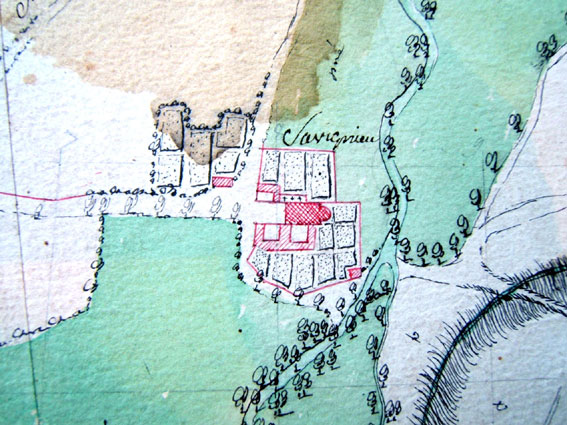
Extrait du plan
d'Argoud de 1775 (archives de la Diana)
Sous
la tutelle de la Chaise-Dieu
Le prieuré de Savigneux passe en 1116 sous la dépendance
de la puissante abbaye de la Chaise-Dieu. Il suit en cela d'autres
prieurés foréziens : ceux de Montverdun, l'Hôpital-sous-Rochefort,
Sainte-Eugénie de Moingt. Au XIIIe siècle cette
grande abbaye, la Rome auvergnate, a plus de trois cents moines
et de très nombreux prieurés, non seulement en
Auvergne mais aussi dans les provinces voisines et même
en Italie et en Espagne.
Avec onze moines, le prieuré de Savigneux a alors une
certaine importance puisqu'il compte trois "bénéfices"
comme ceux de Saint-Romain-le-Puy ou de Champdieu : celui du
prieur, celui du sacristain et un autre dit de la chapelle de
Saint-Thomas alors que nombre d'autres prieurés n'en
ont qu'un seul comme ceux de Moingt, Gumières, Marcilly,
Bard, Sail-sous-Couzan, Rochefort, Montverdun et Feurs (Randans).
Le prieur percevait des droits à Savigneux, Barges et
Boisset. Il recevait aussi des hommages comme, en 1251, celui
de Gaudemard d'Ecotay qui avait repris en fief les biens du
prieuré dans les paroisses de Savigneux et Moingt ou,
en 1313, celui de Pierre du Vernet pour ses biens à Boisset
.
Le
prieuré et les établissements religieux du voisinage
Toute la politique des prieurs va consister, au cours des siècles,
à essayer de préserver leurs droits et prérogatives
sur les établissements religieux voisins. Il en résulte
une interminable série de procès avec différents
niveaux de procédures et des appels successifs : le comté
de Forez, l'abbaye de la Chaise-Dieu, l'archevêché
de Lyon, le Saint-Siège à Rome. De temps à
autre, quand les plaideurs se lassent, une transaction aboutit.
Notons quelques dates pour situer les principaux différends
:
- 1193 : différend avec les hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem
(commanderie dans le faubourg de Montbrison du même nom).
- 1198 : transaction entre Arthaud, prieur de "Savignieu-les-Montbrison"
et Pierre, maître et recteur de la maladrerie Saint-Lazare
de Moingt ; un moine de Savigneux sera aumônier de Saint-Lazare.
- 1198 encore : conflit entre Guy IV, comte de Forez et le prieur
de Savigneux à propos du terrain sur lequel doit être
bâtie Notre-Dame de Montbrison. La charte de fondation
du chapitre de la collégiale est tout de même promulguée
le 5 juillet 1223.
En 1224, l'archevêque de Lyon, Renaud, oncle de Guy IV,
donne raison au comte de Forez contre le prieur.
Le prieur en appelle à Rome et demande la démolition
de l'église dont le chœur est déjà
bâti. Il faut un bref du pape Honoré III, le 7
mai 1225, pour arriver à un arrangement entre les deux
parties : le prieur conserve ses droits de patronage. Le territoire
en question reste - indirectement - à la paroisse de
Savigneux. La chapelle Sainte-Anne, qui sert aussi à
l'aumônier de l'hôpital, sera desservie par un vicaire
du curé de Moingt, lui-même nommé par le
prieur. De plus une redevance sera versée par les chanoines
de Notre-Dame. En contrepartie, le prieur doit accepter la construction
de la nouvelle église.
- 1212 : procès intenté contre le "vicaire
perpétuel de Saint-André". En 1423 la paroisse
Saint-André, la plus peuplée de Montbrison n'a
pas encore de fonts baptismaux. On n'y célèbre
ni les mariages ni les funérailles.
- 1233 : conflit du même type que celui qui avait opposé
le prieur aux chanoines à cause de l'hôpital de
Montbrison qui avait été transféré
de l'enceinte du château sur la rive droite du Vizézy.
- 1277 : procès entre le prieur et la commanderie de
Saint-Antoine installée près de l'église
de la Madeleine à Montbrison.
- 1327 : traité passée entre le prieur et les
chanoines à propos du cimetière de Notre-Dame.
- 1431 : procès entre le prieur d'une part, le chapitre
de Notre-Dame et les Cordeliers d'autre part pour des questions
d'inhumation.
- 1448 : fin d'un litige entre le prieur de Savigneux et le
prieur de Moingt (en quelque sorte la Chaise-Dieu contre la
Chaise-Dieu) au sujet des limites des terroirs sur lesquels
chacune des parties levaient la dîme. Un accord intervient
le 16 avril entre l'abbé de la Chaise-Dieu, agissant
comme prieur de Moingt et le prieur de Savigneux .
- 1452 : transaction passé par le prieur Jean de Dyo
et plusieurs particuliers à propos de l'étang
.
- 1468 : accord entre le prieur de Savigneux et le chapitre
de Notre-Dame au sujet de leurs droits respectifs...
Ces querelles qui nous paraissent aujourd'hui des broutilles
montrent à quel point, dans la société
moyenâgeuse, les droits étaient imbriqués
et combien chacun tenait à ses prérogatives, si
minimes fussent-elles.
L'essor de Montbrison devenue capitale comtale gêne, bien
sûr, le prieuré tout proche. Les efforts déployés
par les prieurs freinent un peu son déclin. Cependant,
de procès en transactions, le prieuré perd peu
à peu la plus grande partie de son ancienne suprématie.
Progressivement, les paroisses montbrisonnaises s'émancipent,
obtenant fonts baptismaux et cimetières. Il ne lui reste
au prieur de Savigneux qu'une primauté d'honneur.
A la fin du XIVe siècle, selon les renseignements fournis
par les pouillés diocésains, le prieuré
de Savigneux apparaît encore comme un établissement
relativement riche parmi les maisons casadéennes. Ses
revenus le placent immédiatement après la Chaise-Dieu
et Gaillac .
Quelques
prieurs parmi les plus notables : abbé, évêque,
pape...
Frère Guillaume de la Roue, un prieur de Savigneux, moine
profès de la Chaise-Dieu, est choisi comme évêque
du Puy à cause de ses mérites. Il est sacré
par Urbain IV en 1263 et meurt en 1282 ayant rempli dignement
son office.
En 1250 frère Pierre de Vertolet est prieur de Savigneux.
Les moines de l'Ile-Barbe le choisissent comme abbé pour
remplacer son frère Geoffroi de Vertolet mort en 1268.
Pierre est considéré comme un bienfaiteur de l'abbaye
lyonnaise.
Mais le plus célèbre prieur de Savigneux est sans
conteste Pierre Roger. Issu d'une famille de petite noblesse
du Limousin il rentre très jeune à l'abbaye de
la Chaise-Dieu puis poursuit de brillantes études. Il
commence son éblouissante "carrière"
dans les ordres sacrés en devenant pour une courte période
prieur de Savigneux, avant de diriger une abbaye, de grands
diocèses et enfin toute la chrétienté quand
il devient le pape Clément VI dit le Magnifique (voir
encadré).
Le pape Clément VI le Magnifique : un ancien prieur de Savigneux

Pierre Roger (1291-1352),
qui fut prieur de Savigneux,
devenu le pape Clément VI
de 1342 à 1352 |
Pierre
Roger, second fils de Guillaume Roger et de son épouse
Guillaumette de la Monstre, est né en 1291 à
Rosiers d'Egletons (Corrèze).
Ce rejeton de la petite noblesse limousine est reçu,
en 1302, à l'abbaye de la Chaise-Dieu à l'âge
de dix ans. Profès dès 1305, il étudie
ensuite à Paris où, en 1323, il reçoit
la maîtrise et la licence en théologie. En
1326, il est déjà chargé de cours à
la Sorbonne et devient proviseur de ce collège.
Il est prieur de Savigneux pour une brève période
car il cède très vite sa charge à Maurice
de Châteauneuf. Il devient ensuite abbé de
Fécamp puis évêque d'Arras. En 1329,
il est archevêque de Sens, en 1330, archevêque
de Rouen. La même année, Philippe VI de Valois
qui apprécie son intelligence et son sens de la diplomatie,
le nomme chancelier du royaume. On le retrouve chargé
d'ambassade en Angleterre et en Avignon, auprès du
pape Jean XXII. En 1338, Benoît XII le fait cardinal. |
Pierre
Roger est élu pape, au premier tour et à l'unanimité,
le 7 mai 1342, sous le nom de Clément VI. Il continua
la tradition de Clément V qui avait choisi comme résidence
Avignon en 1309.
Son pontificat de 1342 à 1352 représente l'âge
d'or de la papauté avignonnaise (1342-1352). Bien qu'ancien
moine bénédictin, il déteste l'austérité.
Il dépense sans compter, dilapide les finances du Saint-Siège
mais y gagne le titre de "Clément le Magnifique".
Il s'entoure d'une cour brillante, fait décorer le palais
des Papes et entreprendre de nombreux travaux dont la restauration
du pont d'Avignon. Il rachète à la reine Jeanne
de Sicile la ville d'Avignon pour 80 000 florins d'or. Amoureux
des arts et mécène, il protège les artistes
dont le poète Pétrarque devenu son ami.
Il favorise aussi sans vergogne sa famille
et ses compatriotes limousins. Il dira après son élection
: "Je planterai dans l'Eglise de Dieu un tel rosier
de Limousin, qu'après cent ans il aura encore des racines
et des boutons".
A côté de ces défauts bien visibles, la
fin de son pontificat met en valeur un beau comportement que
les historiens lui reconnaissent volontiers. Lors de l'épidémie
de peste qui ravage Avignon, Clément VI refuse de fuir
la ville, fait soigner les malades et prend en charge les orphelins.
Surtout, il défend avec vigueur les Juifs qui sont accusés
d'avoir provoqué l'épidémie . Faisant preuve
d'ouverture d'esprit il autorise les autopsies et lutte contre
le fanatisme en interdisant en 1349 les processions de flagellants.
En
1414 le prieuré de Valfleury (lieu de pèlerinage,
à 5 km de Saint-Chamond) est annexé par Savigneux.
Cette dépendance durera plus deux siècles, jusqu'en
1744, bien que dès 1688 Valfleury soit confié
aux Lazaristes et passe donc, en fait, aux mains de cette congrégation.

L'abbatiale Saint-Robert, la Chaise-Dieu,
Haute-Loire
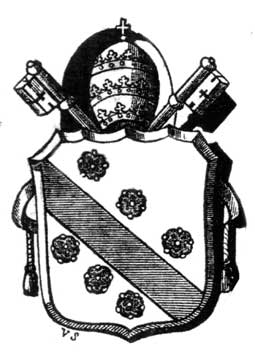
Armes
de Clément VI
En 1466, le prieur de Savigneux est choisi parmi les chanoines
de Notre-Dame, ce qui est une manière élégante
d'éviter les conflits avec le puissant chapitre de la
ville. Le prieur est alors Renaud de Bourbon, fils naturel de
Charles II, duc de Bourbon et d'Auvergne et comte de Forez.
Renaud est aussi prieur de Montverdun. Il deviendra ensuite
archevêque de Narbonne. On peut voir sa pierre tombale
dans le transept sud de l'église de Monverdun dans laquelle
il est enterré. Il fut sans doute le premier prieur commendataire
du prieuré de Savigneux en 1466-1467.
Le système de la commende veut que le prieur ne réside
pas sur place. Un prieur "claustral" le représente
mais, le plus souvent, il se désintéresse complètement
du prieuré se contentant d'en percevoir les revenus.
C'est particulièrement néfaste pour les petits
monastères qui périclitent rapidement.
Le prieur suivant est un autre fils naturel du comte de Forez,
Hector de Bourbon qui, lui, deviendra plus tard archevêque
de Toulouse.
En 1600, le prieur est Grégoire Perrossel. Le prieuré
possède alors des vignes près de Montbrison, à
Pierre-à-Chaux et près du faubourg de la Croix.
Le 7 mai il consent à l'affranchissement d'une dîme
sur une vigne sise au Royat, près de Montbrison, en faveur
de Benoît Fasson, marchand à Montbrison moyennant
la redevance d'un demi baril de vin .
Longue
période de décadence
Les
guerres de religion
Les guerres de religion n'arrangent pas les choses. Selon une
note trouvée dans les archives du prieuré, l'année
1562 fut particulièrement néfaste :
La ville de Montbrison fut mise au sac et au pillage par les
hérétiques, qui y commirent les plus inhumaines
et barbares cruautés des tirans du paganisme ; particulièrement
dans le monastère de Savignieu qui fut ruiné et
brûlé de fond en comble, avec tout ce qu'il y avait
de plus précieux, comme ornemens d'églises, reliques
et papiers.
En 1614, les bâtiments sont dans un triste état
: Le couvent du prieuré et les bastimentz d'icelluy sont
en danger de ruyne, une partie estant déjà tombée.
Les
ressources du prieuré
En 1649, le prieur donne à ferme les biens du prieuré
pour la somme de 2 000 livres à payer annuellement. De
plus le preneur doit fournir de l'argent et des prestations
en nature aux curés dépendant du prieuré
:
- 18 livres d'argent, 8 ânées de vin, 2 setiers
de seigle et un setier de froment au curé de Savigneux
;
- 17 setiers de froment et 6 setiers de seigle au curé
de Chalain-le-Comtal ;
- 200 livres au curé de Saint-Pierre de Montbrison ;
- 18 livres au curé de Saint-André ;
- 8 ânées de vin, 2 setiers de seigle et un setier
de froment pour les pauvres de Savigneux.
- 2 setiers de seigle au sonneur de cloche du village ;
et enfin
- 6 livres 10 sous à l'abbaye de la Chaise-Dieu .
Mise en commende, diminution du nombre des religieux, ressources
qui faiblissent… le déclin est inéluctable.
La
visite pastorale de 1662
Le procès-verbal de la visite pastorale effectuée
à Savigneux le 19 juin 1662 par Mgr Camille de Neuville,
archevêque de Lyon, nous montre comment, pratiquement,
cohabitent la paroisse et le prieuré :
Comme à Savignieu il y a un
prieuré et une parroisse, l'églize est divisée
en deux parties. Le bas est occupé par les religieux,
ou pour mieux dire, il l'estoit autrefois, car le prieuré
estoit conventuel et entretenoit onze religieux. Mais ils ont
esté transférés à la Chaize-Dieu
et il n'y a qu'un sacristain à Savignieu dont le prieuré
dépend de l'abbaye susdite de la Chaize-Dieu et est de
mesme ordre qui est celuy de Saint Benoist.
Dans la partie de dessus qui est soutenue par un plancher et
est moitié carrellée, moitié boisée,
le curé fait ses fonctions curiales. Il y a en cette
partie un grand autel et une chappelle du costé de l'évangile.
Le Saint Sacrement ne repose point en cette partie, mais seulement
sur l'autel du chœur de la partie inférieure de
l'églize qui est celuy des religieux.
En procédant à la visite du Saint Sacrement sur
ledit autel, le chœur et le tabernacle ont esté
ouverts par le sacristain, et le St Sacrement a esté
trouvé dans un ciboire d'argent. Il y a aussi un soleil
d'argent et une pixide pour le saint viatique.
Le luminaire de la parroisse est entretenu d'aumosnes. Le calice
n'a que la couppe d'argent. Il y a 2 chazubles, deux devants
d'autel et du reste suffisamment.
Sur le grand autel paroissial il y a commission de messes fondée
du patronage du prieur de Savignieu. Messire Blaise Soret, curé
de St-André de Montbrison, est prébendier. Le
service est d'une première messe tous les dimanches.
On n'a sceu en dire le revenu.
La confrérie du Rosaire est establie en cet autel dédié
à la Croix.
Le nombre des communians est d'environ 200.
Messire Claude Henrys est curé depuis le 22 de juillet
1642. Il a pour revenu une portion de dixme de 300 livres. Ces
registres et capacités sont en bon estat.
Le prieur est nominateur.
Les saintes huiles et fonts baptismaux sont en deu estat.
La maison curiale l'est aussy et le clocher est garni de 4 cloches.
Le cimetière est déclos et le curé a promis
qu'il le ferrait clorre à ses dépens.
L'église Sainte-Croix est alors curieusement aménagée.
Un plancher coupe la nef en deux déterminant une sorte
d'église basse ou crypte à l'usage exclusif des
moines et une église haute pour le service paroissial.
L'église semble décemment tenue.
Les derniers prieurs
Dom Pierre Sauret (ou Soret) entreprend la construction de deux
dortoirs de chacun six chambres, un cloître, "le
tout fort régulier et commode". Il fait aussi bâtir
un deuxième clocher où trois cloches sont installées.
Ces travaux relativement importants semblent indiquer qu'il
y a une embellie pour le prieuré après une longue
période de décadence.
Autre signe de cette timide renaissance. Le 13 octobre 1683,
le prieuré bénéficie d'une donation de
livres. Messire Pierre Manis, chanoine de Saint-Paul de Lyon
et prieur commendataire de Savigneux, offre 28 ouvrages aux
moines de Sainte-Croix. Il s'agit de la Bible, des œuvres
des Pères de l'Eglise et d'ouvrages de théologie.
Les religieux de Savigneux devront dire chaque jeudi à
perpétuité une messe basse pour la gloire de Dieu
et le salut du donateur et des siens . Le prieuré compte
alors trois moines : Pierre Sauret, le prieur claustral, Aymard
de Floris, titulaire de la prébende de Saint-Thomas et
Balthazard Desmolins.
Dom Pierre Sauret qui s'était fait une grande réputation
par sa vertu et sa prudence meurt à Savigneux l'an 1687.
Le Révérend Père Aymard de Flory qui lui
succède étonne les gens du pays par son adresse
manuelle. C'était un artisan très habile qui "se
rendoit fort utile par son industrie, travaillant en menuiserie
et au tour aussy proprement qu'un maître de profession"
. Il est probable qu'il utilise ses compétences en effectuant
des travaux pour les gens du voisinage afin de procurer quelque
ressource au prieuré.
Il y a toujours de fréquents procès entre le prieur
et le curé de Savigneux qui utilisent le même sanctuaire
: disputes à propos du grand autel qui est réservé
au prieur, que l'archevêque de Lyon veut visiter au cours
des tournées pastorales, querelle en 1678 au sujet des
fonts baptismaux... En 1682 c'est un ormeau planté devant
la porte du monastère qui est l'objet du litige : il
faut déterminer à qui reviendront les branches
après élagage !
En 1713, le prieur commendataire est Jean Bonnet, prêtre
de la congrégation de Saint-Lazare et le prieur claustral
Dom Arnaud Dazellest. Le couvent héberge deux autres
moines : Dom Gabriel Béal et Dom François Chamuron
.
D'autres procédures suivent en 1714 et en 1735.
En 1728, selon la déclaration faite à l'assemblée
générale du clergé de France , les revenus
du prieuré permettent la nourriture et l'entretien de
6 religieux et de 3 domestiques. Cependant, selon Broutin, le
prieuré n'est plus considéré comme un couvent
mais comme un simple hospice pour deux ou trois moines vieux
ou infirmes que l'abbaye de la Chaise-Dieu y envoyait, quand
leur âge ou leur santé imposait le repos, ou demandait
un climat plus doux... Vers 1730, le couvent est presque toujours
vide, avec des bâtiments qui menacent ruine et le jardin
inculte.
En 1751, les moines, sans doute pour accroître leurs ressources,
prétendent exercer les fonctions curiales...
Dom Jean Marie Palerne prend possession de la prébende
dite de Sainte-Croix et de Saint-Thomas, le 15 février
1738. Le prieur commendataire est alors Jean Couty, supérieur
général de la congrégation de Saint-Lazare
et le curé de Savigneux Messire Jacques Fargeix .
Procès
avec Pierre Chappuis de Villette
En 1700, le prieur et les moines sont en procès avec
Pierre Chappuis de Villette au sujet d'aménagements que
ce dernier a fait effectuer le long du Vizézy. Ces travaux
auraient endommagé un terre chènevière
et un pasquier (pâture) de 4 métrées dépendant
du prieuré et bordant aussi la rivière.
Pour terminer la contestation, le 2 mai 1700, les moines vendent
cette terre au seigneur de Villette pour la somme de 350 livres.
Il est convenu que jusqu'à ce les moines trouvent à
placer cette somme en achetant un nouveau terrain, M. Chappuis
de Villette gardera les 350 livres et leur versera une rente
d'un sol par livre (5 pour cent). La vente est passée
au monastère par Duby, notaire royal, le 2 mai 1700.
Les moines sont alors au nombre de cinq : Dom Charles Mathieu,
prieur claustral, Dom Joseph Faure, Dom Jean Maurat, Dom François
Simonnet, Dom Joseph Gadaud, tous prêtres et religieux
.
Le
pigeonnier des moines
Le prieuré possède deux pigeonniers dans le clos
qui l'entoure. Un plan de 1775 donne une idée de la disposition
des bâtiments. L'église est orientée à
l'est comme il se doit. Son côté nord jouxte un
clos rectangulaire dont une petite partie, tout contre l'église,
sert de cimetière aux moines. Au sud, l'habitation des
religieux et le cloître sont accolés à l'église
prieurale. Un deuxième clos entoure le couvent. Les pigeonniers
sont probablement les deux bâtiments carrés situés
en bordure du clos, tout près du Vizézy. Il s'agit
de deux tours en pisé ressemblant aux pigeonniers traditionnels
dont nous possédons encore quelques spécimens
en Forez.
Les moines louent leurs deux pigeonniers à un aubergiste
de Grézieux-le-Fromental pour la coquette somme de cinquante
livres, cinquante-trois livres en fait, puisque à ce
fermage s'ajoute la fourniture de douze couples de pigeons estimés
à cinq sols le couple.
Quel était donc l'importance de ces deux pigeonniers
et quel intérêt économique présentaient-ils
? Un couple de pigeons peut, si les conditions sont favorables,
élever de dix à seize pigeonneaux chaque année.
Pour récupérer le seul montant du fermage, le
preneur devait vendre plus de 400 pigeonneaux. Il est vrai qu'il
pouvait aussi disposer de la précieuse colombine, engrais
très apprécié... Les deux colombiers du
monastère pouvaient donc héberger de nombreux
pigeons adultes, probablement plusieurs centaines.
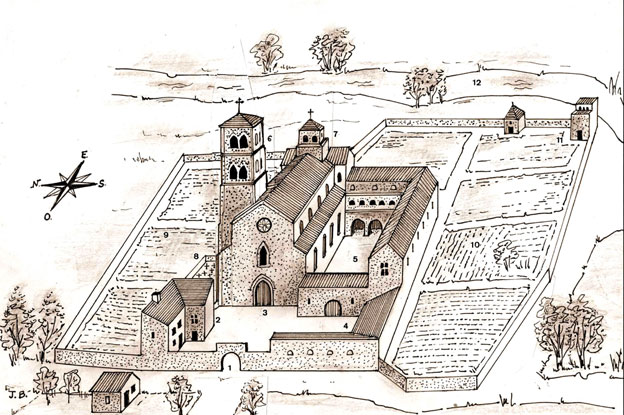
Essai de reconstitution du prieuré
Sainte-Croix de Savigneux
aujourd'hui totalement disparu
1 - Entrée
du prieuré.
2 - Presbytère de Savigneux.
3 - L'église de style gothique, à trois
nefs.
4 - Bâtiments d'exploitation et logement du jardinier.
5 - Cloître et logis des moines.
6 - Grand clocher, "assez considérable",
au-dessus d'une chapelle
donc au-dessus d'une basse nef.
7 - Petit clocher, construit à la croisée
du transept et de la nef.
8 - Cimetière de Savigneux.
9 - Jardin du curé.
10 - Jardin des moines.
11 - Pigeonnier des moines.
12 - Vizézy.
*
* *
Ferme
de deux pigeonniers au prix de 50 livres
passée
par les prieur et religieux
du
monastere de Sainte Croix de Savignieu
à
Sieur Jean Perrin hoste de Grézieux du 8 avril 1736
Pardevant le notaire royal au bailliage de Forest reservé
pour la ville de Montbrison soussigné et en présence
des temoins cy-après nommés furent présents
Dom Jean Palerne prieur claustral du monastère de S[ain]te
Croix de Savignieu Dom Jean Antoine Pelardy, frère Gabriel
Geoffrenet, frère Laurent Javelle, tous religieux dud[it]
Monastere,
lesquels de leur bon gréz et volontéz ont assencée
et affermé a S[ieu]r Jean Perrin, hoste du bourg de Grezieu
icy present et acceptant, a scavoir deux pigeonniers dependant
dud[it] monastere scitué dans l'enclos et jardins desd[its]
religieux ainsy qu'ils se contiennent et comportent et ce pour
le temps et espace de six années entières et consécutives
qui commanceront au premier jour du mois de may prochain et a
pareil jour finiront lesd[ites] années finies et resolus,
pendant lequel temps le sr Perrin preneur promet et s'oblige de
bien et duement nourrir les pigeons jusques au premier may de
l'année mil sept cent quarante deux que la presente ferme
finira,
Laquelle est faitte moyennant le prix et somme de cinquante livres
par chacune année payable en un seul terme dont le premier
commancera a la Toussaint prochain et douze paires de pigeons
aussy annuellement et au cas que lesd[its] religieux ne prennent
point lesd. douze paires de pigeons led[it] Perrin les payera
a raison de cinq sols la paire et sy lesd[its] religieux en ont
besoin de surplus ils les luy payeront a raison de cinq sols sans
préjudice de six bichets de pezettes que led[it] preneur
s'est obligé de délivrer aux termes du précédent
bail et qu'il promet payer auxd[its] religieux a requeste
ainsy convenus promis observer et ny contrevenir a peyne de depens
dommages et interest par promesse obligation de biens et propre
personne dud[it] preneur qui jouira desd[its] pigeonniers en bon
pere de familles et fournira a ses frais auxd[its] dom et religieux
expéditions des presentes a requeste soudmissions renon[ciations]
et clauses necessaires
fait et passé audit Savignieu dans la salle dudit monastere
le huitiesme avril mil sept cent trente six en présence
de sieur Jean Baptiste Fasson praticien de la ville de Montbrison
de present audit Savignieu, de François Mollin cuisinier
desd[its] dom et religieux demeurant actuelement audit Savignieu,
temoins requis desquels led[it] sr Fasson a signé avec
lesd[it] sieurs bailleurs et ledit preneur a déclaré
ne scavoir signer de ce enquis et somméz soit con[tro]llé
Jean Palerne, prieur J. A. Pelardy Fasson Bochetal notaire royal
fr. Gabriel Geoffrenet fr. Laurent Javelle
Con[tro]llé a Montbrison le 21 avril 1736 Reçu douze
sols [signé] Levacher
*
* *
Vers
la suppression du prieuré
De
1752 à 1755 le prieur est Jean-Charles-François
Legros, docteur en théologie de la faculté royale
de Navarre, chanoine de la Sainte-Chapelle de Paris.
Peu à peu les ressources du prieuré diminuent :
dîmes et rentes sont vendues. Le montant total du fermage
passe de 5 800 livres en 1757 à seulement 1 700 livres
en 1771 .
En 1770 il reste seulement les produits du vaste clos qui entoure
le couvent, de l'étang voisin qui existait déjà
en 1452 , d'un pré de 18 métérées
situé au lieu-dit Champage, d'une terre de 12 métérées
à Montrouge et de deux domaines : le grand et le petit
Vergnon. Les revenus s'élèvent à 8 300 livres
mais les charges sont de 7 523 livres. Il faut notamment verser
des portions congrues aux curés de Savigneux, Saint-Pierre
et Saint-André. Il ne reste que 777 livres, une somme insuffisante
pour permettre à trois moines de subsister. Chaque année
l'abbaye de la Chaise-Dieu doit donc verser un secours de 1 300
livres à sa filiale de Savigneux.
Dès 1771, la réunion du prieuré de Savigneux
avec le collège de l'Oratoire de Montbrison est décidée
pour 100 livres de rente annuelle à verser à la
Chaise-Dieu mais l'année suivante l'accord est annulé.
Il sera repris dix ans plus tard .
Le
prieur Rat de Mondon
An 1773, après le décès de Donzeau de Saint-Pons,
le prince de Rohan, abbé commendataire de la Chaise-Dieu,
attribue le prieuré de Savigneux et l'église de
Valfleury sa filiale à un autre membre du haut clergé.
Il s'agit de Messire André Rat de Mondon, qui cumule de
nombreuses charges : prêtre du diocèse de Poitiers,
vicaire général du diocèse de Bordeaux, lecteur
ordinaire du roi, avocat spécialisé en droit canon
au parlement de Paris pour le clergé de France et le comte
de Provence... Il réside à Paris, rue du Four, dans
la paroisse de Saint-Sulpice du faubourg Saint-Germain.
Le nouveau prieur commendataire désigne un homme de loi
montbrisonnais pour représenter ses intérêts
à Savigneux : Antoine Chavassieu, un procureur ès
cours de Forez .
Ce dernier est aussitôt chargé de donner en ferme
tous les biens du prieuré à l'exception du logis
prieural et de l'habitation des moines. La ferme de tous les revenus
et produits temporels du prieuré est passée le 2
novembre 1773 . A la suite d'enchères, elle est adjugée
pour 9 ans et pour la somme annuelle de 10 050 livres à
Joseph Riboulet, marchand, et Charles-Joseph Cibost. bourgeois.
Outre la ferme de 10 050 livres et celle de 1 560 livres payées
à Maître Chavassieu pour pot de vin , les preneurs
ont des charges en nature :
- 40 boisseaux de seigle à la prieure de Saint-Thomas (à
cause de la dîme de Champ).
- 8 ânées de vin pur et marchand au curé de
Savigneux (à cause de la dîme en vin de Savigneux).
- 3 setiers et huit boisseaux de seigle et 25 poignées
de chanvre au curé de Savigneux (à cause de la dîme
en grains de Savigneux).
- 2 setiers de blé au sonneur de cloches de Savigneux.
- 2 setiers de seigle aux recteurs de la maison de Charité
de Montbrison.
- 6 setiers de froment et 8 setiers de seigle au curé de
Chalain (au titre de la dîme de Chalain-le-Comtal).
Les
preneurs s'engagent à payer les charges qui reviennent
au prieur et qui sont donc déduites de la somme de 10 050
livres. Ils verseront notamment 900 livres pour le curé
de Saint-André de Montbrison et ses 2 vicaires, 700 livres
pour celui de Saint-Pierre et son vicaire, 200 livres pour le
curé de la Madeleine, 500 livres au curé de Champ,
84 livres au curé de Saint-Bonnet-le-Courreau, 20 livres
au curé de Chalain-le-Comtal, 65 livres au curé
de Savigneux.
Le nouveau prieur entre aussitôt en conflit avec l'abbaye
de la Chaise-Dieu. Il tient pourtant sa nomination de Mgr de Rohan,
abbé commendataire du monastère auvergnat. Il reste
un seul moine bénédictin à Savigneux, Dom
Lagorrée. Il s'efforce de lui faire quitter les lieux.
Le 22 décembre 1773, son procureur se rend au prieuré
et somme le religieux bénédictin qui est venu y
habiter depuis quelque temps de se retirer dans son monastère
conventuel et de vider les lieux . Messire Rat de Mondon veut
bien le prieuré mais vide de tout moine.
Dom Lagorrée réplique qu'il réside à
Savigneux par ordre de ses supérieurs légitimes
et que le prieur n'a aucun droit de lui intimer un tel ordre.
D'autre part, explique-t-il, tous les biens du prieuré
appartiennent à la Chaise-Dieu et doivent lui revenir en
cas d'abandon total de la vie conventuelle. De plus, de nombreuses
fondations doivent être acquittées sur les lieux
et c'est lui qui s'en acquitte. Selon Dom Lagorrée, s'il
n'y a plus de conventualité à Savigneux c'est parce
que le prieur ne verse pas suffisamment de fonds.
Des revenus insuffisants pour un minimum de moines, l'abbaye de
la Chaise-Dieu qui s'obstine à garder un représentant
à Savigneux, un prieur qui voit les choses de très
loin, à la veille de la Révolution la situation
est inextricable.
Rat de Mondon ne semble pas avoir obtenu satisfaction car, en
1782, un moine occupe encore le prieuré de Sainte-Croix.
Il entame aussi un procès contre les consuls et collecteurs
de taille de Montbrison à cause des impositions qu'il conteste
.
Suppression
du prieuré
Inévitablement on s'achemine vers la disparition du prieuré.
C'est chose faite en 1781. Par décret du 6 septembre, l'archevêque
de Lyon, Antoine de Montazet, supprime le prieuré de Savigneux.
Les biens et revenus sont réunis au collège de Montbrison.
L'église, le clocher et les cloches sont attribués
à la paroisse de Savigneux tandis que les meubles, livres,
linges et vases sacrés reviennent à la Chaise-Dieu.
Titres et bénéfices sont supprimés.
Les Oratoriens qui régissent le collège de Montbrison
auront annuellement la charge de verser 500 livres à un
jeune étudiant choisi par l'abbé de la Chaise-Dieu,
devront payer aux curés de Saint-Pierre et de Saint-André
de Montbrison 500 livres chacun et donner 2 livres de cire à
la Chaise-Dieu. Enfin l'archevêque de Lyon se réserve
le patronage des cures dépendant auparavant du prieuré.
Pour Savigneux l'archevêque choisira le curé parmi
trois candidats que lui présenteront les Pères de
l'Oratoire de Montbrison.
L'abbaye de la Chaise-Dieu fait, naturellement, opposition à
la décision de l'archevêque de Lyon mais n'est pas
suivie par son abbé commendataire, Louis-René-Edouard,
prince de Rohan, cardinal-évêque de Strasbourg, grand
seigneur très peu soucieux des intérêts de
son monastère auvergnat.
En 1782 un seul moine, Dom Philippe Viaud, réside encore
à Savigneux. Les Oratoriens prennent possession du prieuré
de Savigneux le 7 octobre 1783 en présence de M. Benoît,
curé de la Madeleine, et archiprêtre. En 1785 meurt
Antoine Rat de Mondon. C'est pour Savigneux la fin de plus de
huit siècles de présence monastique. Un père
de l'Oratoire est désormais chargé de desservir
la paroisse. Quant à la paroisse, elle est supprimée
après le départ du curé constitutionnel.
Une
pauvre paroisse de plaine
A côté du prieuré subsistant presque dans
l'indigence, la paroisse de Savigneux peut alors être considérée
comme pauvre ainsi que beaucoup de villages de la plaine. En 1680,
elle compte 65 feux et paye moins de 800 livres de taille, 12
livres environ par feu. Les paroisses des monts du Forez sont
beaucoup plus imposées : Sauvain, qui a le même nombre
de feux, verse le triple, Lérigneux presque quatre fois
plus par feu . Cela tient au fait qu'à Savigneux les ordres
privilégiés, noblesse et clergé, détiennent
directement une part importante des terres, sous forme de grands
domaines, et que les journaliers, paysans sans terre, sont nombreux.
En outre le climat est malsain à cause d'un terroir mal
drainé et les habitants souffrent des fièvres. Dans
la montagne, au climat rude mais salubre, il y a en revanche une
forte proportion de petits et de moyens laboureurs, paysans propriétaires
de leurs terres.
*
* *
Avril
1789 : Claudine, enfant trouvée
à la porte de la cure de Savigneux...
Au cours des 18e et 19e siècles, plusieurs milliers d'enfants
abandonnés à Montbrison ont été recueillis
par les hôpitaux de Montbrison, l'hôtel-Dieu Sainte-Anne
et la Charité. C'est le cas de la petite Claudine exposée
à Savigneux en avril 1789.
Devant les recteurs de Sainte-Anne
Le 28 avril, André Lombardin et sa femme Claudine Golin
portant un enfantelet entrent timidement dans le parloir du bureau
de l'hôtel-Dieu. Là siègent gravement un digne
chanoine de Notre-Dame et trois bourgeois. Ce sont des directeurs
de l'hôpital. Ils ont aussi convoqué les notaires
Bourboulon et Chantemerle. De quoi s'agit-il ? De la remise à
l'hôtel-Dieu d'un enfant trouvé, une fillette âgée
de quelques jours.
Vers minuit, alors qu'il pleuvait fort
Ces bonnes gens habitent la cure de Savigneux, tout près
de l'église Sainte-Croix. Dans la nuit du 9 au 10 avril,
vers minuit "dans le plus profond sommeil, ils sont éveillés
par des coups multipliés qu'ils entendent frapper à
la porte d'entrée de leur domicile" .
André Lombardin et sa femme se lèvent et, de la
fenêtre, demandent ce qui se passe. On leur répond
de la ruelle "qu'on vient d'exposer un enfant à leur
porte, de le lever promptement" sinon "qu'il va périr
et de le faire baptiser". En effet, cette nuit-là,
il pleut très fort. Et aussitôt, dans la nuit, s'enfuient
"un homme et une femme à eux inconnus".
Les époux trouvent effectivement à leur porte "un
enfant emmailloté qui crie, placé dessous l'égout
du couvert... les eaux pluviales tombent et il est déjà
[trans]percé..."
Le procès-verbal précise : "Les mariés
Lombardin et Golin pour empêcher le dépérissement
certain de cet enfant n'ont rien de plus pressé que de
le lever et de l'emporter dans leur domicile où ils le
réchauffent et lui changent de linge".
Refus du seigneur de Savigneux
Le lendemain, ils s'empressent de raconter ce qui s'est passé
au curé de Savigneux, "lequel sieur curé baptise
l'enfant sous le nom de Claudine". Le jour suivant, ils vont
chez M. de Meaux, lieutenant général, auquel ils
présentent les faits et demandent, en sa qualité
de seigneur de Savigneux, de s'occuper de l'enfant "exposé".
Mais M. de Meaux "fait refus de se charger dudit enfant".
André et Claudine sont charitables mais pauvres. Simples
journaliers, ils expliquent qu'ils "ont fourni les aliments
à cet enfant depuis le jour de son exposition mais qu'ayant
eux même des enfants, se trouvant sans fortune" ils
ne peuvent s'en charger plus longtemps. Ils n'ont agi "que
par un principe de charité et d'humanité".
La petite Claudine devient donc "enfant de l'hôpital"
de Montbrison. Elle est placée aussitôt en nourrice,
dans les monts du Forez. A sept ans, si elle vit encore, elle
entrera à la Charité jusqu'à ce qu'elle puisse
"prendre une condition", devenir servante chez un bourgeois
ou dans quelque ferme. Un bien pauvre destin ! Heureux si elle
n'a pas un enfant qu'à son tour elle devra abandonner car
il y a une sorte de cycle de la misère...
*
* *
La
vente du prieuré et du presbytère de Savigneux
Le vingt-neuf pluviôse an 5, le prieuré est vendu
au citoyen Antoine Forest, marchand clincailler demeurant à
Montbrison pour 86 446 F. L'acte de vente nous fournit une intéressante
description des bâtiments et des terrains.
Le prieuré qui est accolé à l'église
comprend alors :
- Un corps de bâtiment formant trois ailes, donc en U, avec
une cour au milieu (le cloître). Le rez-de-chaussée
comporte dix pièces. Dans l'aile du sud il y a, au-dessus,
un vaste grenier, dans le corps central, cinq chambres (le logement
des moines), dans la troisième aile, deux chambres et des
latrines. Seule cette dernière partie possède un
second étage distribué en deux chambres et un cabinet.
C'était là, vraisemblablement, le logement du prieur.
L'ensemble mesure 81 pieds de long soit un peu plus de 26 m.
- Des locaux d'exploitation agricole qui joignent les bâtiments
d'habitation, toujours au sud de l'église. Plusieurs remises
(des chapits foréziens), une écurie et une fenière
(autre mot local pour désigner le fenil) sont en mauvais
état. Parfois il n'en reste presque rien. On trouve ainsi
un emplacement de bâtiments hors de service.
- Un jardin de 3 métérées (environ 2 850
m 2) entourant le prieuré. Un pigeonnier est installé
dans ce clos tout près de la rivière. Mais le lot
le plus important est l'étang "prenant sa source à
la rivière de Vizézy" qui mesure 177 métérées
soit presque 17 hectares.
Antoine Forest achète le même jour, 29 pluviôse
an 5, la cure de Savigneux pour la somme de 2 614 francs. Il s'agit
d'une modeste maison en "L" avec au rez-de-chaussée
cuisine, salon, écurie, cave et, à l'étage,
chambres, grenier et fenière. Elle est entourée
d'un jardin de trois métérées sur lequel
est bâti un pigeonnier.
Notons que l'église et le cimetière, devenus propriétés
de la commune ne figurent pas dans la vente du prieuré.
*
*
*
Avec l'aliénation des biens de l'Eglise, une étape
importante s'achève pour Savigneux qui est en grand danger
de disparaître en tant que collectivité. Sans église
ni bourg, il ne reste aucun lieu pour rassembler la population.
Certes, après la Révolution, une commune subsiste,
mais les édiles sont contraints de se retrouver dans un
cabaret isolé à la croix Meyssant. La population
est clairsemée et décimée par la fièvre.
Au cours du 19e siècle, Savigneux risque plusieurs fois
d'être réuni à Montbrison. Il faut attendre
le début du 20e siècle pour que se produise une
véritable renaissance.
Joseph
Barou
(Extrait de : Savigneux,
hier et aujourd'hui, ouvrage édité
par la ville de Savigneux avec la participation de membres de
la Diana, Maury imprimeur, 2005)

Restes du portail
du prieuré Sainte-Croix
Voir aussi la
page

Savigneux
textes
et documentation : Joseph Barou
questions,
remarques ou suggestions :
s'adresser :
|
|
Mis
à jour le 20 novembre 2010
|
|
|