Autour
du "château" Chabet
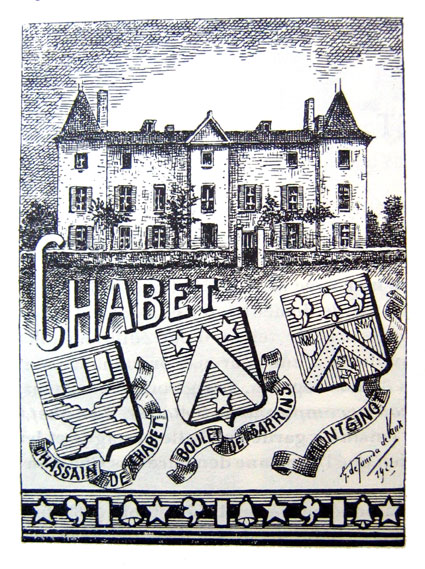
Chabet,
dessin de Gaston Jourda de Vaux, Les châteaux historiques
du Forez, 1916

Chabet en 2006
UN
CHATEAU "MORT-NE" EN FOREZ
par
Jean Canard
Il
était une fois...(l'histoire commence comme un conte de
fée) une jeune fille dont le célibat semblait se
prolonger au-delà des limites convenables pour faire un
mariage prometteur, qui s'était éprise d'un gentilhomme
qu'elle n'avait pas l'occasion de voir souvent... Une jeune fille
qui n'avait rien d'une star internationale : si la fée
qui préside aux destinées des gens fortunés
l'avait assistée dès sa naissance, celle à
qui l'on doit habituellement la beauté physique, devait
être, ce jour-là, très occupée ailleurs."Qu'est-ce
qu'elle n'était pas belle", se serait sûrement
écrié un petit garçon de mes voisins, s'il
avait eu la possibilité de la rencontrer.
Oui mais... elle était l'héritière d'une
famille immensément riche, et tout le monde sait bien que,
dans notre société occidentale, l'argent apporte
une compensation qui permet de fermer les yeux sur beaucoup d'imperfections.
Cela se passait dans les premières années de la
Troisième République. La jeune fille venait tous
les ans, avec sa famille d'abord, puis seule, passer quelques
semaines d'été dans la plaine forézienne.
Elle se mêlait peu à la population du pays qui ne
connaissait d'elle que l'irrégularité de ses traits.
Mais, parce qu'elle était riche, les familles de la haute
société l'invitaient volontiers à des réceptions.
C'est au cours de l'une d'elles qu'elle sentit battre son cœur
pour un jeune homme de son âge qui appartenait à
la petite noblesse du pays : véritable "coup de foudre"
qui se traduisit presque aussitôt en "coup de folie".
A quoi ne se serait-elle pas résignée sinon pour
aboutir à un lien indissoluble, du moins pour vivre le
plus près possible de son chevalier servant. L'argent ne
comptant pas pour elle, elle décida, sur le champ, sans
hésitation ni calcul, de se faire construire un grand et
beau château, à quelques centaines de mètres
seulement de la résidence principale du garçon qu'elle
voulait séduire. On raconte qu'elle rêvait même
de relier les deux manoirs par une voie directe ...
La tradition a fidèlement rapporté ce qui précède.
Venons-en maintenant à des explications plus précises.
La jeune personne au visage ingrat qui s'est lancée dans
cette aventure s'appelait Mademoiselle Bodinon. Elle appartenait
à une famille lyonnaise de banquiers et marchands de biens,
propriétaires notamment du grand domaine de Chabet, dont
les bâtiments ruraux sont encore occupés à
quatre cents mètres au nord du château du même
nom.
L'emplacement choisi pour la nouvelle construction appartenait
précisément au domaine de Chabet : un petit coteau
boisé, du haut duquel on pouvait apercevoir le castelet
qu'elle rêvait de relier au sien par une grande allée
privée. L'immeuble projeté aurait du être
un château comme on en voit peu en plaine forézienne
: tout en pierre, le corps principal flanqué, au levant,
d'une tour, et les cours entourées de dépendances
confortables pour chevaux et calèches.
Les travaux furent menés si rondement par des ouvriers
nombreux et habiles que la luxueuse demeure, couronnée
de pierres taillées et surmontée d'une toiture pentue
couverte d'ardoises, était achevée au bout de quelques
mois. Portes et fenêtres posées, l'intérieur,
pratiquement terminé, était desservi, au rez-de-chaussée,
par un hall central d'où partait pour les étages
un majestueux escalier.
On allait entreprendre la pose des tapisseries et les peintures
quand, brusquement, dans des circonstances qui ne sont pas bien
connues, la demoiselle quitta ce monde pour un autre dont on ne
revient pas. Il y a de cela exactement un siècle. Ce fut
une catastrophe et pour le château et pour la commune.
L'heureux bénéficiaire de l'héritage, un
parent, officier de marine résidant à Toulouse,
ne chercha pas à nouer des liens avec notre province qui
lui était étrangère. Au lieu de prendre en
charge l'achèvement de la magnifique résidence de
Montverdun, il préféra en tirer profit tout de suite,
et se débarrasser de tout ce qui pouvait en être
aisément détaché. En quelques semaines le
bâtiment fut réduit à l'état de squelette
et abandonné au pillage. A l'issue de la Grande Guerre,
la construction elle-même et le terrain d'alentour furent
vendus à un cafetier de Boën, originaire du quartier.
Le tout échappait ainsi définitivement à
la tutelle des parents de la grande famille lyonnaise.
Nous n'avons pas à entrer dans le détail des avatars
survenus aux descendants de l'acquéreur qui, semble-t-il,
poursuivis par le mauvais sort accroché dès les
origines à ce château, furent amenés à
dépecer le domaine pour ne pas sombrer dans la faillite.
En 1925, la toiture résistait encore aux intempéries,
conservant au monument inachevé une certaine noblesse.
Dix ans plus tard environ s'effondrait la tour, entraînant
dans sa chute une partie de la grosse charpente du corps principal
qui s'en trouva déséquilibré. C'était
la fin ! Pour écrire, les écoliers purent faire
ample provision d'ardoises, et les voisins trouvèrent pierres
et ferrures à volonté pour construire ailleurs.
Voyant cela, le propriétaire du moment, après un
maladroit essai de consolidation, s'empresse de faire enlever
le grand escalier, les pierres taillées du couronnement
et quelques-uns des encadrements d'ouvertures, le tout cédé
à bas prix. Pour desceller plus facilement certaines ferrures
importantes, on alla jusqu'à utiliser la dynamite. Ce qui
eut pour effet d'ébranler tout l'édifice, et de
rendre impossible toute forme de restauration ultérieure.
Les pans de murs restés debout sont visibles, au-delà
du petit ruisseau Dru gent, à un demi-kilomètre
environ de la route de Marcilly-le-Châtel à Monverdun
; vestiges grandioses et impressionnants qui donnent une petite
idée de ce que devait être ce grand immeuble à
l'état neuf, construit sur une vaste plate-forme en terrasse.
Au sud, la façade principale se développe sur une
longueur de vingt-cinq mètres environ, tandis qu'en profondeur,
les côtés est et ouest en mesurent une quinzaine.
On distingue très bien les trois niveaux superposés
de l'édifice un rez-de-chaussée (ou plutôt
une sorte d'entresol) surélevé de quelques décimètres
par rapport à la cour, au-dessus de caves voûtées.
Deux étages étaient habitables, le second, sous
la toiture, éclairé par de grandes ouvertures mansardées.
Dernières précisions : le plan levé par l'état-major
en 1852, n'indique pas de constructions en cet endroit ; l'Atlas
Cantonal du Département publié en 1887 y
mentionne un château et la dernière carte de l'I.G.N.
ne parle plus que de "maisons ruinées".
Ainsi va le monde ! Beaucoup de beautés disparaissent sans
atteindre leur plein épanouissement. Le château Bodinon
a vécu le temps d'un rêve inachevé ; lentement
les ruines retournent au néant dont elles n'étaient
sorties que pour vivre un espoir non tenu...
Jean Canard